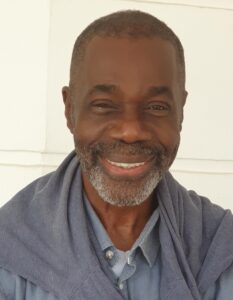PAR JEAN-MARIE NOL*
L’histoire des peuples amérindiens est souvent abordée sous l’angle des grandes migrations, des cosmogonies ou des résistances culturelles face aux colonisations.
Mais, il est une dimension de cette histoire encore trop peu connue et pourtant révélatrice de la relation intime entre ces peuples et leur environnement : celle de l’accouchement dans l’eau. Des forêts amazoniennes aux rives du Pacifique, en passant par les hauts plateaux andins ou les archipels caraïbes, de nombreux témoignages oraux, récits d’explorateurs et études anthropologiques confirment que la naissance dans l’eau faisait partie des pratiques traditionnelles chez certaines communautés amérindiennes.
Plus qu’un simple fait culturel, l’accouchement dans l’eau est, pour ces peuples, l’expression d’un lien ancestral avec la nature. Chez les peuples autochtones d’Amazonie, par exemple, plusieurs ethnologues ayant travaillé avec les Shipibo-Conibo (Pérou), les Yawanawa (Brésil), ou encore les Achuar (Équateur) rapportent que certaines femmes préféraient mettre au monde leur enfant dans des criques calmes, à l’abri des regards, immergées jusqu’à la taille ou accroupies dans l’eau tiède de la forêt.
Dans le livre Birth in Four Cultures de Brigitte Jordan (1978), pionnière de l’anthropologie obstétricale, bien que l’Amérique du Sud n’y soit pas largement représentée, les témoignages qu’elle recueille ailleurs dans le monde laissent entendre que des pratiques similaires, observées ailleurs, résonnent fortement avec des récits amérindiens restés oraux.
En Amérique centrale, les Mayas des hauts plateaux guatémaltèques et du Yucatán avaient également des pratiques obstétriques très codifiées. Les sages-femmes traditionnelles, appelées parteras, jouaient un rôle fondamental dans la mise au monde. Bien que toutes les naissances ne se faisaient pas dans l’eau, certaines sources coloniales espagnoles du XVIe siècle décrivent des bains rituels liés à la grossesse et à l’accouchement.
Ces bains, pris dans des rivières sacrées ou dans les fameuses chultuns (cavernes ou bassins souterrains), avaient pour fonction de soulager la douleur et de favoriser la naissance. Des archéologues travaillant dans le Yucatán ont d’ailleurs retrouvé des objets liés à la maternité (comme des figurines de femmes enceintes) à proximité de bassins naturels, suggérant un usage symbolique et pratique de l’eau dans le processus d’enfantement.
Sur le continent nord-américain, certaines tribus côtières, comme les Tlingit ou les Salish, qui vivaient en harmonie avec l’océan et les rivières du Nord-Ouest Pacifique, considéraient l’eau comme un élément purificateur, protecteur, presque matriciel. Bien que les accouchements dans l’eau ne soient pas systématiques dans ces cultures, certaines femmes choisissaient d’accoucher dans des bains chauds d’eau minérale ou dans des criques abritées.
Des récits de femmes autochtones du Canada recueillis par des historiennes comme Isabelle Knockwood (dans Out of the Depths) ou Kim Anderson évoquent ces traditions anciennes, parfois abandonnées à cause de la médicalisation coloniale imposée au XXe siècle.
Dans les Caraïbes, avant l’arrivée des Européens, les Taïnos, peuple arawak présent dans les grandes Antilles, avaient une culture profondément aquatique. Ils vivaient au bord de l’eau, naviguaient quotidiennement, et effectuaient de nombreuses cérémonies dans les rivières.
Des écrits de missionnaires espagnols comme Ramón Pané et Bartolomé de Las Casas, bien que biaisés, mentionnent des rituels de naissance et de purification effectués dans l’eau, parfois au moment même de l’accouchement. Ces pratiques auraient ensuite influencé certaines populations créoles de la Caraïbe, notamment en Haïti et en Dominique, où l’on retrouve jusqu’au XIXe siècle des récits d’accouchements dans des sources thermales ou en mer, à l’aube, dans un cadre discret et sacré.
En Guadeloupe, les femmes Arawaks et Caraïbes pratiquaient également l’accouchement dans l’eau, notamment dans la commune de Trois-Rivières et Baillif . Selon moi , les peintures et sculptures rupestres de la région montrent des scènes d’accouchement à même le sol, près d’une source d’eau ou dans la forêt, afin d’accroître le pouvoir vital de la Terre. L’immersion dans l’eau améliorerait l’élasticité tissulaire, notamment celle du périnée, diminuant ainsi les risques pour la mère et l’enfant.
Les différents sites de roches gravées répertoriés sur la Basse-Terre étaient exclusivement des lieux sacrés destinés au rituel de l’accouchement dans l’eau des femmes Arawaks. Un dessin représentant une femme caraïbe en train d’accoucher accroupie dans l’eau, les bras en l’air, illustre cette pratique ancestrale.
Les différents sites de roches gravées répertoriés sur la Basse-Terre, notamment les sites de Trois-Rivières et de Baillif, étaient exclusivement des lieux sacrés, utilisés à des fins rituelles liées à la fertilité, à la naissance et au lien cosmique entre la femme et la Terre-Mère.
Ces roches gravées – blocs basaltiques couverts de pétroglyphes – ne sont pas de simples manifestations artistiques. Elles sont placées de manière stratégique, souvent à proximité immédiate de sources, de rivières ou de bassins naturels, éléments associés à la purification, au renouveau et à la régénération. Les motifs circulaires, les figures anthropomorphes agenouillées, accroupies ou en extension, les matrices stylisées et les spirales qui les ornent, sont interprétés par plusieurs chercheurs, comme des représentations codées de la gestation, de l’enfantement ou de la transmission de la vie. L’on peut avancer que certaines scènes montrent des femmes en position d’accouchement, les bras levés vers le ciel, dans une gestuelle qui rappelle des invocations sacrées ou des appels à la protection des esprits.
Ce caractère sacré est renforcé par l’isolement relatif de ces sites, souvent dissimulés dans des zones peu accessibles ou profondément boisées, et par la présence de symboles associés aux cycles lunaires et à la fertilité. Ces lieux étaient probablement interdits aux hommes pendant les cérémonies, et exclusivement réservés aux femmes, aux sages-femmes et aux matrones détentrices de savoirs rituels.
L’accouchement y était vu comme une cérémonie de passage engageant non seulement la mère et l’enfant, mais aussi les forces invisibles du monde naturel et spirituel. Dans cette perspective, les roches gravées étaient bien plus que des supports physiques d’expression de l’accouchement : elles formaient un autel, un seuil, un témoin pérenne des cycles de la vie.
Ce lien universel entre l’eau et la naissance dans les cultures amérindiennes peut être interprété de plusieurs manières. D’abord physiologique : l’eau chaude détend les muscles, soulage la douleur, facilite la dilatation du col de l’utérus et réduit le stress. Ensuite symbolique : dans nombre de cosmogonies autochtones, l’eau est l’origine du monde, l’élément de la gestation primordiale. Enfin, politique : ces pratiques témoignent d’une autonomie des femmes et d’une transmission des savoirs obstétriques féminins, souvent effacés par la colonisation et la médicalisation forcée.
Aujourd’hui, ces traditions font l’objet d’un regain d’intérêt. Dans plusieurs communautés autochtones du Pérou, du Canada ou du Mexique, des sages-femmes traditionnelles revendiquent le droit de pratiquer les accouchements dans l’eau, en lien avec la culture de leurs ancêtres. Elles collaborent parfois avec des professionnels de santé pour assurer la sécurité des mères, tout en respectant leurs choix. Des collectifs comme “Indigenous Birth of Alberta” ou des réseaux de parteras autónomas en Amérique latine participent à cette renaissance culturelle et médicale.
Loin d’être une invention moderne occidentale, comme on le croit parfois, l’accouchement dans l’eau a des racines profondes dans les cultures amérindiennes. Il témoigne d’un rapport au corps, à la terre et au sacré qui pourrait bien enrichir les pratiques obstétricales contemporaines.
Dans une époque où la naissance est trop souvent médicalisée à outrance, retrouver le sens de l’eau comme espace de vie et de passage pourrait être une leçon d’humanité venue des peuples premiers.
*conomiste et chroniqueur