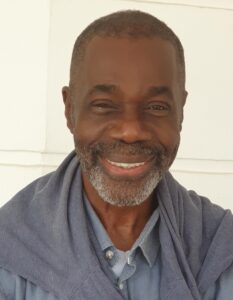PAR JEAN-MARIE NOL*
La France traverse aujourd’hui une période de bouleversements profonds, marquée par une montée vertigineuse de la délinquance, une explosion des arnaques numériques, une insécurité grandissante, et une pression migratoire constante.
Ces dynamiques, longtemps sous-estimées ou volontairement ignorées par une écrasante majorité des hommes et femmes politiques et une grande partie de l’élite intellectuelle française, dessinent les contours d’une crise de société majeure. Et pourtant, face à cette mutation rapide, ce qui frappe autant que les chiffres eux-mêmes, c’est le silence, la cécité, voire la déconnexion d’une intelligentsia française incapable d’anticiper, d’interpréter, ou d’alerter sur les conséquences de ce changement de paradigme pourtant prévisible.
Ces gens n’ont malheureusement rien vu venir. Cette carence intellectuelle, morale, éthique et politique laisse aujourd’hui le champ libre aux extrémismes de tout ordre et à l’émergence potentielle d’un régime autoritaire, qui pourrait apparaître aux yeux d’un nombre croissant de citoyens comme la seule réponse crédible à un désordre devenu structurel.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2024, la France a enregistré 47 144 vols de voitures, dans un contexte où 70 459 véhicules ont été signalés disparus. Une hausse de 5 % en un an, dans un pays qui prétend pourtant maîtriser ses flux criminels. Mais derrière ces statistiques se cache une réalité bien plus inquiétante : celle d’un réseau structuré, international, qui relie les banlieues françaises aux marchés de revente en Europe de l’Est et en Afrique de l’Ouest.
Ce n’est plus l’œuvre de délinquants isolés, mais d’une industrie parallèle opérant en marge de l’État, sapant l’autorité publique et la confiance dans les institutions. Pendant que certaines figures médiatiques continuent à disserter sur les effets supposés de l’ubérisation de la société, les filières mafieuses prospèrent, transportant dans leurs soutes des symboles de l’impuissance française.
Et ce n’est là qu’un aspect de la spirale. En 2021, la France a enregistré 149 800 escroqueries numériques. Un record. Un tiers des Français a déjà été victime de cybercriminalité. Les arnaques financières se sont transformées en un phénomène de masse, avec plus de 1,5 million de victimes. L’Autorité des marchés financiers reconnaît une explosion des fraudes à l’investissement, trois fois plus fréquentes qu’en 2021.
Or ces escroqueries ne sont pas seulement le signe d’une vulnérabilité technologique ; elles traduisent aussi une faillite morale et intellectuelle : celle de penseurs, de technocrates, d’universitaires et de commentateurs trop souvent enfermés dans des cadres théoriques obsolètes, incapables de comprendre que la violence contemporaine ne se manifeste plus uniquement par le sang, mais aussi par les circuits numériques, les faux profils, les plateformes fantômes et les appels à la crédulité de populations désorientées.
Cette violence est multiple et est demain appelé à se développer avec l’ère de l’intelligence artificielle, et la robotisation. Mais aujourd’hui, elle s’incarne également dans les statistiques criminelles les plus dures. Les homicides en France sont passés de 816 en 2020 à plus de 1 010 en 2023. Trois morts violentes par jour, dans une société que l’on disait autrefois civilisée. De plus, le développement du narco-traffic est déja devenu incontournable et incontrôlable gangrenant les quartiers.
Comment expliquer que cette progression n’ait suscité aucun sursaut véritable, aucune mobilisation profonde de la part de ceux qui se réclament de la raison, de l’universalisme, ou de la défense du pacte républicain ? La montée des violences, loin d’être perçue comme un symptôme alarmant, est souvent relativisée, diluée dans des débats abstraits ou réinterprétée à travers des grilles de lecture idéologiques qui déconnectent la réalité de la parole publique.
Qu’on le veuille ou non, on ira vers un durcissement des lois et un régime pénitencier beaucoup plus dur, c’est là le résultat de la poussée de la violence et de l’évolution à droite de la société française. Le reste est du verbiage stérile et sans véritable repère idéologique du fait d’une perte de boussole.
Un autre point de rupture réside dans l’immigration. En 2023, la France comptait 7,3 millions d’immigrés, soit 10,7 % de la population. La proportion de personnes issues de l’immigration parmi les populations pauvres (42 %) ou détenues (jusqu’à 60 %, selon certaines sources) alimente un malaise croissant.
Ces données, souvent taboues, sont jugées inexploitables ou dangereuses par une frange du monde académique, qui préfère éviter les corrélations jugées « stigmatisantes ». Pourtant, il ne s’agit pas ici de juger des individus, mais de constater des tendances, d’alerter sur des déséquilibres sociétaux majeurs, et surtout, d’exiger un débat franc, rationnel et sans dogmatisme.
Car il faut dire les choses clairement : les conséquences économiques, sociales et sécuritaires d’une immigration insuffisamment maîtrisée sont réelles. Le surcoût pour les finances publiques est estimé à près de 30 milliards d’euros (19,4 milliards en prestations, 10,8 en aides diverses). Le chômage frappe encore deux fois plus les immigrés que les non-immigrés.
Et le nombre d’étrangers détenus a augmenté de 79 % en vingt ans. Ces réalités ne peuvent plus être balayées d’un revers de main au nom d’une vision idéalisée de l’accueil ou de la solidarité. Loin d’honorer leurs fonctions, nombre d’intellectuels, notamment en vertu d’une posture économique et sociale sur la thématique de l’immigration, dans leur tour d’ivoire, ont préféré adopter une posture morale plutôt qu’une approche factuelle. Ils ont déserté le champ de la lucidité.
Cette faillite intellectuelle est lourde de conséquences. Elle alimente la défiance à l’égard des élites, la tentation du repli, la radicalisation du débat public. Une partie croissante de la population n’attend plus rien des institutions classiques – ni de la gauche, ni de la droite, ni des experts autoproclamés.
Elle cherche désormais des figures d’autorité, des discours simples, des promesses d’ordre. Dans ce contexte, le risque de basculement vers un régime autoritaire n’est plus une hypothèse lointaine : il devient un horizon probable, porté par la question de l’identité française, la lassitude, l’angoisse, et le sentiment d’abandon.
Car la société française, aujourd’hui, n’est plus tenue que par des liens fragiles. Si les intellectuels continuent à nier la réalité, s’ils persistent à brandir des concepts au lieu de regarder les faits, alors ils ne feront pas seulement preuve de cécité. Ils deviendront complices, par passivité ou par arrogance, de l’effondrement démocratique qui s’annonce.
Il est encore temps de réveiller les consciences. Mais il faut pour cela renoncer aux illusions, affronter les vérités désagréables et retrouver le courage de nommer ce qui dérange. Sans quoi, l’histoire retiendra que ceux qui devaient éclairer le chemin ont préféré éteindre la lumière.
Antonio Gramsci écrivait : « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Cette formule résonne aujourd’hui avec une acuité troublante dans le contexte français.
Le vieux monde – celui de la paix sociale garantie, de l’État-providence protecteur et de la confiance envers les institutions – vacille. Mais aucun projet cohérent, ni aucune vision partagée ne semblent émerger pour lui succéder.
Dans cet entre-deux, ce vide laissé par des intellectuels dépassés ou volontairement aveugles, s’installent le désordre, la peur, et les discours de rupture. Ce sont ces monstres contemporains – désinformation, extrémisme, désespoir civique – qui prospèrent dans l’ombre de cette cécité.
En effet, c’est à partir de 1970 qu’un nouveau cycle s’instaure au sein de la société française après les événements de mai 68, La France, faute d’avoir été pensée lucidement à temps dès les années 70, court désormais le risque d’être gouvernée non plus par la raison, mais par la force.
*Economiste et chroniqueur