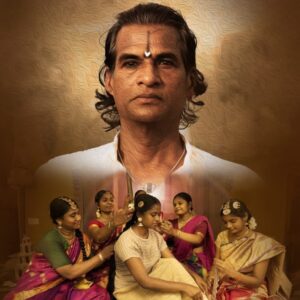PAR JEAN-MARIE NOL*
Alors que la Guadeloupe continue de projeter l’image séduisante d’un paradis tropical baigné de soleil, d’eaux cristallines et de plages de carte postale, une réalité bien plus sombre gagne du terrain, à savoir que le changement climatique va profondément impacter le modèle économique du tourisme en Guadeloupe.
Derrière le vernis d’une destination encore prisée par les touristes, notamment hexagonaux, se dessine un processus lent mais inéluctable de transformation profonde du modèle touristique de l’archipel. Cette mutation n’est pas dictée par un choix volontaire, mais imposée par une force bien plus puissante et implacable : le changement climatique.
Ce dernier ne se contente plus d’être une perspective lointaine évoquée par les experts, il s’invite désormais dans le quotidien de l’activité touristique guadeloupéenne, en modifie les contours et en érode silencieusement les fondements.
La Guadeloupe, longtemps perçue comme une destination phare du tourisme tropical français, voit peu à peu s’effriter les fondements de son modèle économique touristique sous les assauts conjugués du changement climatique, de l’insécurité , de la conjoncture économique mondiale et des limites structurelles de son territoire.
Alors que l’archipel continue de séduire par ses paysages idylliques et ses plages de sable fin, une réalité plus inquiétante s’impose : celle d’une mutation inexorable du tourisme, poussée non par une stratégie concertée mais par une urgence climatique désormais tangible. Les chiffres sont sans appel.
La haute saison touristique 2025 a enregistré un net repli : près de 10 % de nuitées hôtelières en moins par rapport à l’année précédente. Ce recul, qui affecte aussi bien la clientèle française qu’internationale, s’explique par la hausse des prix des billets d’avions, une volonté d’épargne sans précédent à cause de la crise, un climat économique anxiogène, mais aussi par une évolution des comportements touristiques face aux désagréments climatiques croissants.
En mars, malgré une hausse des arrivées à l’aéroport de Pointe-à-Pitre, la durée moyenne des séjours diminue, symptôme d’une désaffection partielle et d’un inconfort grandissant. La Guadeloupe, comme nombre de territoires tropicaux, voit les piliers mêmes de son attractivité – qualité des eaux, beauté du littoral, climat agréable – se fissurer sous l’effet du réchauffement climatique.
Les sargasses, emblèmes malgré elles de cette nouvelle ère, envahissent régulièrement les plages, asphyxiant l’activité hôtelière et ternissant l’image de carte postale des plages. L’érosion côtière, la montée des eaux et la recrudescence des tempêtes fragilisent les infrastructures en bord de mer, appelant à des réaménagements coûteux et complexes.
Face à ce cocktail de menaces, les réponses peinent à émerger, faute de moyens, de coordination et de vision partagée. Au-delà de la crise environnementale, d’autres signaux viennent assombrir les perspectives : les effets du ralentissement économique mondial, la perte de compétitivité face à d’autres destinations plus résilientes comme Saint Domingue, et désormais le spectre de l’insécurité liée au narco-trafic.
Selon l’Insee, l’activité économique en Guadeloupe marque le pas au début de l’année 2025. Les indicateurs sont dans le rouge, avec un ralentissement notable de la croissance et une baisse de l’emploi. Le climat d’incertitude mondial, exacerbé par l’entrée en fonction de Donald Trump aux États-Unis, pèse sur les échanges et les investissements.
Le contexte hexagonal n’est pas plus favorable : la France métropolitaine entre en phase de contraction économique et de crise de la dette , affectant directement les dépenses de consommation et donc le tourisme.
Un recul marqué des nuitées hôtelières
La haute saison touristique avait pourtant bien démarré fin 2024, laissant espérer une reprise dans ce secteur clé. Mais, les chiffres du premier trimestre 2025 ternissent cet optimisme. Le nombre de nuitées hôtelières chute de près de 10 %, avec 397 400 nuitées comptabilisées, soit 40 300 de moins que l’an dernier. Les Français, majoritairement représentés parmi les visiteurs, se montrent plus réticents à voyager. Une tendance motivée par une volonté d’épargne historique, inégalée depuis 1945, selon l’institut.
Des séjours plus courts et une clientèle moins présente à cause de la distribution chaotique de l’eau dans les robinets.
La clientèle internationale recule elle aussi, bien que de manière moins marquée. Le taux d’occupation hôtelier diminue, s’établissant à 74,6 %. En parallèle, les arrivées à l’aéroport de Pointe-à-Pitre-Maryse-Condé progressent de 5 points en mars, illustrant un paradoxe : plus de touristes arrivent, mais ils restent moins longtemps. La durée moyenne des séjours passe de 4,3 à 4 jours.
Le tourisme est par nature une activité extrêmement dépendante de la qualité de l’environnement. Soleil, douceur du climat, beauté des paysages, accessibilité du littoral, qualité des eaux, biodiversité intacte, sécurité du territoire : autant de critères qui fondent l’attractivité d’une destination.
Or, tous ces piliers vacillent. Selon l’Institut de l’économie pour le climat, le tourisme figure parmi les secteurs les plus exposés aux effets du dérèglement climatique.Le phénomène le plus visible — et peut-être le plus symbolique — est celui des sargasses. Ces algues brunes venues du large échouent en masse sur les côtes guadeloupéennes, envahissant les plages, dégageant des gaz toxiques et mettant à mal l’image paradisiaque des stations balnéaires. Des communes entières comme Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Terre de haut ou encore La Désirade en sont victimes.
L’activité hôtelière y est lourdement impactée. Les touristes, souvent désorientés par la vision de plages impraticables et l’odeur insupportable des algues en décomposition, écourtent leurs séjours ou choisissent d’autres destinations. À cela s’ajoute la difficulté pour les communes à organiser efficacement la collecte et le traitement de ces volumes d’algues, faute de moyens, de coordination et de solutions pérennes.
Les appels lancés par les élus locaux pour une application rapide des plans Sargasses 1 et 2 témoignent d’un sentiment d’abandon financier de l’État croissant, et d’une urgence qui devient structurelle.
Mais les sargasses ne sont qu’un aspect d’une problématique plus vaste. Environ 30 % du trait de côte guadeloupéen est aujourd’hui menacé par l’érosion, la montée du niveau de la mer et la recrudescence de tempêtes extrêmes. Ces phénomènes fragilisent directement l’infrastructure touristique du bord de mer, où sont concentrés la majorité des hôtels, restaurants, clubs nautiques et activités balnéaires.
À moyen terme, certains bâtiments devront être déplacés, relocalisés ou abandonnés. Cette reconfiguration spatiale du tourisme est inédite dans l’histoire moderne de l’archipel et suppose des investissements colossaux, une planification rigoureuse, et surtout une volonté politique ferme. Les collectivités locales, déjà sous pression budgétaire, ne pourront mener seules cette transformation. Elle exige une réponse systémique et coordonnée.
Le bouleversement climatique entraîne également des répercussions sur les flux touristiques eux-mêmes. Les canicules à répétition dans les pays européens incitent désormais certains voyageurs à rechercher des climats plus tempérés, au détriment des destinations tropicales traditionnellement plébiscitées. Une étude du Joint Research Center européen montre que des pays comme le Royaume-Uni, la Scandinavie ou les régions alpines pourraient devenir des lieux touristiques de substitution.
Ce basculement géographique entraîne un double effet : non seulement la Guadeloupe pourrait perdre une part de son public cible, mais en plus, la saisonnalité de la fréquentation pourrait être profondément modifiée, rendant plus difficile encore la gestion des flux et la rentabilité des structures touristiques.
Enfin, un facteur encore peu abordé mais de plus en plus pesant vient assombrir le tableau : l’insécurité. La montée du narco-trafic, avec son cortège de violences, de criminalité et d’instabilité sociale, altère progressivement l’image d’une île sûre et accueillante. Ce climat anxiogène pourrait dissuader certains touristes, notamment les familles, de choisir la Guadeloupe comme destination de vacances.
Car le tourisme ne repose pas seulement sur le cadre naturel, il se nourrit aussi de la perception de sécurité, de convivialité, de confiance. Une destination jugée instable devient vite une destination à éviter, et ce, même si ses paysages restent sublimes.
Face à l’ensemble de ces défis, l’inaction n’est plus une option. Il faut repenser en profondeur le modèle touristique guadeloupéen. Et lorsque les territoires concernés ne mettent pas en œuvre rapidement des politiques d’adaptation, c’est leur viabilité économique qui est mise en péril. Loin d’être un simple effet conjoncturel, l’essoufflement que traverse le tourisme guadeloupéen est systémique.
Elle appelle une remise à plat en profondeur du modèle en vigueur. Il ne s’agit plus de s’adapter à la marge, mais de repenser l’offre dans sa globalité. Il faut diversifier les usages, sortir du tout-balnéaire, miser sur l’écotourisme, le tourisme médical, le tourisme de santé avec la thalassothérapie et la balnéothérapie, le tourisme culturel. Il s’agit également de valoriser l’intérieur de l’île, les savoir-faire locaux, les patrimoines invisibles, dans une logique de durabilité et de résilience.
Cette refondation ne pourra réussir sans une volonté politique forte, une implication active des acteurs économiques et sociaux, et une adhésion collective des populations. Les solutions existent, les initiatives aussi, mais elles ne prendront sens qu’au sein d’une stratégie d’ensemble, lucide, partagée et ambitieuse.
Car à défaut de se transformer à temps, la Guadeloupe risque de voir son attractivité se dissoudre, lentement mais sûrement, dans les remous d’un monde en transition accélérée. Car le risque est bien réel : si la Guadeloupe continue de s’accrocher à un modèle touristique vulnérable, climatiquement exposé et économiquement fragile, elle s’expose à une marginalisation progressive sur la carte mondiale des destinations.
Les images de cocotiers et de lagons turquoise risquent alors de devenir les vestiges nostalgiques d’un âge d’or révolu, balayé par les vents chauds du dérèglement climatique.
*Economiste