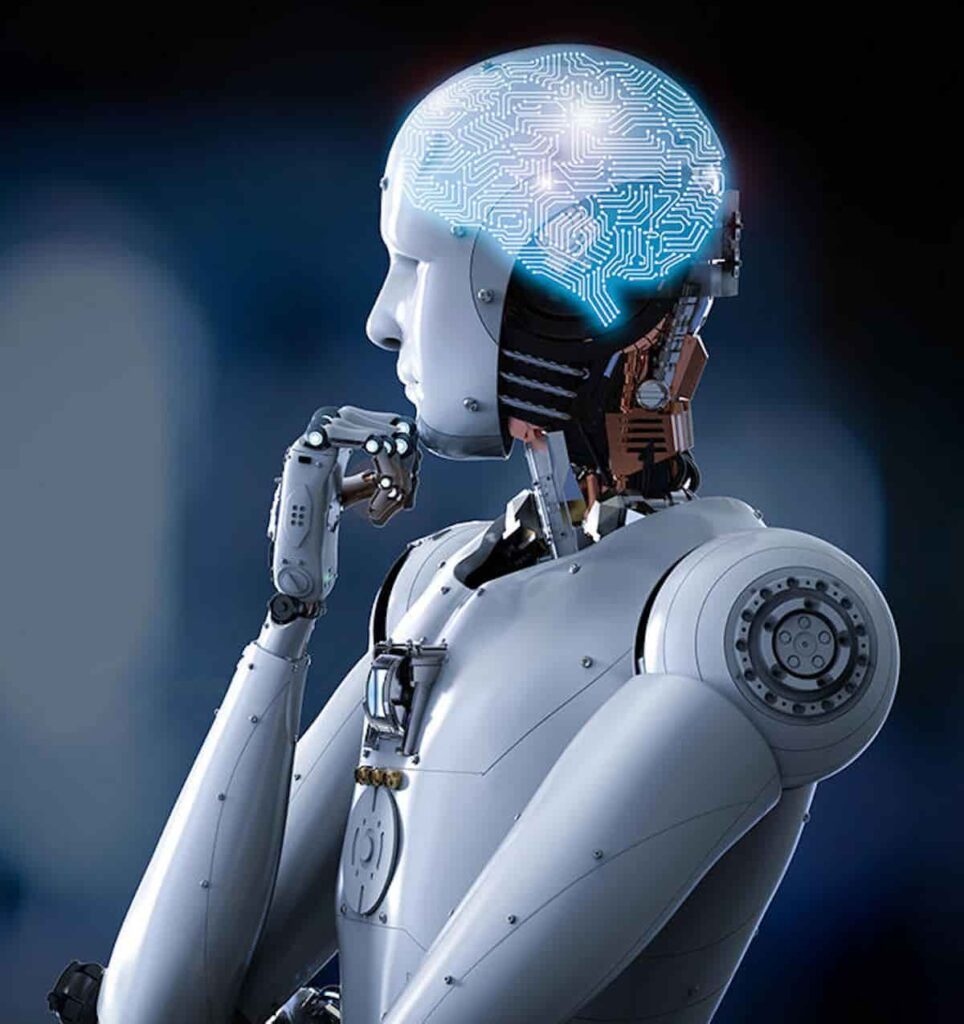PAR JEAN-MARIE NOL*
D’ici 5 ans, 30 % des employés de la Guadeloupe seront remplacés par des IA » et cela devrait susciter la frayeur des travailleurs inquiets pour leur avenir et l’inquiétude des acteurs économiques et sociaux sur les conséquences du climat social avec la dégradation du tissu sociétal.
Alors que l’intelligence artificielle s’immisce dans tous les secteurs, les entreprises dans le monde se préparent à une transformation radicale de leurs effectifs, remplaçant progressivement les employés humains par des systèmes automatisés.Dans un monde en perpétuelle mutation, où la vitesse des bouleversements technologiques dépasse notre capacité d’adaptation, la Guadeloupe risque de se retrouver face à une rupture économique majeure.
Et force est de souligner que l’une des seules parade envisageable est la mise en œuvre immédiate de la création par l’État et le conseil régional d’un réseau d’entreprises de transformation de type agroalimentaire. À l’intersection de la révolution numérique, de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotisation, l’archipel voit se dessiner un avenir incertain, porteur autant de risques que d’opportunités. Les lignes de force de l’économie locale, longtemps structurées autour du secteur tertiaire, de la fonction publique et du tourisme, seront désormais ébranlées par des forces nouvelles, globales, qui ne laissent aucune marge à l’immobilisme, et à la naïveté.
Dans un monde professionnel en pleine mutation, l’intelligence artificielle promet des gains de productivité, mais d’après une étude soulève également des questions cruciales sur l’isolement et le bien-être des employés.
Le surgissement fulgurant de l’intelligence artificielle dans tous les pans de la société remet en cause des certitudes longtemps jugées inébranlables. Ce qui relevait encore récemment de la science-fiction devient réalité dans les services publics, la santé, la justice, les collectivités territoriales ou encore la sécurité.
En Guadeloupe, l’État à la suite d’expérimentations déjà en cours dans l’hexagone va bientôt introduire progressivement des outils intelligents pour automatiser des tâches autrefois humaines : saisie de données, rédaction de courriers, relation avec l’usager. L’apparition d’agents conversationnels comme « Albert » ou d’outils comme « Alicem » s’inscrit dans une logique d’efficacité, mais cette quête de performance pourrait se heurter à une réalité sociale locale bien plus fragile. Dans ces territoires où la fonction publique constitue un pilier économique, l’automatisation soulève des inquiétudes légitimes : que deviendront ces postes à faible qualification qui assurent, aujourd’hui encore, un semblant d’équilibre social ?
Si 82 % des tâches administratives sont potentiellement automatisables, l’impact sur l’emploi tertiaire — et particulièrement sur l’emploi féminin — s’annonce redoutable. Quand à la situation de ceux des employés et cadres qui continueront à utiliser l’intelligence artificielle, elle va s’avérer très bientôt délicate. L’IA générative peut augmenter la productivité, mais elle risque d’accroître le sentiment de solitude au travail.
Les employés utilisant intensivement l’IA sont plus susceptibles de ressentir un isolement social.
Un isolement accru peut mener à des problèmes de santé mentale comme l’insomnie ou le burnout.
De fait, les entreprises et les fonctions publiques devront repenser l’organisation du travail pour équilibrer technologie et interactions humaines.
L’intelligence artificielle ne s’arrête pas aux seules fonctions routinières. Son pouvoir de transformation est total, s’infiltrant désormais dans les métiers créatifs, éducatifs et décisionnels. Des professions naguère préservées — artistes, médecins , enseignants, avocats — se découvrent vulnérables. La machine peut écrire, composer, prédire, analyser. Elle remet en cause la place même de l’humain dans l’acte de créer, de transmettre, de juger.
En Guadeloupe, cette mutation s’impose dans un contexte déjà marqué par un chômage structurel élevé, une jeunesse en perte de repères professionnels et une économie ultra-dépendante du secteur public. La déstabilisation de nombreux métiers, déjà fragiles, pourrait aggraver les déséquilibres sociaux, renforcer les inégalités et nourrir un sentiment de déclassement généralisé.
Il serait pourtant simpliste de réduire uniquement l’IA à une menace. Car bien pensée, bien encadrée, elle peut aussi être un levier de transformation vertueuse. Elle peut soulager les travailleurs des tâches ingrates, optimiser les processus, accroître la productivité et améliorer la qualité de service. Elle peut même pallier certaines contraintes de l’insularité, en renforçant la compétitivité des entreprises locales.
Encore faut-il que des gardes-fous et qu’un encadrement fort soit mis en place. Former les jeunes et les moins jeunes, investir dans les compétences numériques, développer une culture du discernement technologique : voilà les conditions d’un usage éclairé de cette révolution. L’enjeu n’est pas seulement économique, il est aussi culturel, psychologique, éthique.
Car dans une société guadeloupéenne attachée au lien humain, à l’échange oral, à la chaleur relationnelle, le risque est grand de céder à l’illusion d’une IA empathique, alors même qu’elle n’est que le reflet froid d’algorithmes sans conscience et sans état d’âme .
Mais c’est dans le secteur du tourisme — cœur battant de l’économie guadeloupéenne — que les effets de la robotisation s’annoncent les plus spectaculaires. Le taux d’occupation des hôtels recule, les exigences des touristes évoluent, les plateformes numériques et les résidences hôtelières bouleversent l’offre d’hébergement. Face à la pression concurrentielle, les établissements guadeloupéens n’auront d’autre choix que de s’adapter. Or, dans un contexte où le coût du travail est particulièrement élevé, la tentation de remplacer des employés par des robots devient une évidence économique.
Le modèle du personnel robotique disponible 24h/24, sans congé ni pause, sans risques de processus de grève, programmable, multilingue, précis et rentable s’impose peu à peu. Le ménage, la réception, le service en chambre, voire l’animation ou le massage peuvent désormais être assurés par des entités robotisées. Ce qui se joue ici n’est pas un simple progrès technique, mais un bouleversement de la structure même du marché du travail guadeloupéen.
Dans un monde en accélération constante, où la technologie transforme les paradigmes à un rythme effréné, la Guadeloupe se trouve à la croisée des chemins d’une mutation du travail sans précédent . Entre des fondamentaux économiques fragiles, une démographie en mutation et un modèle de développement en question, le territoire doit aujourd’hui se confronter à une réalité technologique aux conséquences irréversibles. L’automatisation, portée par l’intelligence artificielle et la robotique, n’est plus un concept de science-fiction ou une tendance lointaine ; elle s’installe concrètement dans des secteurs jusque-là préservés.
L’un des plus emblématiques est sans conteste celui de l’hôtellerie, pilier historique du tourisme guadeloupéen et levier économique majeur. Mais ce pilier vacille, et avec lui, c’est une part entière de l’économie insulaire qui s’apprête à être redéfinie.
Depuis quelques années, les signaux d’alerte s’accumulent. La baisse progressive du taux d’occupation hôtelier, désormais fixé autour de 65 % en 2024, témoigne d’une érosion lente mais continue de l’attractivité de l’offre traditionnelle d’hébergement. Ce recul ne s’explique pas uniquement par des facteurs conjoncturels comme les crises sanitaires ou l’instabilité géopolitique : il est aussi le reflet d’un profond changement de comportement des voyageurs, d’une montée en puissance des plateformes de location de courte durée tel R Be and Be , mais surtout d’une exigence nouvelle en matière de service, d’instantanéité, de personnalisation et de confort. Or, pour répondre à cette exigence, les établissements guadeloupéens sont contraints de se réinventer dans un contexte où le coût de la main-d’œuvre, encadré par des normes sociales françaises élevées, pèse lourdement sur la rentabilité des structures.
C’est ici que la robotisation s’impose comme une réponse quasi inéluctable. La question n’est plus de savoir si les robots viendront un jour travailler dans les hôtels guadeloupéens, mais plutôt comment et à quel rythme ils remplaceront quasiment toutes les fonctions humaines. Les exemples étrangers sont légion et préfigurent ce basculement. En France hexagonale , des établissements testent déjà des robots pour assurer le ménage, le service en chambre ou même les massages.
Aux États-Unis, des cafés entièrement automatisés comme le CafeX de San Francisco n’emploient que deux humains pour des tâches à forte valeur ajoutée, le reste étant assuré par des machines programmées, rapides, fiables et disponibles 24 heures sur 24. Le Japon, quant à lui, a franchi un seuil culturel et technologique où le robot n’est plus un simple outil mais un collaborateur à part entière, que ce soit dans les hôtels, les maisons de retraite ou les foyers privés.
Là-bas, il est perçu non pas comme une menace pour l’emploi mais comme un partenaire au service du bien-être collectif au vu du manque de main d’oeuvre et de vieillissement de la population du Japon .
La Guadeloupe, confrontée à un coût du travail structurellement élevé, à une pénurie chronique de main-d’œuvre qualifiée , et à des difficultés croissantes de recrutement dans le secteur touristique, pourrait bien être contrainte de suivre ce modèle. La robotisation apparaît comme une solution rationnelle : elle permet une efficacité accrue, une rationalisation des coûts, une réduction des erreurs humaines et une disponibilité continue des services, le tout dans un cadre où l’exigence de rentabilité devient vitale pour la survie des petites et moyennes structures hôtelières.
D’autant plus que les outils technologiques actuels sont de plus en plus performants, adaptatifs et capables de dialoguer avec les clients dans plusieurs langues, grâce à la reconnaissance vocale et à l’intelligence artificielle embarquée.
Mais cette mutation ne sera pas neutre. Elle remettra profondément en cause les fondamentaux de l’économie guadeloupéenne fondée jusqu’à présent sur un modèle à forte intensité de main-d’œuvre dans le secteur tertiaire et sur des logiques d’emploi public et parapublic comme amortisseur social. Si demain les hôtels guadeloupéens n’ont plus besoin de réceptionnistes, de femmes de chambre, de serveurs ou de bagagistes humains, que deviendront ces milliers d’emplois en CDI ou précaires qui constituent aujourd’hui une part importante du tissu économique local ?
Le basculement vers une économie automatisée risque d’accentuer les inégalités sociales et les tensions identitaires si aucune stratégie d’anticipation n’est mise en place, dans la mesure où le risque sera assurément une accélération du processus de remplacement de la main d’œuvre locales par des travailleurs venus d’horizons étrangers.
Il faut donc, dès à présent, intégrer cette révolution dans une réflexion stratégique de moyen – long terme. La prospective n’a jamais été aussi nécessaire. Il s’agit de penser des modèles économiques nouveaux, où les humains se repositionnent sur des fonctions de pilotage, d’accompagnement, de créativité ou de relation client à forte valeur ajoutée.
Cela suppose une transformation en profondeur du modèle économique et des systèmes de formation, une adaptation des politiques publiques d’emploi, mais aussi un changement de regard sur le travail et la technologie.
La Guadeloupe a toujours été contrainte à l’adaptation. Mais l’échéance qui se profile avec la montée en puissance de la robotisation n’est pas un simple ajustement conjoncturel. C’est un changement structurel, qui obligera à redéfinir non seulement les bases du tourisme, mais plus largement les piliers de l’économie guadeloupéenne que sont les emplois du secteur public . Dans ce contexte, l’inaction ou l’attentisme seraient les pires choix. Se préparer avec lucidité, prendre des décisions courageuses et anticiper plutôt que subir : telle est l’exigence qui s’impose aujourd’hui si l’on veut que l’avenir économique du territoire reste une promesse pour la jeune génération et non une menace.
Car derrière cette mutation, c’est un modèle économique complet de l’ère de la départementalisation qui vacille. Quelle sera la place des jeunes sans qualification, déjà exclus du marché du travail ? À défaut d’anticipation, la robotisation pourrait se traduire par une brutale aggravation des fractures sociales et identitaires, creusant encore plus l’écart entre une minorité technophile intégrée à l’économie mondialisée et une majorité reléguée dans les marges du progrès et qui sera en butte à une recrudescence de troubles mentaux.
Une étude récente, publiée dans le Journal of Applied Psychology, met en lumière les risques potentiels liés à l’ de l’IA et de la robotisation intensive. En cherchant à être plus efficaces, les employés pourraient se retrouver isolés et épuisés. Le sentiment d’isolement engendré par l’IA ne s’arrête pas là. Il peut entraîner des conséquences graves pour la santé mentale et physique des employés et cadres . L’étude observe une augmentation des cas d’insomnie et une consommation d’alcool et de drogues accrue chez les travailleurs se sentant isolés. Ce cercle vicieux peut conduire à l’épuisement professionnel, connu sous le nom de burnout ou encore « Blow brains out « littéralement » brûler le cerveau « .
Le défi sociétal est donc immense. Il ne peut être relevé que par une stratégie d’ensemble, lucide et volontariste. Il faut repenser les filières de formation, orienter les investissements vers le secteur d’activité de la production et l’innovation inclusive, développer des écosystèmes territoriaux capables d’accompagner cette transition. Il faut également poser un cadre éthique clair, définir des seuils d’acceptabilité, préserver l’humain là où sa valeur ajoutée reste irremplaçable : dans l’accueil, l’émotion, la créativité, le soin, l’écoute.
La Guadeloupe ne pourra pas faire l’économie de cette réflexion. Car la mutation est déjà là. Silencieuse, diffuse, mais irréversible. Elle redessine nos usages, nos attentes, nos métiers, nos identités.
Refuser d’y faire face serait un suicide collectif. Mais y répondre sans vision, sans boussole, serait tout aussi dangereux. Il ne s’agit pas de choisir entre le progrès ou le déclin, mais de décider de la forme que prendra notre modernité. Dans cette bataille mondiale où se joue l’avenir du travail, de la culture, du lien social, la Guadeloupe a une carte à jouer. Elle doit faire de son insularité non pas une faiblesse, mais un laboratoire d’expérimentation. Elle doit affirmer que la technologie, si elle est au service de l’humain, peut être un levier de justice, de résilience, de prospérité.
À condition de ne jamais perdre de vue l’essentiel : ce n’est pas le changement statutaire qui pourrait enrayer l’impact catastrophique pour l’emploi local et permettre d’amortir le choc des réalités technologiques, sans aucun moyen financier des collectivités. Et force est d’admettre que c’est l’existence d’une vision prospective de changement de modèle de développement économique et social qui devrait nécessairement être accompagné de ressources financières beaucoup beaucoup plus importantes de l’État pour pallier les conséquences prévisibles de cette mutation dans la décennie actuelle.
Et rappelons-nous une fois encore les mots célèbres du philosophe grec Sénèque : « il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ! »
*Economiste