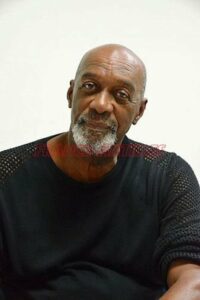PAR JEAN-MARIE NOL*
La France traverse actuellement une période de crise que ne saurait régler le nouveau Premier ministre Sébastien lecornu sans des réformes structurelles profondes. Alors attention aux non dits de la politique française qui menacent directement l’équilibre économique et social de la Guadeloupe .
La chute du gouvernement de François Bayrou, emporté par un vote de confiance perdu, a brutalement rappelé à quel point la question du financement du modèle social français est désormais au cœur des fragilités politiques du pays. En réalité, ce revers politique dépasse la seule trajectoire d’un Premier ministre : il symbolise l’incapacité récurrente des gouvernements successifs à affronter de front le problème de la dette publique et à poser la question taboue de la réforme de l’État providence.
La crise politique et institutionnelle actuelle a mis en pleine lumière une vérité que la classe politique française n’ose pas affronter : le modèle social, tel qu’il fonctionne aujourd’hui, n’est plus finançable. Derrière la récente nomination d’un nouveau Premier ministre se dessine une impasse structurelle qui dépasse les aléas partisans.
Avec une dette publique dépassant 3 300 milliards d’euros, des déficits chroniques et des charges d’intérêts appelées à concurrencer dès 2026 les budgets de la santé ou de l’éducation, la France vit à crédit et entretient l’illusion d’un État providence sans limite. Chaque hésitation politique devient un signal d’alerte pour les marchés, mais aussi un avertissement pour les citoyens qui dépendent directement de ce système.
Ce constat a des résonances particulièrement fortes en Guadeloupe, où les transferts sociaux constituent une part essentielle des revenus de la population. Plus de 140 000 foyers bénéficient des prestations de la CAF pour près d’un milliard d’euros par an, et le RSA touche proportionnellement trois fois plus de personnes que dans l’Hexagone. Ces aides, vitales pour 27 % de Guadeloupéens vivant sous le seuil de pauvreté, assurent une protection immédiate mais traduisent aussi une dépendance préoccupante. Elles compensent l’absence de perspectives économiques durables, le chômage massif et l’exode des jeunes, mais risquent de figer la société dans un équilibre fragile, exposée au moindre ajustement budgétaire décidé à Paris.
L’équation est redoutable : réduire le champ des aides, c’est fragiliser encore davantage un tissu social déjà précaire ; les maintenir au prix d’un endettement croissant, c’est aggraver la vulnérabilité financière de l’État. La Guadeloupe illustre de façon grossissante les dilemmes nationaux : préserver la justice sociale ou restaurer la soutenabilité budgétaire, renforcer la solidarité ou encourager l’activité, vivre de la redistribution ou produire davantage de richesses. La vérité est que l’État providence, conçu comme une digue contre les inégalités, repose sur des fondations fissurées : sans croissance réelle et sans réformes profondes, il ne peut résister indéfiniment à la pression des marchés et à l’ampleur de la dette.
La crise actuelle n’est pas seulement budgétaire, elle est aussi politique. La démission forcée de François Bayrou illustre l’incapacité du pays à engager une réforme courageuse de l’État providence face aux résistances des partis, des corporatismes et de l’opinion publique. Chaque blocage accroît le risque d’instabilité et retarde les décisions nécessaires. Pourtant, l’urgence est manifeste : la redistribution absorbe déjà plus de 40 % du PIB, et les charges de la dette risquent bientôt d’étouffer la capacité de l’État à financer ses missions essentielles.
Pour les Outre-mer, et particulièrement la Guadeloupe, l’enjeu est vital. Là où la métropole peut compter sur un tissu économique diversifié et des opportunités d’emploi plus larges pour amortir un choc social, les Antilles n’ont pas les mêmes marges.
Une baisse des aides aurait des effets immédiats et potentiellement explosifs, accentuant le risque de fracture entre l’Hexagone et ses territoires périphériques. À l’inverse, leur maintien intégral dans un contexte de dette insoutenable prolongerait une dépendance qui empêche toute dynamique de développement autonome.
La France est donc à un tournant décisif. Soit elle redéfinit son modèle social en conciliant équité et soutenabilité financière, soit elle s’expose à voir son État providence vaciller, avec des répercussions disproportionnées sur les territoires ultramarins.
La chute de François Bayrou n’est peut-être que le premier acte visible de cette vérité dérangeante : l’heure de vérité approche, et avec elle, le risque d’une crise sociale et financière majeure dont le mandat de Sébastien Lecornu pourrait être l’épicentre. En ces temps d’aveuglement volontaire, rappeler que le problème n’est pas un excès de solidarité mais un déficit de production et de travail relève presque d’un acte de lucidité révolutionnaire.
Comme le disait George Orwell : « En ces temps d’imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. »
*Economiste et juriste en droit public