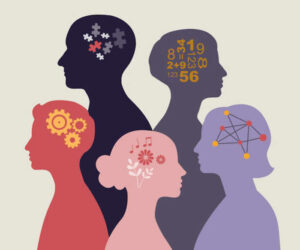Camille Pelage, président de la Commission Bleue au Conseil régional de Guadeloupe, et Jules Otto, maire de Vieux-Habitants, étaient présents au 44e Congrès de l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL) à Bonifacio en Corse du Sud.
Pour son 44ᵉ congrès à Bonifacio, l’ANEL a choisi de placer l’avenir des littoraux impactés par les dépôts de sargasses au cœur des débats.
Pour l’ANEL, cette crise n’est plus seulement environnementale, économique. Elle constitue une urgence sanitaire qui appelle une mobilisation accrue de l’État en Guadeloupe et Martinique, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Reçus par Jean-Charles Orsucci, nouveau président de l’ANEL et maire de Bonifacio, et Yannick Moreau, maire des Sables d’Olonne et président sortant, MM. Pelage et Otto ont dit la situation préoccupante et d’urgence de ces sargasses.
Un nouveau plan de sécurisation a été présenté par le Premier ministre démissionnaire François Bayrou en début d’année. Il est notoirement insuffisant, ont dit les élus, qui demandent à l’Etat de moins se défausser sur les communes et de prendre toute sa part aux procédures de sécurisation des littoraux.
Une interpellation bien précise
Aujourd’hui, l’association interpelle l’Etat sur la gestion des sargasses, un sujet particulièrement important pour les collectivités d’ Outre-Mer. Malgré l’annonce d’un 3e plan national de lutte contre les sargasses, la mobilisation sur différents volets — prévention, action, règlementation — est urgente.
Sur toutes les mers du globe, la France a posé son empreinte. De Saint-Pierre-et-Miquelon à la Polynésie, de la Guyane à Mayotte, nous avons cette chance rare de regarder le monde par tous ses océans. Cette vocation maritime est un privilège, mais elle est aussi une responsabilité. Une exigence. Une promesse que nous faisons à tous ceux qui vivent les pieds dans l’eau et les yeux tournés vers l’horizon.
Or depuis plus d’une décennie, un fléau brun, venu du large, vient heurter sans relâche les côtes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, blessant ce que la mer a de plus vivant. Les sargasses.
Un enjeu de santé publique
Ces algues brunes s’échouent par tonnes sur les rivages, souillent les plages, obstruent les ports, paralysent la pêche et frappent l’économie touristique. Mais surtout — surtout — elles étouffent. Car lorsqu’elles se dessèchent, les sargasses dégagent des gaz nocifs : hydrogène sulfuré, ammoniac… Une odeur lourde, entêtante, irrespirable. Des maux de tête, des nausées, des vomissements. Parfois des évacuations.
Vivre les fenêtres closes, dans la chaleur tropicale, avec l’angoisse comme seul ventilo : c’est cela, le quotidien de nombreux foyers. Cette situation n’est plus simplement une nuisance environnementale et économique. C’est une atteinte directe à la santé publique. C’est une blessure à la dignité. Et pourtant, depuis des années, les élus ultramarins tiennent
bon. Ils alertent, proposent, agissent. Mais ils ne peuvent pas, seuls, retenir la mer ni contenir ses colères.
Le 3e Plan national de lutte contre les sargasses
Le 26 mai dernier, lors du Comité interministériel de la mer à Saint-Nazaire, le Premier ministre François Bayrou a annoncé un troisième plan national de lutte contre les sargasses. C’est un signal attendu.
Ce plan prévoit notamment le déploiement renforcé de navires Sargator, capables de collecter jusqu’à 16 tonnes d’algues par heure, l’usage de grues et de barges pour faciliter leur traitement, ainsi qu’un soutien logistique et technique aux collectivités concernées.
Nous saluons ce troisième plan car cela témoigne d’une prise de conscience. Mais nous le disons avec clarté : ce plan ne peut être qu’un commencement.
Des mesures insuffisantes
Camille Pelage, vice-président du Conseil régional de Guadeloupe déclare « Les Outre-mer n’attendent pas une gestion progressive de la crise. Ils attendent une stratégie de libération, une réponse à la hauteur du défi ».
Et cette réponse suppose :
- D’intervenir en mer, avant que les algues ne touchent terre ;
- De surveiller les nappes via satellite, pour une réactivité maximale ;
- De reconnaître l’échouage de sargasses comme une pollution et non plus comme un déchet, en attendant que soit trouver des moyens de pouvoir valoriser cette biomasse plutôt que de l’enfouir ;
- De protéger les populations avec des capteurs, des périmètres de sécurité et des dispositifs d’alerte fiables ;
- De lever les blocages réglementaires, pour agir vite, utile et sans burocratie inutile ;
De renforcer la mobilisation des moyens de coopération et de recherche au niveau international.
La position de l’ANEL
Parce que ce n’est pas un détail administratif ni une anecdote tropicale, mais une réalité concrète, vécue au quotidien par nos concitoyens des Antilles et de la Guyane. Une réalité qui abîme la confiance, blesse la dignité, et laisse penser parfois que tout ne se vaut pas, selon que l’on vive à Paris, en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane.
Il n’y a pas de petits combats dès lors qu’ils touchent à l’essentiel : la santé, la sécurité, la qualité de vie. Et dans ces territoires d’Outre-mer, où l’océan est plus qu’un paysage, laisser s’installer une pollution chronique, c’est laisser se faner un mode de vie qui, depuis des générations, unit les hommes à la mer.
Face aux sargasses, comme face aux vents contraires, il est nécessaire d’agir.