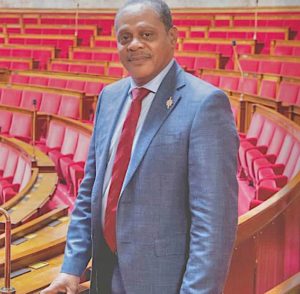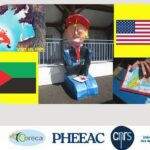PAR JEAN-MARIE NOL*
Mardi 30 septembre s’est tenue à l’Elysée, une réunion d’échanges entre les élus des pays d’Outre-mer et le président de la République, Emmanuel Macron, sur la situation institutionnelle et les évolutions souhaitées vers davantage d’autonomie et de responsabilité locale pour un meilleur développement économique de la Guadeloupe.
Mais, en cette fin d’année 2025, alors que la France ploie sous une dette publique vertigineuse de plus de 3 400 milliards d’euros et que les marges budgétaires se réduisent dangereusement, les Antilles se trouvent à la croisée des chemins avec l’accélération extraordinaire de l’intelligence artificielle et les velléités de changement statutaire .
Le fardeau national de la dette, aggravé par la dégradation de la note souveraine, plane comme une menace silencieuse sur la faisabilité d’une telle évolution sur la Guadeloupe, dont l’équilibre économique demeure tributaire des transferts publics.
En Guadeloupe, les débats autour de l’autonomie se heurtent à deux obstacles majeurs qui redéfinissent en profondeur les horizons possibles : la révolution de l’intelligence artificielle et l’écrasante crise de la dette française.
Ces deux dynamiques, apparemment éloignées, convergent pourtant pour fragiliser les bases déjà précaires de l’économie insulaire et poser avec acuité la question de la viabilité d’un changement statutaire.
L’IA, dont on pressent désormais l’accélération fulgurante, menace de bouleverser le marché du travail, en particulier dans le secteur public qui demeure le principal pourvoyeur d’emplois aux Antilles. L’étude récente prévoyant le remplacement potentiel de 427 500 fonctionnaires en France par des systèmes automatisés illustre la brutalité de ce basculement.
Dans une économie où l’administration et les services constituent une part essentielle de l’activité, une telle mutation équivaut à un séisme social. Ce n’est pas seulement la perspective de la suppression d’emplois qui inquiète, mais aussi la transformation radicale des missions, des statuts et des recettes fiscales locales qui en dépendent.
Les collectivités guadeloupéennes, déjà sous tension, pourraient voir leurs ressources s’assécher si 30 à 40 % des tâches humaines venaient à être automatisées, compromettant leur capacité à financer des politiques publiques adaptées. La promesse de libérer du temps pour l’innovation risque de se transformer en cauchemar pour une société où l’ascension sociale repose encore massivement sur l’emploi public.
À cette menace technologique s’ajoute le poids écrasant de la dette française, dont les répercussions se font sentir jusque dans les territoires ultramarins. Avec un déficit public de 5,4 % du PIB en 2025 et un ratio dette/PIB supérieur à 115 %, l’État français se trouve contraint d’opérer des coupes budgétaires sévères.
La mission « Outre-mer » en subira le contrecoup, avec une réduction de près de 800 millions d’euros en 2026, amputant des dispositifs vitaux tels que les exonérations sociales de la loi LODEOM ou les mécanismes de défiscalisation pour l’investissement.
Ces coupes, si elles paraissent techniques, représentent une ponction directe sur l’économie antillaise et sur l’ensemble des outres-mers, où 50 000 entreprises dépendent de ces soutiens pour survivre. En d’autres termes, les Antilles, déjà fragilisées par une base productive limitée et un déficit commercial chronique, risquent de voir disparaître les derniers leviers qui compensaient leur manque de compétitivité.
La dépendance au financement public devient alors une véritable perfusion, maintenant artificiellement en vie un modèle économique qui refuse de se transformer.
Dans ce contexte, le débat sur l’autonomie apparaît paradoxal. D’un côté, il est porté par une volonté de reconnaissance identitaire et de prise en main locale des leviers de développement. De l’autre, il se heurte à une réalité implacable : l’absence de marges budgétaires nationales et la fragilité des ressources propres de la Guadeloupe.
Revendiquer plus de compétences sans disposer des moyens financiers et productifs pour les exercer revient à gérer la pénurie et à déplacer le problème sans le résoudre. L’autonomie risque ainsi de se transformer en mirage institutionnel, creux et sans effet, si elle n’est pas accompagnée d’une refondation économique profonde. C’est là que réside le véritable défi : comment passer d’une économie de consommation sous perfusion d’importations à une économie productive, résiliente et tournée vers ses propres forces vives ?
La réponse ne peut se limiter aux arbitrages politiques ni aux transferts financiers. Elle passe nécessairement par une mobilisation collective autour de projets structurants : diversification agricole tournée vers l’autosuffisance, développement du tourisme de santé et de bien-être, valorisation des énergies renouvelables et insertion active dans l’économie numérique.
Ces pistes existent mais nécessitent un changement culturel et institutionnel profond, une réorientation de la formation et de l’éducation, ainsi qu’un dépassement des corporatismes qui paralysent encore trop souvent l’action publique.
Les syndicats, arc-boutés sur la défense d’acquis sociaux fragiles, et les élus locaux, absorbés par des débats institutionnels déconnectés des urgences économiques, doivent désormais se confronter à la réalité : sans transformation du modèle productif, toute évolution statutaire restera illusoire.
La tension entre appartenance au modèle social français et affirmation d’une identité caribéenne autonome traverse toute la société guadeloupéenne. Rester dans le giron protecteur mais affaibli de l’État, ou assumer un destin économique plus indépendant, tel est le dilemme qui se pose désormais avec une intensité inédite.
Car la crise actuelle n’est pas seulement budgétaire ou technologique : elle est existentielle. Elle interroge la capacité de la Guadeloupe à se penser comme une communauté de destin, capable de se projeter au-delà des transferts financiers et des protections administratives.
Les chocs climatiques, les fluctuations économiques mondiales et la montée en puissance de l’intelligence artificielle ajoutent des couches de vulnérabilité supplémentaires à un édifice déjà fragile. Mais, ils constituent aussi un appel à l’innovation, à la créativité et à la réinvention collective.
Dans cette tempête, le statu quo n’est plus tenable. La Guadeloupe est sommée de choisir entre subir les effets croisés de la dette et de l’IA, ou bien transformer ces menaces en leviers d’émancipation. Cela suppose un courage politique à la hauteur des enjeux, une vision stratégique dépassant les calculs électoraux, et surtout une prise de conscience collective que le modèle actuel est à bout de souffle.
Autonomie ou pas, l’avenir ne se jouera pas seulement dans les institutions, mais dans la capacité à bâtir une économie résiliente, créatrice de valeur locale et porteuse d’une identité assumée. Plus que jamais, la Guadeloupe doit décider si elle veut continuer à vivre sous perfusion ou s’engager résolument dans la construction d’un destin autonome.
Car, dans le fracas de la dette et de la révolution numérique, il n’y a plus de place pour l’attente : il n’est plus temps de survivre, mais bien de bâtir.
*Economiste