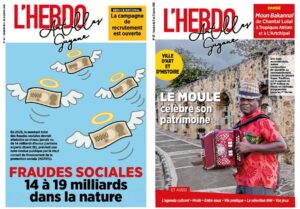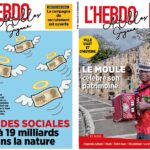PAR JEAN-MARIE NOL*
Le président Emmanuel Macron a récemment convié les élus ultramarins à l’Élysée pour discuter de l’avenir institutionnel des territoires d’Outre-mer. À l’issue de cette rencontre, des groupes de travail sur l’autonomie seront installés d’ici la fin de l’année afin d’explorer les voies d’une possible évolution statutaire.
Mais, le chef de l’État, tout en ouvrant cette perspective, a prévenu : « on ne peut sans doute pas demander de nouveaux droits sans en sacrifier d’autres ». Cette formule sibylline , mais lourde de sens, sonne comme un avertissement aux élus dans un contexte où la France, traversée par des crises à répétition, se prépare à affronter des années d’incertitudes financières, économiques, sociales et politiques.
Car 2026 s’annonce déjà comme une année charnière, peut-être celle de tous les dangers : instabilité politique et surtout institutionnelle, menace de récession, faillites d’entreprises en série, plans sociaux et déséquilibres budgétaires accumulés, menaces géopolitiques, laissent présager un avenir sombre.
Le pays semble s’être enfoncé dans une spirale d’immobilisme et de défiance, incapable de se réinventer autrement que sous la contrainte d’une catharsis. Une étude récente du Haut-commissariat à la stratégie et au plan révèle qu’à l’horizon 2035, seuls 20 % des Français croient qu’ils seront plus heureux qu’aujourd’hui. Ils sont majoritaires à anticiper une dégradation du partage des richesses, de l’environnement, de la démocratie, et même des conditions de vie de la jeunesse.
Pessimistes, les Français doutent de la pérennité de leurs institutions : 73 % pensent que le système de retraite par répartition disparaîtra d’ici 2050, et 64 % qu’il en ira de même pour la Sécurité sociale telle qu’ils la connaissent.
Face à cette vision d’un pays en voie de déclin et affaibli, où la dette publique enfle et où l’accès aux soins, à l’emploi et à l’éducation se dégrade, certains observateurs estiment qu’il ne reste plus qu’à espérer une véritable crise, une de ces secousses violentes capables de briser le déni collectif et de forcer la France à se réformer.
« Vite, la crise ! », s’écrient-ils, convaincus qu’aucune amélioration ne viendra sans un choc systémique. C’est déjà l’hypothèse de travail du président selon certains esprits éclairés. L’échec des majorités politiques successives, la paralysie parlementaire, la succession des motions de censure et des compromis budgétaires sans horizon ont installé le pays dans un épuisement collectif. La société, disent-ils, est devenue « droguée à l’aide sociale », dépendante d’un modèle social de redistribution que plus personne ne sait financer. Et si l’on ne parvient plus à réformer, c’est sans doute parce que le pays tout entier se refuse à tous efforts voire sacrifices, sans vouloir regarder la réalité en face. C’est là, le fameux déni de réalité français !
Mais, que devient, dans ce grand désordre, la Guadeloupe ? Le sort du département caribéen est intimement lié à celui de la France. Pourtant, l’archipel, comme d’autres régions ultrapériphériques de l’Europe, se trouve à la croisée des chemins.
À mesure que la France s’enlise, la Guadeloupe s’abîme dans l’insécurité et la corruption et se vide de ses forces vives. L’hémorragie démographique s’accélère, les jeunes diplômés s’envolent vers des horizons plus porteurs, tandis que ceux qui restent affrontent chômage, insécurité chronique, désillusion et marginalité. Le désinvestissement économique, la baisse de la consommation, les coupes budgétaires, la montée des inégalités et le sentiment d’abandon creusent un fossé entre l’État central et ses territoires ultramarins. Si la crise de la vie chère s’est apaisée, le désespoir social, lui, demeure avec son lot d’addictions et de problématiques psychologiques .
Cette désespérance trouve son écho dans une fracture culturelle et identitaire profonde. Beaucoup craignent que les dirigeants hexagonaux, englués dans la gestion de la dette et les compromis politiques, ne mesurent pas à quel point la Guadeloupe glisse elle aussi vers un point de non-retour.
Les politiques publiques menées depuis des décennies, marquées par une logique économique « neutre » et comptable, semblent incapables de répondre aux besoins réels de développement local. Les banques, les investisseurs institutionnels et les grandes structures métropolitaines et de békés Martiniquais contrôlent désormais l’essentiel du tissu économique ultramarin, reléguant les acteurs locaux à un rôle secondaire.
Démolir à l’aide d’une idéologie passéiste pour reconstruire, comme le prônent certains, reviendrait à achever le patient avant même d’avoir songé à le soigner.
À ces fractures sociales et économiques s’ajoutent désormais des défis d’une ampleur inédite. L’année 2025, considérée comme le quatrième acte d’une crise globale, a mis en lumière des déséquilibres profonds dont les effets se prolongeront sur plusieurs décennies.
L’augmentation sans précédent des dettes publiques et privées prépare la prochaine grande secousse : financière, économique, sociale ou même sociétale. Le temps de la « mondialisation heureuse » s’est achevé, et nul ne peut dire s’il renaîtra. Aux échanges ouverts d’hier se substitue aujourd’hui un encloisonnement géopolitique marqué par des tensions entre blocs et une volatilité accrue des relations commerciales.
Pour la Guadeloupe, ces bouleversements signifient des coûts de fret maritime et aérien plus élevés, une instabilité des chaînes d’approvisionnement, et des investissements détournés vers d’autres régions du monde. Dans ce contexte, la première priorité devient claire : s’attaquer enfin aux changements climatiques, la menace existentielle qui surpasse toutes les autres, et même selon nous , l’épée de Damoclès de l’intelligence artificielle qui pèse sur nos têtes.
Il faut, de toute urgence, engager des actions à la hauteur des ambitions affichées : accélérer la transition verte à travers la valorisation de la canne pour produire du bioéthanol, investir massivement dans les énergies renouvelables — en particulier l’hydrogène — et soutenir les populations les plus touchées par les sargasses, les intempéries, les pertes agricoles et la raréfaction des ressources halieutiques.
Trop de temps a été perdu pendant que le tissu productif agricole s’effilochait. La seule voie de redressement durable passe désormais par la création d’un véritable marché économique régional, centré sur une industrie agroalimentaire digne de ce nom et fondée sur les complémentarités Antilles–Guyane.
Si la Guadeloupe et la Martinique parviennent à innover politiquement et à s’entendre sur l’idée d’une grande collectivité territoriale Antilles-Guyane autonome avec un pouvoir normatif, et surtout dotée de trois assemblées distinctes, chacune présidée par un exécutif élu, elles pourraient alors transcender leurs frontières administratives pour bâtir une coopération économique d’abord tournée vers les Amériques, puis ouverte sur l’espace caribéen.
Ce serait une façon concrète de rompre avec la fragmentation politique actuelle et de redonner un horizon collectif à la région Guadeloupe. Il y aurait alors, réellement, des raisons d’espérer l’avenir.
Pourtant, un autre futur est encore à inventer, plus lucide et plus enraciné. Il suppose une réconciliation de la Guadeloupe avec elle-même, c’est-à-dire la reconnaissance de sa culture comme un pilier de stabilité, un repère nécessaire pour comprendre et affronter un monde en mutation.
Dans un contexte où le système global bouge et où même la France change sous la pression de crises successives, il n’est plus temps pour la Guadeloupe d’attendre que la solution vienne de Paris. Le futur souhaitable pour l’archipel ne peut être qu’un futur lucide et responsable : celui d’une profonde réflexion intellectuelle, d’une réforme du modèle économique et sociale qui devrait être maîtrisée, et fondée sur l’éducation, la transmission culturelle et l’innovation locale.
Il ne s’agit pas de rompre d’emblée, mais de repenser le lien avec la France, en exigeant non pas plus d’assistanat, mais plus de confiance. Ce futur passe par la redéfinition d’un modèle de développement adapté, où les ressources naturelles, la biodiversité, la jeunesse et la culture deviennent les moteurs d’un nouveau capital territorial.
Dans une France en crise, la Guadeloupe doit se projeter comme une avant-garde, un laboratoire d’expérimentation sociale et écologique, capable de démontrer que la périphérie peut éclairer le centre.
Alexis de Tocqueville écrivait : « Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres. » C’est là tout l’enjeu du moment. La Guadeloupe, si elle ne veut pas subir le naufrage d’une France déclinante, doit se réapproprier la lumière de son propre destin. Elle ne peut pas se contenter d’espérer la crise pour rebondir, ce qui n’est pas à la portée de ses moyens, mais elle doit transformer la crise à venir en occasion de renaissance économique.
Le futur souhaitable n’est pas une utopie, en dépit d’un manque criant de visibilité, mais une exigence de lucidité et de courage collectif.
“Chak bèt à fé ka kléré pou nanm’ay “
Traduction littérale : Chaque luciole éclaire sa propre âme.
*Economiste et juriste en droit public