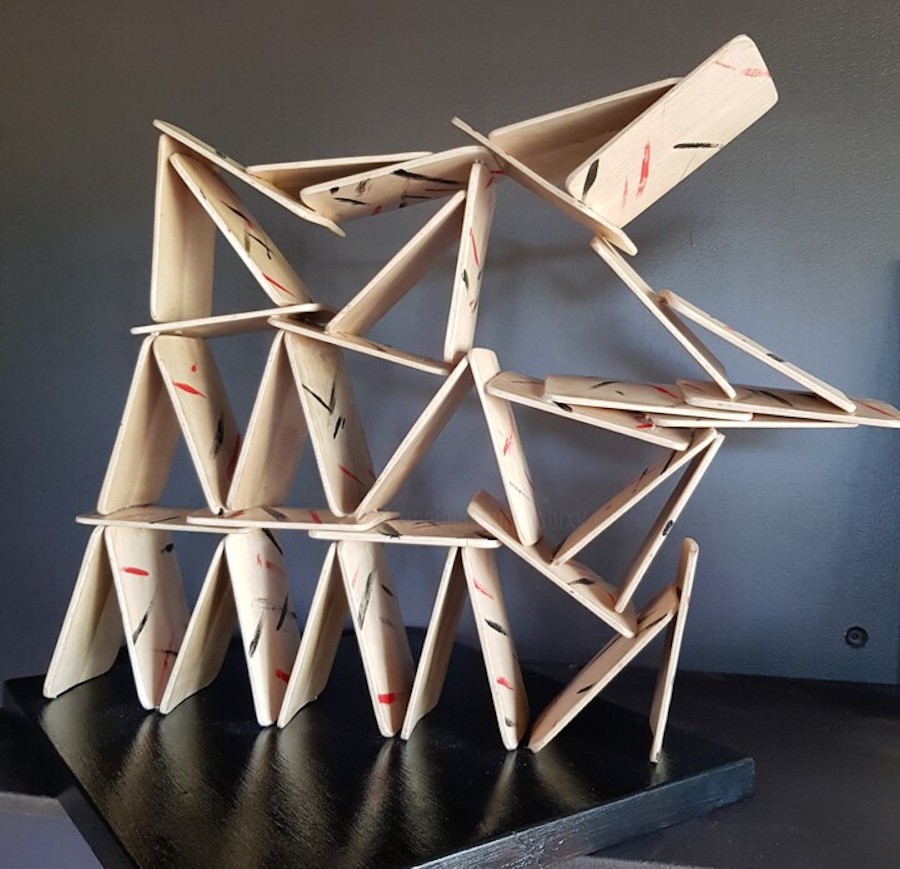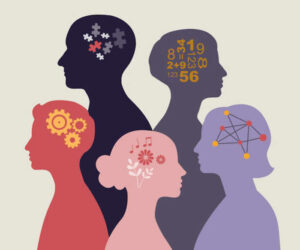PAR JEAN-MARIE NOL*
Il y a dans l’air un parfum étrange, un mélange de résignation et de déni.
La Guadeloupe s’installe doucement dans une forme de dépendance tranquille, où la survie économique repose moins sur la création de richesse que sur la redistribution, moins sur l’effort que sur l’attente des bienfaits du modèle social français.
Les chiffres, pourtant, parlent d’eux-mêmes : sans les transferts publics, sans les exonérations de charges, sans le soutien budgétaire de l’État, tout un pan de l’économie locale s’effondrerait comme un château de cartes.
Ce modèle, conçu à l’origine pour réparer les fractures historiques et compenser les handicaps structurels, s’est peu à peu mué en piège. Car l’assistanat, lorsqu’il devient système, finit toujours par tuer la valeur travail. Il dégrade la dignité individuelle, ronge le sens de la responsabilité et dévalorise le mérite.
En croyant protéger, on a désarmé. En redistribuant sans transformer, on a anesthésié. Et en voulant égaliser, on a nivelé par le bas.
Aujourd’hui, la Guadeloupe n’est pas tant pauvre qu’immobile.
Son économie tourne, mais sans moteur propre. Le commerce prospère, mais sur la consommation subventionnée. Les banques tiennent, mais grâce à l’épargne des ménages, estimée à près de cinq milliards d’euros — une manne dormante qui alimente le crédit mais ne finance pas la production.
Le travail, lui, perd sa valeur symbolique. Il n’est plus le lieu de l’émancipation, mais celui de la frustration.
Le plus tragique, c’est que cette dérive s’accompagne d’une mutation silencieuse du monde du travail lui-même.
L’intelligence artificielle, cette révolution cognitive qui bouleverse l’économie mondiale, achève de rebattre toutes les cartes. Pendant des siècles, étudier garantissait un avenir, un statut, une place. Ce monde-là est mort. L’intelligence devient gratuite, disponible, algorithmique.
Elle s’affiche en ligne, se télécharge, se monnaye à la seconde. L’IA ne menace pas seulement les emplois ; elle sape les fondements culturels de la réussite par le savoir.
Comme le rappellent Laurent Alexandre et Olivier Babeau dans Ne faites plus d’études !, le monde qui s’ouvre à nous n’a plus besoin d’élèves dociles mais d’esprits adaptatifs.
Demain, le diplôme ne vaudra plus promesse, mais simple formalité. Et ceux qui n’auront pas compris cette révolution seront balayés.
Le danger pour la Guadeloupe, comme pour la France entière, est de rester figée dans un modèle éducatif et économique conçu pour le siècle passé. Dans un monde où l’intelligence devient machine, le seul capital durable sera la créativité, la maîtrise de soi et la capacité à coopérer.
Mais comment préparer cette mutation quand une part croissante de la jeunesse ne croit plus en l’effort ? Quand l’école, déconnectée des réalités productives, ne forme plus qu’à la désillusion ? Quand le travail n’est plus perçu comme une source de fierté mais comme une servitude ?
La désacralisation du travail n’est pas une abstraction morale. C’est une bombe sociale.
Car une société qui ne reconnaît plus l’effort finit toujours par engendrer la violence. On le voit déjà : montée de la délinquance, défiance envers l’autorité, perte du sens collectif. Le lien social se délite, la solitude gagne du terrain, et la colère sourd.
Ce que l’on appelle pudiquement « violences urbaines » n’est souvent que le cri de ceux qu’on a privés d’un horizon. Quand le mérite ne paie plus, la révolte devient le seul langage possible.
Et dans ce monde ultra-connecté, la solitude est paradoxalement devenue la norme. Le télétravail, les réseaux sociaux, les écrans omniprésents ont effacé la communauté au profit de la connexion. En vingt ans, les interactions sociales quotidiennes ont chuté de près de 40 % dans les sociétés développées.
La Guadeloupe, pourtant marquée par une tradition de convivialité, glisse à son tour vers cette atomisation. L’individu s’isole, la société se fragmente, et l’économie perd son souffle collectif.
Face à ce constat, il est urgent de cesser de confondre solidarité et dépendance. L’État doit continuer à soutenir, oui, mais non plus à entretenir. Il faut désormais investir dans la capacité, non dans la compensation. Réorienter les aides vers la production, encourager l’innovation, faire de l’épargne locale un levier d’investissement, créer de vraies filières d’avenir — énergies renouvelables, économie numérique, santé, culture — voilà le véritable défi.
La Guadeloupe ne manque ni de talents ni de ressources. Elle manque de vision prospective et donc de projets innovants tournés vers un futur de disruption économique.
Redonner de la valeur au travail, c’est redonner un sens à la société. C’est replacer la dignité au cœur de la prospérité. C’est dire, enfin, que la liberté ne se mesure pas à la quantité d’aides perçues, mais à la capacité de produire, d’inventer, de construire.
Nous sommes à la veille d’un basculement historique. L’intelligence artificielle, le dérèglement climatique et la mondialisation recomposent déjà les hiérarchies. Si la Guadeloupe ne s’inscrit pas dans ce mouvement, elle ne sera plus qu’un espace subventionné, sans avenir, sans repères et sans boussole.
L’histoire nous enseigne que les sociétés ne meurent pas d’un choc brutal, mais d’une lente fatigue du sens.
C’est peut-être cela, le vrai péril : non la paupérisation, mais l’oubli du travail.
Et quand une société oublie le travail, elle oublie aussi la liberté.
*Economiste et juriste en droit public