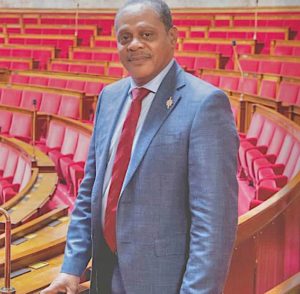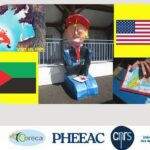PAR JEAN-MARIE NOL*
Dire qu’il n’y a pas de travail en Guadeloupe est devenu une sorte de mantra collectif, répété avec fatalisme et rarement interrogé. Pourtant, ce « grand malentendu » masque une réalité beaucoup plus complexe où se mêlent héritages culturels, représentations biaisées de l’économie, comportements sociaux et transformations profondes du marché du travail.
Le chômage élevé – près de 18 % de la population active – et la très faible participation des jeunes et des seniors ne sauraient expliquer à eux seuls ce paradoxe : une île qui se dit en manque d’emplois, alors même que des entrepreneurs étrangers y créent, chaque année, de nouvelles activités dans des secteurs où les Guadeloupéens sont peu présents.
Le premier facteur de cette confusion tient à une donnée souvent ignorée : la participation globale au marché du travail en Guadeloupe est exceptionnellement basse. À peine 55 % des jeunes de 18 à 25 ans travaillent, et les seniors y sont tout aussi peu insérés.
Cette absence massive dans la vie active n’est pas un choix collectif mais une situation subie, révélatrice d’un rapport au travail brouillé par l’histoire sociale et économique de l’île. Elle ne se résoudra évidemment pas en supprimant quelques jours fériés, argument régulièrement brandi mais totalement déconnecté des réalités structurelles.
Ce qu’elle exige au contraire, c’est une profonde transformation culturelle, un effort collectif pour revaloriser la notion même d’activité productive et reconnaître l’entreprise comme un acteur essentiel du bien-être collectif.
Car c’est là que réside le cœur du problème : la mauvaise perception de l’économie. Depuis des générations, l’entreprise est souvent perçue comme un lieu d’exploitation plutôt que comme un espace de création de richesse et d’opportunités. Refouler ou diaboliser l’économie, ce qui demeure fréquent dans le débat public guadeloupéen, finit toujours par provoquer un retour brutal du réel, avec des conséquences imprévisibles et risquées.
Comprendre l’économie n’est pas un luxe réservé aux experts : c’est une condition de la démocratie, un moyen d’éclairer les choix publics et d’éviter que les discours simplistes, démagogiques ou populistes n’occupent le vide laissé par l’absence de pédagogie économique.
Les enquêtes d’opinion montrent que les citoyens s’intéressent profondément aux questions économiques : chômage, crise, coût de la vie, dette, avenir de l’euro. Mais la méconnaissance des mécanismes réels laisse souvent la place à des explications idéologiques, qui nourrissent le fatalisme et poussent paradoxalement la population à subir encore davantage les forces économiques au lieu de les comprendre ou de les influencer.
Pendant ce temps, les données concrètes contredisent largement l’idée selon laquelle « il n’y a pas de travail ». La prolifération de petites entreprises créées par des entrepreneurs haïtiens ou chinois dans le commerce – supérettes, bazars, restauration – montre que des niches économiques existent bel et bien.
Dans le tourisme, les services, la restauration, les loisirs, de nombreux hexagonaux, attirés par le potentiel du territoire, créent et développent leurs activités avec succès. Leur présence n’est pas l’expression d’une spoliation, mais la preuve que la demande économique locale permet à des initiatives de prospérer. Cela pose une question simple mais dérangeante : pourquoi des étrangers parviennent-ils à entreprendre en Guadeloupe alors que beaucoup de Guadeloupéens hésitent encore à s’engager dans ces secteurs ?
L’absence marquée des travailleurs locaux dans certains métiers essentiels illustre ce décalage. L’agriculture peine à recruter ; le BTP manque chroniquement de main-d’œuvre ; les métiers techniques et manuels souffrent d’un déficit d’attractivité. Ce phénomène, ancien, s’explique en partie par le prestige inégal associé aux différentes professions. Nombre de secteurs considérés comme « pénibles » ou peu valorisants sont délaissés par les jeunes Guadeloupéens au moment même où ils attirent des travailleurs venus d’ailleurs.
La contradiction est flagrante : l’économie locale importe de la main-d’œuvre dans des secteurs où la demande existe, tout en laissant sur le bord du chemin une partie de sa jeunesse diplômée mais déconnectée des opportunités réelles du territoire.
Il faut également évoquer la qualité du rapport au travail, un sujet sensible mais documenté. La Guadeloupe enregistre beaucoup plus d’arrêts maladie que l’Hexagone, une fréquence des conflits sociaux très supérieure et une insatisfaction au travail plus forte que dans les régions françaises de niveau économique comparable.
Les grèves, parfois longues et intenses, témoignent d’un climat où le dialogue social repose davantage sur le rapport de force que sur la coopération. Cette situation entretient une perception du travail comme source de tensions plutôt que comme espace d’épanouissement ou de progrès social. La faible qualité du travail n’est donc pas un simple ressenti : elle apparaît dans les chiffres, dans les enquêtes, dans les comportements collectifs.
Pourquoi alors ce sentiment récurrent qu’il n’y a pas de travail en Guadeloupe ? Parce que les chiffres macroéconomiques ne disent pas tout. Ce que ressent la population est une combinaison de désajustement culturel, de manque d’information économique et d’inadéquation entre les attentes sociales et la structure réelle du marché du travail.
Les jeunes diplômés cherchent des postes administratifs ou des emplois publics qui n’existent plus en nombre suffisant, tandis que des métiers essentiels mais moins valorisés restent vacants. La société guadeloupéenne se trouve ainsi prise dans une forme d’illusion collective : celle d’une économie sans avenir, alors même qu’elle grouille d’activités dans certains secteurs.
Dans cette confusion prospèrent xénophobie, démagogie et populisme. Il devient tentant d’accuser l’étranger d’occuper des emplois « volés », d’alimenter l’idée que l’économie serait truquée ou inaccessible, de dénoncer des injustices réelles mais en les attribuant à de faux coupables.
Ces discours rassurent mais n’expliquent rien. Ils masquent surtout la nécessité d’un débat mature sur la place du travail, sur la revalorisation des métiers, sur la formation adaptée aux besoins économiques réels, et sur la manière de reconstruire une culture du travail qui ne soit plus vécue comme une contrainte mais comme un levier d’émancipation.
Ce grand malentendu collectif ne pourra être résolu qu’en changeant de regard. La Guadeloupe n’est pas condamnée à l’inactivité ou à la dépendance économique. Elle dispose d’atouts considérables, d’une jeunesse dynamique, d’une diaspora entreprenante, d’une diversité culturelle qui pourrait être un moteur d’innovation plutôt qu’un motif de repli.
Mais, pour cela, il faudra accepter une vérité simple : le travail ne disparaît pas de la Guadeloupe, il change de main de notre fait. Il se transforme, se réinvente, se déplace parfois. Le défi n’est pas d’attendre que le travail vienne à nous, mais de comprendre, d’anticiper et d’accompagner ces transformations.
C’est le rôle de changer la donne culturelle de toute société qui veut se projeter dans l’avenir.
Ce grand malentendu collectif ne pourra être dissipé qu’en changeant profondément de regard sur le travail et en affrontant sans détour les contradictions qui traversent aujourd’hui la société guadeloupéenne. L’une des plus frappantes concerne la jeunesse diplômée. Formée, souvent ambitieuse, elle se tourne massivement vers la fonction publique, perçue comme le seul horizon stable et légitime. Mais, cet attachement quasi culturel à l’administration se heurte désormais aux transformations accélérées du monde contemporain.
Le secteur tertiaire, qui a longtemps constitué le refuge des emplois publics et de bureau, sera l’un des premiers touchés par la robotisation et l’intelligence artificielle. Les tâches administratives répétitives, la gestion documentaire, une partie du traitement des dossiers ou des opérations de contrôle seront de plus en plus automatisées.
Les emplois statutaires, déjà structurellement limités, se raréfieront. Insister à vouloir y accéder à tout prix constitue un risque majeur de déclassement futur pour une génération persuadée que seule la fonction publique peut garantir une vie stable.
Cette orientation massive vers un secteur voué à être profondément transformé crée un désalignement inquiétant entre les aspirations de la jeunesse et les besoins réels du territoire. Pendant que certains jeunes diplômés attendent un poste administratif qui ne viendra pas, des pans entiers de l’économie locale – artisanat, agriculture, construction, métiers techniques, maintenance, services spécialisés – cherchent désespérément de la main-d’œuvre qualifiée ou motivée.
À l’autre bout du spectre, une fraction de la jeunesse non diplômée, en échec scolaire, décroche encore plus radicalement. Faute de perspectives claires, elle se replie dans une économie de survie, mêlant aides sociales, petits trafics et parfois violences. Là où, autrefois, ces jeunes trouvaient spontanément leur place dans le bâtiment, dans les ateliers d’artisans ou dans les champs de bananes et de canne, les portes se sont refermées.
Non pas parce que le travail a disparu, mais parce que d’autres ont pris la place : les travailleurs haïtiens, souvent plus endurants, plus disponibles et moins réticents à exercer ces métiers pénibles mais essentiels, occupent désormais massivement ces postes. Ils assurent, en silence, le fonctionnement de filières entières de l’économie guadeloupéenne abandonnées par une partie de la jeunesse locale.
Ce remplacement progressif, silencieux mais visible, illustre une vérité dérangeante : la Guadeloupe n’est pas un territoire sans travail, mais un territoire où le travail ne correspond plus aux représentations sociales dominantes. Le mythe du « travail qui n’existe plus » cache une réalité bien plus simple : il existe, mais il n’attire plus. Il est moins prestigieux, moins confortable, moins en phase avec les attentes nourries depuis des décennies autour du statut public comme modèle unique de réussite sociale.
Face à ce constat, continuer à dénoncer un manque d’emplois n’a plus de sens. Le véritable défi consiste à reconstruire une culture du travail valorisant l’effort, la compétence, l’initiative et la diversité des métiers. Il s’agit aussi de redonner de la dignité à des professions manuelles ou techniques injustement dépréciées, alors même qu’elles sont les seules capables d’assurer l’autonomie économique du territoire.
La Guadeloupe n’est pas condamnée ; elle est à un tournant. Elle devra combler le fossé entre une jeunesse qui regarde vers des métiers d’hier et une économie qui se transforme à grande vitesse sous l’effet de la technologie, de la mondialisation et des mouvements migratoires.
L’avenir n’appartiendra ni aux discours déclinistes ni aux illusions rassurantes. Il appartiendra à ceux qui sauront réconcilier les jeunes avec les réalités productives du territoire, valoriser l’entreprise, mobiliser la formation, renouer avec l’esprit d’initiative et comprendre que le travail, loin d’être un fardeau ou une fatalité, peut devenir un levier de dignité, de cohésion et d’émancipation. C’est de cette lucidité collective que dépendra la capacité de la Guadeloupe à sortir du malentendu et à affronter l’avenir avec confiance.
*Economiste et juriste en droit public