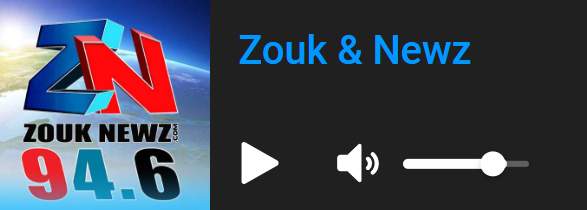PAR JEAN-MARIE NOL*
La société antillaise, et singulièrement la Guadeloupe, semble aujourd’hui engagée dans un processus de délitement profond dont la montée spectaculaire de la violence juvénile n’est que la manifestation la plus visible et la plus tragique.
Les faits divers se succèdent à un rythme qui sidère autant qu’il inquiète : meurtres par arme à feu, règlements de comptes, banalisation de la mort violente dans des communes autrefois perçues comme paisibles. Le quatrième décès par balle enregistré dès les premières semaines de l’année en Guadeloupe n’est pas un accident de parcours, ni un simple échec ponctuel des politiques de sécurité publique.
Il est le symptôme d’une rupture beaucoup plus profonde, enracinée dans les transformations économiques, sociales et morales imposées depuis plusieurs décennies par le modèle néolibéral français et sa déclinaison ultramarine.
Face à cette violence devenue structurelle, l’impuissance affichée de l’État et des élus locaux nourrit un sentiment de sidération collective. Pourtant, cette impuissance n’est pas seulement institutionnelle, elle est conceptuelle. Croire que l’augmentation des effectifs de police ou de gendarmerie suffira à enrayer une dynamique aussi lourde relève de l’illusion. Aucun dispositif sécuritaire ne peut réparer ce que le tissu social a cessé de produire : du lien, de la reconnaissance, des horizons collectifs. En France, l’État social a été détruit par le néolibéralisme.
L’État social est une construction sociale historique de la départementalisation aux Antilles. En effet, historiquement située et adossée à quatre piliers que sont « la protection sociale ; la réglementation des rapports du travail ; les services publics ; les politiques économiques. Force est de souligner que ces piliers vacillent aujourd’hui sous la pression du néo libéralisme avec ses effets pervers de l’égoïsme et de l’individualisme.
Le résultat : plus rien ne fonctionne, à l’exception de l’accumulation au profit des plus riches. Le mal est plus ancien, plus diffus, et surtout plus profond. Le ver est dans le fruit, car la société antillaise a progressivement intériorisé un modèle économique et moral fondé sur la concurrence, la responsabilité individuelle et la maximisation des intérêts personnels, au détriment de la solidarité et du bien commun.
La formule est brutale mais éclairante : plus de délinquance et moins de social. Le recul de l’État-providence, amorcé dès les années 1980 dans l’Hexagone et mécaniquement répercuté dans les territoires ultramarins, a laissé place à une société où chacun est sommé de devenir l’entrepreneur de sa propre survie.
Dans un contexte de chômage endémique, de précarité massive et de perspectives économiques atrophiées, cette injonction produit mécaniquement de la frustration, de la colère et, chez les plus jeunes sans repères ni éducation, une violence sans possibilité de médiation.
Lorsque l’école ne tient plus sa promesse d’ascension sociale, lorsque la famille tombe en déliquescence, lorsque le travail ne garantit ni dignité ni stabilité, lorsque les institutions apparaissent lointaines ou indifférentes, la loi du plus fort tend à remplacer la loi de la convivialité commune.
Les analyses du sociologue Camille Peugny sur le triomphe des égoïsmes résonnent avec une acuité particulière aux Antilles. Alors qu’il garantissait à tous une protection contre les principaux risques sociaux – maladie, chômage, précarité, vieillesse – l’Etat social né à la fin de la Seconde Guerre mondiale s’est peu à peu replié depuis les années 1980. Et aujourd’hui, le fait marquant est le désengagement de l’État français en outre-mer.
Or, « s’il se retire, c’est le lien social lui-même qui risque de se déliter », alertait le sociologue Robert Castel dix ans après. Avec, pour conséquence, l’essor d’une méritocratie synonyme de compétition sociale généralisée avec laquelle il faut composer, qu’on en sorte gagnant ou vaincu.Comment en est-on arrivé là, à cette adhésion désormais large, selon Camille Peugny, aux valeurs néolibérales, rejetant le sens collectif et la solidarité ?
Comment les classes moyennes, après un virage à gauche dans les années 1980, se sont converties à ce nouveau logiciel, et comment la massification scolaire, sous couvert d’égalité des chances, a en réalité accentué les inégalités et la polarisation sociale, au détriment de sa cohésion. De l’État social au chacun pour soi : les nouvelles règles des sociétés libérales
L’égoïsme comme contrainte sociale généralisée au sein de la société antillaise progresse à mesure que recule l’État social, miné par plusieurs décennies de néolibéralisation, notamment parmi les classes moyennes supérieures, entendues comme l’alliance du cœur des classes moyennes stabilisées et des classes supérieures, qui contribuent à l’essaimer au sein de tout le corps social.
De leur côté, nul déni des inégalités mais une adhésion accrue aux principes de responsabilité individuelle. Du côté des classes populaires contraintes de devenir auto-entrepreneuses de leur propre précarité, les transformations de l’emploi avec le numérique et l’intelligence artificielle fracturent les collectifs et contraignent à l’assurance individuelle.La conversion progressive des classes moyennes aux valeurs néolibérales, leur adhésion à une vision méritocratique de la société et leur acceptation tacite du recul de la solidarité collective ont profondément modifié l’équilibre social.
En Guadeloupe comme ailleurs, les classes moyennes supérieures jouent un rôle central dans la diffusion de ce nouveau logiciel idéologique, fondé sur la responsabilité individuelle et la compétition pour des ressources de plus en plus rares. Cette dynamique fragilise les classes populaires, contraintes de s’auto-assurer face à la précarité, et contribue à fracturer les collectifs, y compris familiaux et communautaires.
Robert Castel avait pourtant mis en garde dès les années 1990 : lorsque l’État social se retire, ce n’est pas seulement une protection matérielle qui disparaît, mais le lien social lui-même qui se délite. Aux Antilles, cette alerte prend une dimension dramatique. La violence des jeunes n’est pas seulement une violence criminelle, elle est aussi une violence existentielle, le produit d’une société qui ne sait plus offrir de récit commun ni de perspective crédible à sa jeunesse. Dans une économie où le « gâteau » ne grossit plus, où la croissance est atone, où les contraintes budgétaires se multiplient, chacun lutte pour sa part, souvent au détriment de l’autre.
À cette crise sociale s’ajoute une crise ontologique plus large, nourrie par les bouleversements technologiques, la peur de l’intelligence artificielle, les tensions géopolitiques et l’urgence climatique. La société antillaise, comme la société française dans son ensemble, doute de son avenir et de son identité. Qui sommes-nous à l’ère du numérique, de l’automatisation et de la recomposition brutale des nouveaux rapports de force mondiaux ?
Cette angoisse diffuse alimente les replis individualistes et les comportements égoïstes, chacun cherchant à se protéger dans un environnement perçu comme de plus en plus hostile.
Alexis de Tocqueville avait déjà pressenti ce danger inhérent aux sociétés démocratiques modernes : l’individualisme, en se généralisant, finit par se muer en égoïsme, desséchant les vertus publiques et détruisant progressivement les ressorts mêmes de la vie collective. Ce que l’on observe aujourd’hui aux Antilles semble confirmer cette intuition. L’individualisme, autrefois porteur d’émancipation et de rationalité critique, s’est vidé de sa dimension humaniste pour devenir une contrainte sociale généralisée, un mode de fonctionnement imposé par la compétition économique et la rareté des ressources financières.
Dans ce contexte, les discours politiques appelant à la solidarité, au service public ou au bien commun peinent à se faire entendre. Ils sont souvent réduits à des slogans creux ou récupérés par des logiques marchandes et identitaires qui fragmentent davantage la société. Or, il ne suffit pas d’invoquer de nouveaux récits idéologiques de responsabilité locale pour espérer une transformation durable. Encore faut-il qu’ils s’ancrent dans le quotidien, qu’ils redonnent aux individus une capacité d’agir collective et qu’ils reconstruisent des espaces de confiance.
La société antillaise se trouve ainsi à un carrefour historique. Le délitement actuel n’est pas une fatalité, mais il ne pourra être enrayé sans une remise en question profonde du modèle économique et social dominant. Tant que l’égoïsme restera la norme implicite, tant que la réussite individuelle primera sur la cohésion collective, la violence continuera de prospérer. Purger l’abcès identitaire, repenser la diversité culturelle à l’aune de l’anthropologie contemporaine, réinvestir les solidarités d’antan sans renoncer à la modernité : telles sont les conditions d’un possible sursaut.
À défaut, la Guadeloupe et plus largement les Antilles devront apprendre à vivre avec une violence devenue chronique, symptôme d’une société qui a perdu le contrôle de son avenir. Mais si le vide existentiel actuel est reconnu pour ce qu’il est, il peut aussi devenir le point de départ d’une prise de conscience collective. L’enjeu n’est rien de moins que la reconstruction d’un projet de société capable de conjuguer enracinement, justice sociale et horizon commun, dans un monde où l’individualisme sans frein rend, chaque jour un peu plus, la vie collective invivable.
*Economiste et juriste en droit public