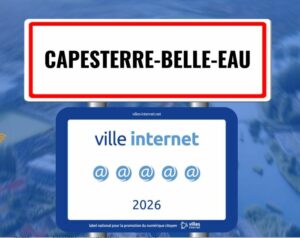Le préfet de région Thierry Devimeux poursuit sa tournée des problématiques locales. Sur le terrain, lors de rencontres, il prend le pouls des populations : avec les producteurs de bananes, avec les représentants des usagers de l’eau. Ce matin avec les acteurs de la filière canne.
SICAGRA. Cela veut dire SICA Guadeloupe Restructuration Agriculture. Tout un programme. C’est donc dans les locaux de cette société agricole, à Sainte-Marie d’Arles, Le Moule, que le préfet était attendu par la plupart des représentants des syndicats agricoles, des Sicas, de l’Usine sucrière de Gardel et de la Sucrerie et Rhumerie de Marie-Galante (SRMG) et de la Chambre d’agriculture.
Parce que la diversification intéresse aussi la filière canne-sucre-rhum, il y avait aussi Victor Nanette, président d’Iguaflhor (fruits et légumes) et Alain Bazir, directeur général d’Iguavie (élevage).
Et puis Olivier Degenman, directeur de l’Agriculture.
Invités aussi : Christian Baptiste, député de la circonscription, et Patrick Dollin, président de la Commission Verte au coneil régional.
Thierry Devimeux, préfet de Région :
Appelés à s’exprimer, les différents acteurs de la filière et d’autres ont dit leurs difficultés et leurs espoirs.
Victor Nanette, président d’Iguaflhor : « Je suis, comme nous tous, pour un rapprochement des filières. Le développement de l’agriculture ne pourra se faire avec ce cloisonnement que nous connaissons bien. En effet, argumente-t-il, la plupart des exploitations professionnelles hébergent plusieurs cultures. »
Alain Bazir, directeur général d’Iguavie (ancien de Gardel, ancien de Sicas) : « Je milite pour la diversification, pour le travail interfilières. »
Yannick Kindeur, président des Jeunes Agriculteurs : « La canne et la banane sont deux piliers qu’il faut sécuriser avant de se lancer dans la diversification. Pour faire du maraîchage, de l’élevage, c’est l’argent de la canne ou de la banane qui permettent de tenir et de développer d’autres activités agricoles. »
Yannick Kindeur :
Il ajoute : « Nous avons un gros problème, c’est celui du renouvellement des générations. » On y reviendra.
Cyrille Mathieu, directeur du pôle agricole de Gardel SA, précise : « Il n’y a pas de guerre entre les filières. La canne et la banane, effectivement, financent la diversification. »
Il présente la filière : 4 Sicas, une par bassin cannier.
La SICAGRA fait de la canne, du maraîchage, son chiffre d’affaires étant constitué pour moitié par la diversification. Elle a un millier d’adhérents, dont 700 planteurs de cannes, sur tout le sud de la Grande-Terre.
On attaque le dur : « Il y a le feu dans la maison agricole des DOM ! », lance Cyrille Mathieu. Le feu c’est la réforme du POSEI engagée par Bruxelles.
Qu’est-ce que c’est que le POSEI ? Le « Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité » (POSEI) soutient les régions ultrapériphériques de l’Union européenne (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, pour la France, Madère (pour l’Espagne) et Les Açores (pour le Portugal). Il a été mis en place pour rattraper les retards de développement.
Il semble que la Commission européenne ait décidé de supprimer le POSEI, de remettre une enveloppe minorée de 20% aux pays concernés afin qu’ils fassent eux-mêmes la distribution. Les grosses bénéficiaires du POSEI sont les filières cannes et banane.
On revient sur l’institutionnel : le contexte de la production agricole.
Les slides se suivent, qui apprennent beaucoup. 70% des exploitations agricoles sont sur moins de 7 hectares, moins encore à Marie-Galante.
Pour couper cette canne, deux méthodes : la mécanique, une grosse machine qui coupe, hache, jette dans une remorque, et la coupe manuelle. 90% des cannes des bassins canniers de la Grande-Terre sont coupées à la machine, donc 10% à la main dans certaines zones pentues ou quand la machine n’est pas disponible pour une trop petite parcelle. Le petit bassin cannier de la Basse-Terre est traité à la machine pour 80% de sa surface.
A Marie-Galante, la canne est coupée essentiellement à la main (80%).
« S’il n’y a pas de mains, il n’y a pas de cannes pour l’usine ! », lance Stéphane Deniaud, DG de la SRMG.

On en vient ainsi au problème de la main d’œuvre en agriculture, de plus en plus rare. En Guadeloupe, la main d’œuvre est de plus en plus haïtienne, surtout dans les champs de bananiers, en Martinique, elle vient du Costa Rica depuis ces dernières années.
Dans la filière, il y a 8 000 actifs, qui produisent 505 000 tonnes de cannes (les bassins plus Marie-Galante) pour une production de 55 à 65 000 tonnes de sucre, auxquelles il faut rajouter 80 000 tonnes de cannes pour les distilleries.
Cette production cannière alimente aussi l’usine Albioma qui fournit 10% de l’électricité du continent. Elle dégage, après passage à l’usine, 35 000 tonnes d’écumes qui donnent un compost bio offert aux agriculteurs. L’usine de Gardel l’offre gracieusement, rendue bord de champs.
La sole cannière baisse légèrement d’année en année. Elle représente encore 48% de la Surface agricole utile (SAU).
Cyrille Mathieu : « Sur les deux unités, de Gardel et de la SRMG, nous commes au creux de la vague. Il ne faut surtout pas descendre beaucoup plus bas (2024 est la pire récolte/production de sucre de ces dernières années, NDLR). La remontée va être lente, mais nous ne désespérons pas. »
Quels sont les objectifs de cette filière ? 850 000 tonnes de cannes, dont 650 000 pour Gardel, 120 000 pour la SRMG, 80 000 pour les distilleries.
Cyrille Mathieu toujours martèle : « II faut pérenniser, développer la filière bio, optimiser les dispositifs logistiques et organisationnels, maîtriser la durée de la campagne, augmenter les rendements. »
La concurrence ? Il y a les sucres spéciaux de l’Île Maurice, à côté de la Réunion, qui frappe aux portes de l’Europe, le MERCOSUR qui peut concurrencer les productions de sucre français d’Outre-mer avec le sucre roux, très prisé sur le marché européen qui représente un gâteau de 250 000 tonnes de sucre consommé chaque année.
« Si on ne fait pas attention, prévient M. Mathieu, d’autres vont venir sur le marché. »
Autre dossier et pas des moindres : le renouvellement des générations.


Thierry Devimeux : « Combien de jeunes s’installent chaque année ? » Réponse de Yannick Kindeur : une quinzaine. Il en faudrait 200.
Le directeur de l’agriculture, Olivier Degenmann, explique : « Il en faudrait effectivement 200 pour réussir le plan de souveraineté alimentaire. Mais, ajoute-t-il, il y a de moins en moins de dossier de jeunes voulant faire de la canne. »
Voyons cette canne dont les agriculteurs disent qu’elle est mal payée. Une partie (30%) de son prix est lié à la richesse en sucre. Or, il y a une baisse de richesse partout dans le monde, constatée mais non expliquée. C’est comme ça.
Parmi les aides qui permettent de compenser ce manque à gagner par la vente d’une canne moins riche, il y a le POSEI. On y revient, de manière lancinante.
« Si on perd le POSEI, dit Yannick Kindeur, nous serons dans une enveloppe globale qui sera remise à l’Etat. On ne sait pas, en final de compte, ce qui nous reviendra. Il y a des filières puissantes : la viticulture, les céréaliers… »
Yannick Kindeur :
A ce stade des discussions, Thierry Devimeux donne quelques impressions.
« Quand la société se désintéresse de l’agriculture, les filières agricoles dépérissent. »
La canne est importante, c’est une référence du paysage guadeloupéen. »
« Vous êtes importants dans la lutte contre les effets du changement climatique. »
« Il est fondamental que nos jeunes agriculteurs soient bien formés. »
Pascal Cazalan, de la Chambre d’agriculture : « La plupart de ceux que vous voyez ici ont été formés au lycée agricole. »
Cyrille Mathieu revient au foncier : « Le foncier est un problème politique qu’il faut régler. Il y a une vraie urgence à traiter ce problème. Le foncier est là. Il faut le reconquérir. »
On passe sur le foncier agricole appartenant aux collectivités.

« Il y a une difficulté pour récupérer le foncier agricole, lance Pascal Cazalan. Comment récupérer les terres de la réforme foncière qui ont été distribuées au moment de la fermeture des usines à sucre ? C’était dans les années 1980. Ces terres qui n’étaient plus aux usines ont été occupées par ce qu’on appelait des colons. Aujourd’hui ce sont les enfants des enfants de ces personnes qui ont ces terres. Sans aucun bail. Ils considèrent que ce sont des terres de famille et ils attendent pour spéculer et en attendant un jour prochain où elles vaudront cher, ils ne font rien sur ces terres. »
10 000 hectares de la SAU ne seraient effectivement pas utilisées.
« Si on pouvait mettre de ces terres 4 000 hectares à la disposition des jeunes qui veulent s’installer, ce serait une grande victoire ! », disent les uns et les autres.
« Ce qu’il faut, c’est valoriser chaque hectare des terres disponibles », soutient Olivier Degenmann. Malheureusement, et tout le monde dans la pièce le reconnaît, beaucoup de petits agriculteurs ne sont pas des professionnels. Ils ont un emploi et « font de la canne ». D’où des rendements médiocres, parfois moins de 20 tonnes de cannes à l’hectare…
Bruno Wachter, de l’UPG, déplore : « Chaque fois qu’il y a eu un conflit en Guadeloupe, que les bateaux ne pouvaient pas livrer, nous avons pu nourrir notre population. Chaque fois que la situation est redevenue normale, cette même population est revenue dans les rayons frais des supermarchés. »
Une question de culture…
Cyrille Mathieu demande qu’on réfléchisse à monnayer certaines évidences qui disent l’importance de la filière canne : le puits carbone, le fait que la culture de la canne maintient les sols, dégage de l’oxygène, protège des effets du changement climatique, évite l’érosion… constitue une attraction pour les touristes… Etc.
Thierry Devimeux :
L’avis du politique :
André-Jean Vidal
aj.vidal@karibinfo.com