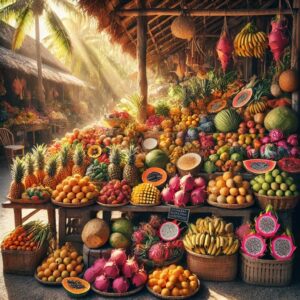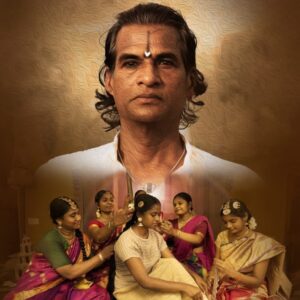PAR DIDIER DESTOUCHES*

Entre la présidence de François Hollande (2012–2017) et la seconde nomination de Sébastien Lecornu à Matignon ( octobre 2025), la cinquième République a connu une mutation silencieuse mais décisive : celle du passage d’une République politique à une République managériale, fondée au départ sur la volonté d’affirmer au sein du pouvoir la rationalité technicienne et la neutralisation du conflit idéologique.
Cette période marque à la fois la continuité du présidentialisme rationalisé et l’effondrement du clivage gauche-droite, absorbé par une logique de gouvernance du centre.
Sous le président François Hollande, la social-démocratie s’était déjà technicisée, substituant la concertation et la maîtrise budgétaire à l’affrontement doctrinal. Emmanuel Macron a systématisé cette approche en érigeant la compétence administrative et l’efficacité économique en sources légitimes du pouvoir.
Le « macronisme » a ainsi inauguré une ère de post-politisation du gouvernement, où l’action publique se définit moins par des valeurs que par des indicateurs. Le premier ministre Sébastien Lecornu, issu à la fois de la technostructure et de la droite gaulliste, prolonge cette trajectoire en assumant une « gestion de crise permanente » de la République, symbolisant la transformation de la fonction gouvernementale en fonction de direction politique exclusive et managériale en confortant le choix du président de la République de ne pas considérer le résultat des urnes comme sacré mais comme une simple variable dont on peut ou pas tenir compte.
D’un point de vue doctrinal, cette période peut être interprétée selon plusieurs grilles d’analyse et de lecture :
• institutionnelle, comme la consolidation d’une “Cinquième République post-gaullienne” selon le professeur Olivier Beaud;
• philosophique, comme l’entrée dans une “post-démocratie” comme l’analyse Crouch, où les formes demeurent mais les choix politiques se technicisent ;
• sociologique, comme la montée du gouvernement des experts au détriment du débat citoyen théorisée par Pierre Rosanvallon.
Cette reconfiguration du régime s’est accompagnée d’une hybridation idéologique des politiques publiques. D’un côté, et contrairement à ce que l’on pense, des mesures de gauche ont subsisté grâce au macronisme :
• hausse du budget de l’éducation et de la transition écologique,
• dispositifs de protection sociale et d’aides ciblées (prime d’activité, indemnité inflation, politiques de santé publique),
• planification écologique et investissements verts
Mais aussi l’intégration constitutionnelle de droits nouveaux comme l’IVG et l’augmentation substantielle du nombre de femmes au sein de l’hémicycle.
De l’autre, des orientations de droite se sont affirmées sous le macronisme :
• réforme du marché du travail (ordonnances de 2017),
• politique sécuritaire et immigration,
• renforcement du contrôle budgétaire,
• gestion verticale de l’État.
Ainsi qu’un renforcement de l’indépendance internationale de la France et de son exception culturelle.
Le résultat est une République du « en même temps » et du « centre absolu », où l’alternance s’efface derrière une gouvernance pragmatique, autoritaire dans sa méthode et libérale dans son esprit. Le pouvoir, désormais, ne prétend plus incarner un camp, mais garantir la résilience d’un système.
Les gouvernements sous Macron (en particulier ceux dirigés par Edouard Philippe, Élisabeth Borne et Jean Castex) apparaît comme la phase d’institutionnalisation de ce modèle : un État néo-gaullien dans sa forme, néo-libéral dans son contenu et très technocratique dans sa culture.
Ainsi, la Ve République entre, sans rupture constitutionnelle formelle, dans un nouveau cycle historique : celui d’une République managériale post-idéologique, où la légitimité démocratique se mesure moins à la participation qu’à la performance.
La période 2017–2025, est par exemple marquée par la personnalisation du pouvoir présidentiel, la gestion auto-centrée de crises multiples et la transformation du débat public, ce qui révèle en effet plusieurs formes d’irrationalité politique, au sens de Max Weber, Raymond Aron ou Pierre Rosanvallon : un retour du symbolique, de l’émotion et de la croyance dans un régime pourtant fondé sur la rationalité technocratique.
La Ve République macronienne repose d’abord sur une hyper-rationalisation du pouvoir exécutif (usage des ordonnances, du 49.3, de la verticalité de l’État), mais cette rationalité produit… une perte de sens politique. Le pouvoir, devenu gestionnaire et managériale doit sans cesse réintroduire de l’émotion pour justifier ses décisions : mise en scène de l’autorité, communication de crise, incarnation présidentielle.
Selon Raymond Aron dans « Démocratie et totalitarisme, 1965 », les régimes rationalisés sont toujours menacés par un “besoin d’affectivité politique” compensatoire. Ainsi, Macron oscille entre le calcul technicien et l’affect monarchique : rationalité du management d’État, mais hélas irrationalité du culte présidentiel.
La référence constante à la « continuité de l’État » devient une valeur quasi mystique, un mythe de stabilité invoqué face à toute contestation (Ouragan Irma, affaire Benalla, gilets jaunes, retraites, pandémie, crises ultramarines). Cette sacralisation de la stabilité traduit une irrationalité institutionnelle : on défend l’ordre pour lui-même, indépendamment de sa légitimité démocratique. C’est une forme de fétichisme institutionnel, où la permanence de la forme prime sur la réalité du consentement.
Sous la présidence Macron, la politique devient spectaculaire et performative. Chaque réforme, chaque crise donne lieu à une narration (le “en même temps”, le “quoi qu’il en coûte”, le “réarmement civique”), qui fonctionne davantage comme un récit mobilisateur que comme une analyse rationnelle. La communication présidentielle fabrique une dramaturgie permanente, où le chef de l’État se met en scène comme acteur du destin national, avec ce point culminant d’absurdité où il accepte la démission d’un Premier ministre nommé trois semaines en amont, avant de lui confier une mission de deux jours et de le renommer juste après Premier ministre (Sébastien Lecornu). Un acte inédit et aussi inexplicable que la dissolution de juin 2024, si ce n’est par la psychologie…
Guy Debord parlait déjà de la “société du spectacle” : la rationalité s’efface devant la mise en image du pouvoir. Ici, le spectacle devient la substance même de l’action publique. Les réseaux sociaux, les “consultations citoyennes” et les débats médiatisés remplacent les lieux traditionnels de délibération rationnelle (Parlement, partis, syndicats).
Mais, ces espaces produisent souvent plus d’affects que d’arguments : indignation, ironie, polarisation. La parole politique se fragmente, l’émotion supplante la raison. Ce que Jürgen Habermas appelait la “sphère publique rationnelle” devient une sphère émotionnelle et réactive.
L’administration centrale (hauts fonctionnaires, conseillers, économistes) fonctionne sous Macron, selon une logique instrumentale de l’efficacité. Mais la société française, elle, réagit selon des logiques de reconnaissance, d’identité et d’injustice perçue. Ce décalage alimente un conflit cognitif : le pouvoir parle en langage d’indicateurs, la population répond en langage de colère.
C’est une irrationalité systémique : deux rationalités qui ne se comprennent plus. Le politiste Pierre Rosanvallon évoque à ce sujet une “crise de la traduction démocratique” : la compétence a remplacé la représentation. Les grands conflits et mouvements (Gilets jaunes, manifestations contre la réforme des retraites, marches écologiques) traduisent un besoin d’émotion politique collective, là où les canaux de représentation sont épuisés. Ces émotions deviennent des formes de participation négative : refus, colère, indignation. Elles réinjectent du sens dans un système qui en manque, et un désir d’horizontalité politique, mais sans déboucher sur un projet commun.
Le macronisme repose enfin sur l’idée qu’il serait rationnel de dépasser la gauche et la droite, et de proposer un cadre idéologique qui serait celui de l’affrontement des progressistes et des conservateurs, progressistes constitués en bloc central puis socle commun mais incapable de dépasser les divisions entre ex-socialistes et ex-gaullistes en réalité. En outre, ce dépassement devient lui-même une croyance en la rationalité du centre, qui masque ses propres présupposés libéraux et technocratiques.
Cette posture produit ainsi une illusion de neutralité, alors que toute politique reste située, normative, orientée. Le « en même temps » l’incarnant va représenter l’échec même de cette quête qui ne correspond pas à la montée des radicalités idéologiques et discursives au sein de la société française, alimentée par l’usage des réseaux sociaux et nombre de fake news.
“Le refus du clivage est encore un clivage : celui de ceux qui croient à la fin de la politique » selon le philosophe Marcel Gauchet, dans La démocratie contre elle-même, 2002. Le discours sur la “nécessité de réformer” devient une rhétorique quasi religieuse : la réforme est présentée comme un bien en soi, une fin morale, non un moyen. Cette obsession du changement perpétuel traduit une irrationalité performative : le mouvement pour le mouvement, sans horizon de sens collectif. Elle substitue à la délibération sur le but, une croyance dans la vertu intrinsèque de l’action publique.
Sous Macron, la France a donc connu une hypertrophie de la rationalité administrative et une atrophie de la rationalité politique.
Mais cette hyper-rationalité engendre ses propres formes d’irrationalité :
• culte du chef rationnel,
• fascination pour la stabilité,
• surmédiatisation du pouvoir,
• émotion sociale permanente,
• illusion du consensus.
C’est ce que Max Weber appelait la “cage d’acier de la raison instrumentale” et qui est l’autre nom du macronisme : un système si rationnel qu’il en devient absurde.
En définitive la vie politique française n’est plus irrationnelle parce qu’elle serait chaotique, mais parce qu’elle a trop voulu l’être rationnellement. Tel est le legs du macronisme.
*Maître de conférences HDR à l’université des Antilles
CREDDI – Faculté des sciences juridiques et économiques