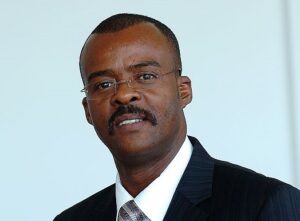PAR JEAN-MARIE NOL*
Le scénario d’un rattachement institutionnel direct de l’Outre-mer français à l’Union européenne, encore tabou il y a quelques années, semble aujourd’hui faire son chemin dans les cercles politiques les plus fermés et économiques les plus lucides.
Derrière les discours officiels empreints d’attachement républicain et de continuité nationale, se profile en réalité une logique comptable et stratégique : celle d’une France qui, étranglée par sa dette, chercherait à déléguer une partie du fardeau financier que représente la gestion de ses territoires ultramarins à l’Union européenne. Ce basculement, loin d’être une rupture brutale, s’inscrirait dans un continuum historique amorcé depuis le traité de Rome de 1957, qui a progressivement arrimé les Outre-mer à la construction communautaire.
Depuis plus d’un demi-siècle, l’Union européenne a élaboré deux cadres distincts pour organiser sa relation avec ces territoires : les régions ultrapériphériques (RUP), intégrées pleinement dans le marché intérieur, et les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), qui jouissent d’un statut d’association plus souple. La France, particularité unique en Europe, cumule les deux régimes.
Six de ses territoires — Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin — sont des RUP, c’est-à-dire des morceaux de l’Union européenne situés aux confins du globe. D’autres, comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Saint-Pierre-et-Miquelon, relèvent du statut de PTOM, liés à l’Union mais non intégrés juridiquement à son espace communautaire.
Cette architecture complexe, patiemment tissée, a permis à l’Union de devenir le principal bailleur et partenaire de développement de ces territoires lointains.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 13 milliards d’euros ont été versés aux RUP françaises sur la période 2014-2020, auxquels s’ajoutent près de 2 milliards supplémentaires dans le cadre du nouveau cadre financier 2021-2027. Les PTOM, de leur côté, bénéficient d’un flux constant d’aides du Fonds européen de développement (FED) et d’autres instruments communautaires, auxquels s’ajoutent des programmes sectoriels comme Horizon Europe, Erasmus ou Life.
Derrière ces chiffres se cache une réalité : sans le soutien financier massif de l’Union, nombre de politiques publiques ultramarines — de l’agriculture à la recherche, en passant par l’éducation et les infrastructures — seraient tout simplement intenables pour les budgets hexagonaux.
Or, la France, engluée dans une spirale d’endettement public et d’inertie de politique budgétaire, semble aujourd’hui atteindre les limites de sa capacité à assumer seule la charge de ses Outre-mer. Avec une dette dépassant 115 % du PIB et un déficit primaire abyssal, l’État français se trouve dans une situation où toute marge de manœuvre politique est devenue illusoire.
Les dépenses sociales, qui représentent 32,3 % du PIB — soit le taux le plus élevé de toute l’Union — absorbent plus de la moitié des dépenses publiques. Et la population française , majoritairement hostile à toute réforme d’ampleur (réduction des prestations, recul de l’âge de la retraite, économies sur la santé), rend tout ajustement interne politiquement suicidaire.
Comme le souligne l’économiste Patrick Artus, il est désormais probable que la contrainte viendra de l’extérieur — de Bruxelles ou de Francfort — plutôt que d’une initiative nationale.
Dans cette optique, le rattachement institutionnel de l’Outre-mer à l’Union européenne pourrait devenir une solution habile à double détente. D’une part, il soulagerait directement le budget français en transférant une part du financement des politiques publiques ultramarines vers les instruments européens.
D’autre part, il renforcerait le rôle géostratégique de l’Union dans les zones Pacifique, Atlantique et Caraïbes, en consolidant sa présence mondiale face à la Chine et aux États-Unis. En d’autres termes, ce scénario ne serait pas tant un abandon qu’un réalignement, conforme à une logique européenne de mutualisation des coûts et des intérêts stratégiques.
Cette perspective européenne trouve d’ailleurs un écho dans l’expérience britannique avec le Commonwealth, cette communauté d’États issue de l’ancien empire colonial du Royaume-Uni. Nombre de ces pays, tout en accédant à l’indépendance politique, ont conservé des liens économiques, juridiques et culturels étroits avec Londres, bénéficiant d’accords de coopération, de préférences commerciales et d’aides au développement.
Ce modèle, fondé sur un partenariat souple mais structuré, a permis au Royaume-Uni de maintenir une influence mondiale sans assumer directement le coût de la gestion administrative de ses anciens territoires. À bien des égards, le scénario d’un rattachement institutionnel direct de l’Outre-mer français à l’Union européenne s’inscrirait dans une logique comparable : celle d’un transfert progressif de responsabilités vers une entité supranationale, tout en préservant des liens historiques et stratégiques durables.
Cependant, ce basculement ne serait pas sans conséquences politiques et symboliques. Car rattacher directement les Outre-mer à l’Union reviendrait à reconfigurer le lien historique, affectif et constitutionnel entre la République et ses périphéries. Il s’agirait de fait d’une semi-désétatisation et d’une disparition au préalable du statut de la départementalisation, d’où l’appui et le soutien à peine voilé au processus d’autonomie des Antilles-Guyane : les collectivités d’Outre-mer, jusqu’ici relevant de la souveraineté française, deviendraient en partie des entités autonomes placées sous tutelle institutionnelle communautaire, dépendant davantage de la Commission européenne que de Bercy ou du ministère des Outre-mer.
Une telle mutation poserait inévitablement la question du statut de la citoyenneté, du droit applicable et du rôle de la France comme État membre médiateur entre l’Europe et ses anciennes possessions.
Les arguments économiques, eux, apparaissent implacables. L’Union européenne, dans sa dernière stratégie pour les RUP adoptée en 2022, reconnaît explicitement la persistance d’inégalités structurelles dans ces territoires : pauvreté frappant plus du tiers de la population guadeloupéenne, chômage des jeunes oscillant entre 40 et 50 %, dépendance massive aux importations et fragilité des économies locales.
En intégrant directement ces territoires dans son giron institutionnel, Bruxelles disposerait de leviers accrus pour orienter les politiques de développement basé sur la production et non plus sur la consommation, accélérer la transition écologique et numérique, et promouvoir une gouvernance autonome plus cohérente à l’échelle régionale de la caraïbe .
Les fonds européens, déjà essentiels, deviendraient alors la colonne vertébrale d’un nouveau modèle économique post-départemental.
En revanche, une telle évolution réduirait la capacité de la France à revendiquer une présence stratégique autonome dans ces espaces ultramarins, qui constituent aujourd’hui la deuxième zone économique exclusive du monde. Elle impliquerait aussi de redéfinir la place des élus locaux, aujourd’hui pris entre la dépendance financière à Paris et la méfiance identitaire vis-à-vis de Bruxelles.
Ce dilemme politique, au cœur des tensions autonomistes, trouverait paradoxalement une issue dans un transfert de souveraineté silencieux vers l’autonomie, maquillé sous des arguments de rationalisation budgétaire et d’efficacité administrative.
Ainsi, derrière la technicité des statuts européens — RUP ou PTOM — se dessine peut-être l’un des grands basculements institutionnels du XXIe siècle : celui d’une Europe absorbant progressivement les périphéries postcoloniales de ses États membres pour en faire des zones de cohésion, de stabilité et d’influence.
Le scénario d’un rattachement direct des Outre-mer français à l’Union européenne n’a rien d’une utopie : il est déjà, dans ses structures juridiques, budgétaires et politiques, en gestation. Et dans un contexte de crise de la dette et de désengagement progressif de l’État central, il pourrait devenir, pour Paris comme pour Bruxelles, l’ajustement le plus réaliste à une contrainte économique devenue insurmontable.
« A pa makak ou ké aprann monté piébwa »
Traduction littérale : Ce n’est pas au singe que vous apprendrez à grimper aux arbres .
Moralité – Ce n’est pas à quelqu’un d’expérimenté qu’on apprend des choses sur son domaine !
*Economiste et juriste en droit public