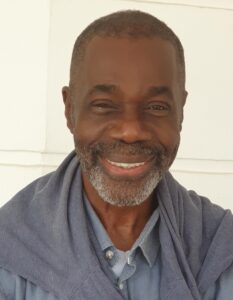PAR JEAN-MARIE NOL*
L’instabilité institutionnelle de la France est une vieille lune. Une vieille lune, se dit de ce qui semble appartenir à des temps reculés, à une époque révolue.
Renvoyer aux vieilles lunes, rejeter comme démodé, désuet, périmé. C’est en fait l’idée de stabilité politique désuète, qui n’a pas tenu ses promesses. François Bayrou prend le risque de la chute pour alerter les Français sur la gravité du moment .Face aux appels au blocage, le premier ministre centriste demande une «clarification» et provoque un vote de confiance le 8 septembre. Le RN , LFI , les écologistes, et enfin les socialistes ont déjà annoncé souhaiter son départ. Mathématiquement, aucune chance pour François Bayrou de rester Premier ministre.
De lui-même, François Bayrou prend le risque de chuter et de plonger la France dans l’instabilité politique. Pour créer un électrochoc dans la population sur le niveau d’endettement, sans attendre les motions de censure de ses opposants, le Premier ministre a annoncé, ce lundi, solliciter la confiance de l’Assemblée nationale le 8 septembre.
Face à un avenir politique grippé, la question de l’alternative à la crise devient brûlante, tant en France qu’en Guadeloupe. L’instabilité institutionnelle nationale, que l’on croyait reléguée aux vieilles lunes de la IVe République, revient avec force, nourrie par un climat de défiance généralisée et par un système représentatif qui peine à offrir de la clarté. L’épisode François Bayrou, qui a choisi de provoquer volontairement un vote de confiance dont il sait qu’il ne sortira probablement pas vainqueur, illustre à lui seul cette situation paradoxale.
Le Premier ministre, en s’appuyant sur l’article 49, alinéa 1 de la Constitution, cherche un électrochoc pour sensibiliser les Français à la gravité de la dette publique. Mais, son initiative, audacieuse autant que désespérée, semble vouée à précipiter le pays dans une nouvelle phase d’instabilité politique. En l’absence de majorité absolue, avec une opposition unie dans son rejet, François Bayrou joue sa survie et, par ricochet, fragilise encore davantage un exécutif déjà affaibli.
François Bayrou est prêt à sacrifier son avenir politique au nom de la lucidité et de la pédagogie budgétaire. Mais, le parallèle avec Emmanuel Macron qui a provoqué une dissolution de l’Assemblée nationale sur un coup de poker menteur ne convainc qu’à moitié : dans une France fracturée, où le débat public se polarise entre radicalisation parlementaire et contestation de rue, l’appel à la raison budgétaire se perd dans un vacarme de slogans.
Les mesures proposées, comme le gel des dépenses ou la suppression de jours fériés, sont immédiatement perçues comme impopulaires et injustes, laissant à ses opposants un boulevard politique. La comparaison avec une soumission militaire pour décrire l’endettement français traduit certes la gravité du diagnostic, mais renforce aussi l’image d’un Premier ministre désarmé, et d’un président condamné à l’isolement.
Cette séquence politique à Paris n’est pas sans résonance en Guadeloupe. Car, au moment où l’Hexagone s’interroge sur la solidité de ses institutions, le département d’Outre-mer traverse une crise multiforme dont la profondeur inquiète. Jamais, depuis la départementalisation, l’île n’avait semblé confrontée à une telle accumulation de fragilités.
À la violence endémique qui explose – déjà plus de 30 homicides en 2025 – s’ajoutent la prolifération des armes à feu, l’enracinement des trafics et une banalisation de la délinquance. Dans le même temps, la crise économique continue de miner les perspectives : un chômage qui touche un jeune sur trois, une économie dépendante des importations, un secteur touristique sinistré avec ses friches hôtelières abandonnées, et des prix qui restent durablement supérieurs à ceux de l’Hexagone, notamment pour l’alimentation.
La Guadeloupe souffre aussi d’un effondrement démographique silencieux mais implacable : le solde naturel est négatif depuis près de vingt ans et près d’un tiers de la population a désormais plus de soixante ans. Ce vieillissement accéléré accentue le sentiment de déclin et alourdit la charge sociale dans un contexte de services publics déjà sous tension, notamment dans le domaine hospitalier où la fuite des soignants et la crise du chlordécone continuent d’empoisonner littéralement la confiance collective.
Dans ce contexte, l’État est souvent interpellé, sommé de régler les problèmes de sécurité, de justice et de développement. Mais si ses responsabilités régaliennes sont réelles, l’impasse serait d’attendre qu’il endosse seul le fardeau d’un quotidien en crise.
L’avenir de la Guadeloupe repose d’abord sur sa capacité interne à inventer des solutions notamment le changement de modèle économique, à sortir des logiques d’assistanat ou de dépendance politique, pour se réapproprier son destin. Ce sont les élus locaux qui doivent initier des dynamiques nouvelles, mais aussi les citoyens eux-mêmes, en exerçant un contrôle plus exigeant sur ceux qui prétendent les représenter.
C’est sans doute là la clé du problème : la gouvernance locale s’essouffle, mais la résignation citoyenne accentue cet enlisement. Sans vigilance, sans exigence démocratique, toute réforme institutionnelle se réduit à un exercice formel, vite rattrapé par la défiance et le rejet. Si la France traverse une crise de confiance entre le pouvoir exécutif et ses représentants, la Guadeloupe vit une crise d’impuissance encore plus préoccupante : le sentiment qu’aucune alternative crédible ne se dessine, que les blocages sont insurmontables. Or l’histoire démontre que rien n’est figé.
L’avenir n’est pas écrit, ni à Paris, ni en Guadeloupe. Mais, il suppose que les citoyens refusent la posture du spectateur résigné et se saisissent activement de leur rôle de vigie et de force de proposition. Car à défaut d’un sursaut collectif, qu’il soit budgétaire en France ou sociétal en Guadeloupe, l’instabilité actuelle n’est pas seulement une vieille lune : elle risque de devenir une fatalité.
*Economiste et chroniqueur