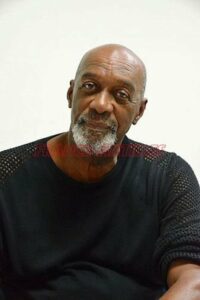PAR JEAN-MARIE NOL*
La flambée de violences que connaît actuellement la Guadeloupe ne peut se comprendre uniquement comme le symptôme d’une fracture sociétale classique comme en France hexagonale.
Elle apparaît d’abord comme le signe inquiétant d’un affaissement général de l’autorité, d’un délitement de la valeur travail, et d’une perte de repères collectifs qui laissent la société guadeloupéenne livrée à elle-même. Penser qu’une société réputée pacifiée par le progrès social et l’existence d’un certain niveau de vie d’une importante classe moyenne serait à l’abri d’un basculement dans la violence extrême est une illusion dangereuse.
L’histoire locale, marquée par l’esclavage, la période coloniale et des épisodes de guerres meurtrières, démontre que les sociétés créoles n’ont jamais été totalement éloignées de la brutalité. En analysant les choses sous cet angle de vue, faudrait -il alors se référer à l’épigénétique ou encore à la neuro -psycho généalogie ?
Quoiqu’il en soit, la violence à laquelle nous assistons en Guadeloupe interpelle jusqu’à la sidération. Or, cela fait nombre d’années que les guadeloupéens se sont habitués à l’omniprésence de la violence au sein même du tissu social. Certes, elle a toujours existé, surtout en Guadeloupe, pays éruptif par excellence et dont la tradition nationale fait de la confrontation le mode de résolution des conflits économiques et sociaux.
Les tensions inhérentes aux revendications syndicales catégorielles ou aux manifestations de rue notamment contre les injustices. Mais, la violence à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui est différente. Celle-ci est sortie du monde du travail opposant des catégories de population pour devenir un simple mode d’expression individuelle.
La violence n’est plus comme avant le symptôme de l’effondrement social et de l’augmentation de la pauvreté, mais la condition d’une déliaison sociétale avec le développement de la délinquance allié à la consommation de drogue, interprétée comme une libération de l’individu dans une société de loisirs où le travail n’a plus sa place d’antan, aboutissant à l’impossibilité d’une socialisation et d’une nouvelle identification culturelle en dehors des catégories internes à chaque cadre d’interprétation des nouveaux codes de la société antillaise.
Aujourd’hui encore, la Guadeloupe vit une situation où l’usage de la force tend à devenir un langage, la délinquance une façon de dire son existence et sa colère, dans un contexte où les cadres traditionnels de régulation se sont affaissés.
Les meurtres commis depuis le début de l’année, trente et un pour la plupart par armes à feu, traduisent une banalisation progressive de la violence dans les esprits. Celle-ci s’exprime souvent de manière invisible, imprévisible, échappant aux radars habituels de la prévention. Elle n’épargne ni les plus jeunes ni les plus vulnérables et elle franchit des seuils inquiétants dans l’espace public, où les rapports de force remplacent le dialogue.
Des enfants, des personnes âgées, des femmes deviennent désormais des cibles, et l’agression collective d’un individu isolé pour un simple vol de chaîne en or ou d’un deux-roues type moto et scooter est en train de devenir un phénomène ordinaire. Ces comportements se nourrissent d’une culture ambiante où la musique, les films, la télévision, la publicité, les réseaux sociaux, diffusent le culte de la force, de la contestation de la fermeté, des addictions et de la domination de l’autre. Ces influences trouvent un terrain fertile chez des jeunes souvent livrés à eux-mêmes, sans repères solides, sans cadre éducatif ferme, sans relais familiaux stables, et qui peuvent présenter aussi des pathologies mentales en hausse dans toute la sphère sociétale .
Le narco‑trafic avec son corollaire de la circulation des armes en provenance des îles voisines , qui prospère dans des zones urbaines où l’État est affaibli et les perspectives économiques rares, joue aussi sans conteste un rôle central dans cette flambée.
Mais, il ne faut pas se limiter à cette seule explication. La violence actuelle s’enracine dans une « déliaison sociale » plus profonde, où se conjuguent l’érosion de l’autorité parentale, la disparition des valeurs avec l’explosion des familles monoparentales, la démission des institutions éducatives, la perte d’influence de l’Église, la faiblesse du bras séculaire de l’État, l’épuisement des grands récits politiques et l’exacerbation de passions identitaires.
À cela s’ajoute une adaptation douloureuse du modèle social français aux contraintes d’une économie insulaire confrontée à l’endettement, la dette et au chômage. La violence devient alors un mode d’expression individuelle, un moyen de s’affirmer dans un monde où le travail, jadis structurant, a perdu de sa centralité, et où l’identité collective ne parvient plus à se redéfinir.
Le sociologue Durkheim, déjà, voyait dans les grandes mutations de son temps la source d’un déracinement et d’une montée des violences. Sa réflexion résonne cruellement dans la Guadeloupe d’aujourd’hui. Ce n’est plus tant l’effondrement brutal du monde social qui explique les drames, mais l’installation progressive d’un état de déliaison où les normes ne s’imposent plus, où l’autorité se délite et où la violence cesse d’être exceptionnelle pour devenir un horizon familier.
Ce phénomène, qui échappe à la simple lecture sécuritaire, devrait alerter tous ceux qui croient encore qu’une société créole, forte de son passé douloureux, serait immunisée contre les dérives les plus graves. L’urgence est désormais la réhabilitation de l’autorité, mais surtout de reconstruire des mécanismes d’inhibition, de redonner du sens aux règles collectives par un changement du modèle économique et de refonder des repères partagés pour éviter qu’une culture de la violence ne continue à s’enraciner durablement dans la conscience guadeloupéenne.
*Economiste et chroniqueur