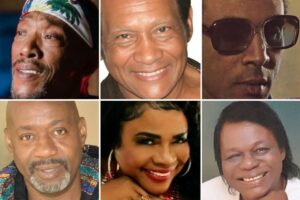PAR JEAN-MARIE NOL*
Depuis 2017, Emmanuel Macron s’est imposé comme un président dont la pensée intrigue, fascine ou agace, tant sa manière de gouverner semble s’écarter des sentiers battus de la politique française. Ses adversaires le voient tour à tour comme un stratège machiavélique, un joueur de poker imprudent ou un réformateur visionnaire mais en échec.
Sa trajectoire brouille les repères classiques gauche-droite et alimente une théorie persistante : celle d’une stratégie secrète, construite autour de la mise en tension volontaire du système politique et financier français, pour provoquer un choc et donc une catharsis dont l’objectif serait, à terme, le redressement de la nation.
Dès son accession à l’Élysée, Emmanuel Macron avait posé son diagnostic : la France est prisonnière d’un modèle socio-économique devenu insoutenable.
Son livre Révolution publié en 2016 annonçait déjà la couleur, fustigeant trente années d’inaction et de lâcheté politique où l’endettement avait remplacé la croissance. Pourtant, ironie de l’histoire, son premier mandat et la crise du Covid ont accéléré ce qu’il dénonçait : la dette est passée de 97 % à 116 % du PIB, soit aujourd’hui une dette de l’ordre de près de 3 350 milliards d’euros, aggravant une dépendance vis-à-vis des marchés financiers et des institutions européennes.
Aux yeux de ses critiques, cette contradiction est la preuve de son échec. Pour d’autres, elle témoigne au contraire d’un plan stratégique plus subtil : conduire la France vers une crise majeure, seule capable de contraindre un peuple de gaulois réfractaires rétif à toute réforme à accepter des mutations profondes inhérentes aux enjeux cruciaux du XXIᵉ siècle .
La dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024 illustre ce paradoxe. Pourquoi un président affaibli aurait-il pris le risque de remettre les clés du pouvoir entre les mains du Rassemblement national ou d’une gauche reconstituée autour du nouveau Front Populaire ? L’hypothèse d’un calcul politique s’impose de toute évidence : provoquer une cohabitation avec un RN sans expérience gouvernementale afin de l’exposer à l’épreuve du réel, et donc de l’user avant la présidentielle de 2027.
Ce coup de poker, qui a semé un chaos institutionnel inédit ainsi qu’une fragilité économique chronique , s’inscrit dans une logique de mise à l’épreuve, au prix d’une instabilité politique qui inquiète autant qu’elle intrigue. Comme dans la stratégie attribuée à Lao Tseu sur la sagesse de l’eau : « L’eau de la rivière ne se dispute jamais avec les obstacles, elle les contourne simplement », le président semble préférer contourner les obstacles plutôt que de les affronter de front, quitte à créer un désordre temporaire pour réorganiser le paysage politique et transformer l’économie par une disruption.
Mais, derrière le théâtre institutionnel se cache un second front : celui de l’économie. Emmanuel Macron, ancien banquier d’affaires que l’on qualifie de Mozart de la finance , croit profondément aux vertus de la politique de l’offre. Allègement des charges fiscales, baisse de l’impôt sur les sociétés, assouplissement du droit du travail, simplification de la taxation du capital : toutes ces réformes visaient à libérer les entreprises et à attirer les investisseurs.
Toutefois, en l’absence de réduction équivalente des dépenses publiques et sociales, elles ont accentué le déficit budgétaire. Le pari était clair mais risqué : creuser les déficits à court terme pour espérer récolter les fruits d’une croissance future plus dynamique. Or, dans une société française attachée à son modèle social, ces choix ont nourri la colère populaire et renforcé l’image d’un président au service des élites et des riches .
Là encore, les critiques y voient une faute politique majeure. Mais si l’on adopte une grille de lecture prospective stratégique, plus fine que celle de la majorité des politologues, cette accumulation de tensions économiques et sociales pourrait n’être qu’une étape : créer une situation financière intenable afin de rendre inéluctables les réformes structurelles que la France refuse depuis des décennies.
En d’autres termes, utiliser la théorie du chaos comme levier de transformation. Cette hypothèse expliquerait la persistance de Emmanuel Macron à maintenir un cap impopulaire, même face aux Gilets jaunes, aux grèves massives contre la réforme des retraites ou au mouvement informe de mécontentement actuel qui menace de bloquer le pays en septembre 2025.
Au-delà de l’économie, le président projette aussi une vision de long terme. La France doit se préparer à une double disruption : technologique et écologique. Son soutien appuyé aux startups, à l’intelligence artificielle et à la transition numérique témoigne d’une volonté de faire du pays un hub mondial de l’innovation.
Parallèlement, le Plan Climat et les initiatives pour développer les énergies renouvelables montrent son ambition de positionner la France comme leader de la transition écologique. Derrière les turbulences politiques et budgétaires se dessine ainsi un projet : placer la France en première ligne des grandes mutations globales, quitte à traverser une zone de fortes turbulences.
Cette stratégie secrète repose sur une conviction : seule une crise peut forcer un pays à rompre avec ses habitudes et à accepter les changements radicaux nécessaires à sa survie. Et en ce sens, force est de souligner le caractère contemporain de la citation de Jean Monnet l’un des pères de la construction européenne : « Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. »
En fragmentant le paysage politique, en exposant ses adversaires aux difficultés du pouvoir, en laissant filer la dette jusqu’au point critique, Macron mise sur un effet de seuil. Lorsque l’orage éclatera, il espère que la France n’aura d’autre choix que de se réinventer dans la crise.
Mais, ce pari comporte un risque colossal. La « bordélisation » assumée du système peut autant conduire à une recomposition politique qu’à un effondrement durable de la confiance citoyenne et des marchés financiers. Le chef de l’État joue avec le feu, comptant sur sa capacité à maîtriser les flammes. Seul l’avenir dira s’il aura su transformer le chaos en levier de redressement ou s’il aura précipité la France dans une crise plus profonde encore avec au bout l’émergence d’un régime autoritaire.
Pour l’heure, il reste fidèle à son adage implicite : ne pas se fier aux apparences. Car comme le dit un proverbe créole, « akansyel pa riban » : l’arc-en-ciel n’est pas un ruban. Derrière le désordre apparent de la demande d’un vote de confiance voué à l’échec assuré pour François Bayrou, pourrait bien se cacher la cohérence d’une stratégie machiavélique implacable qui devrait à terme transformer en profondeur les fondamentaux de la politique et surtout de l’économie française.
*Economiste et juriste en droit public