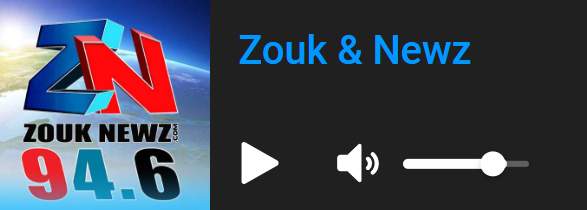PAR JEAN-MARIE NOL*
L’intervention militaire américaine au Venezuela, annoncée comme une « attaque de grande envergure » ayant conduit à l’enlèvement du président Nicolas Maduro ainsi que de son épouse, marque un tournant brutal et sans ambiguïté dans la géopolitique régionale.
Elle signe le retour assumé de la diplomatie de la force dans la Caraïbe, renouant avec une tradition interventionniste ancienne des États-Unis, théorisée au début du XXe siècle par Theodore Roosevelt sous le nom de politique du Big Stick autrement dit du « gros bâton ».
Derrière les discours officiels invoquant la lutte contre le narcotrafic, la défense des droits humains ou la restauration de la démocratie, se dessine une réalité plus crue : celle du rapport de force, de la captation des ressources stratégiques et de la sécurisation des zones d’influence dans un monde redevenu ouvertement impérial, et surtout contrer l’influence chinoise de plus en plus palpable dans la zone de l’Amérique du Sud .
Donald Trump prévient que « ce qui est arrivé à Nicolás Maduro peut arriver à d’autres. »
Assurément c’est Cuba la prochaine cible et qui sera bientôt sur la sellette avec la politique du Big Stick si l’on en juge la situation à l’aune des déclarations de Marco Rubio, le secrétaire d’Etat américain des Affaires étrangères, d’origine cubaine, qui a laissé entendre que le président Cubain Díaz-Canel pourrait connaître un destin similaire à Nicolás Maduro. « Si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais au moins un peu inquiet », a-t-il déclaré, ajoutant que « Cuba est une catastrophe » et que le pays est « dirigé par des hommes incompétents et séniles. »
L’avertissement est très clair ,car Donald Trump indique que « les États-Unis conservent tous les avoirs et les actifs vénézueliens extérieurs jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits du futur du Venezuela. » Donald Trump affirme par ailleurs que les compagnies pétrolières américaines vont s’implanter au Venezuela, et de poursuivre sur le même ton menaçant que les Etats-Unis vont « diriger le pays » et y réinstaller des compagnies pétrolières américaines. C’est là le signe incontestable d’une vassalisation du Venezuela.
Les Etats-Unis n’ont « pas peur » d’envoyer des troupes au sol au Venezuela, a assuré le président américain, lors de la conférence de presse samedi soir.
Pour les Antilles françaises, cette séquence guerrière constitue un avertissement majeur, une leçon historique qu’il serait dangereux d’ignorer, car sans nul doute le processus de décolonisation des peuples est en train de muer et changer de nature du fait de la nouvelle donne géostratégique mondiale. La politique de la force de Donald Trump devrait faire des émules partout dans le monde et désormais plus rien ne s’oppose à que la Chine envahisse Taiwan par la force militaire et même la France n’y échappera pas, car la situation internationale permet aujourd’hui de recourir à la force ainsi que s’appuyer sur la loi du plus fort pour préserver les intérêts bien compris des grandes puissances.
Et force est de souligner que c’est la réaction alambiquée du président Macron qui oblige à réfléchir pour les évènements géostratégique de l’avenir pour les pays dits d’Outre-mer, car pour Emmanuel Macron, le peuple vénézuélien ne pourrait que se « réjouir » d’avoir été « débarrassé » de la « dictature Maduro » à la suite de l’attaque américaine ayant conduit au renversement du régime et à la capture du président Maduro en exercice.
Le chef de l’État français va plus loin : il plaide pour qu’une transition politique soit assurée « au plus vite » par Edmundo González Urrutia, le candidat de l’opposition à l’élection présidentielle de 2024.
En tenant de tels propos, le président de la République française, sous pression comme tous les autres dirigeants du monde, semble valider indirectement une intervention militaire étrangère menée pour renverser un régime en violation flagrante du droit international.
Une position embarrassée qui apparaît pour le moins surprenante de la part d’un dirigeant à la tête d’un pays membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, censé être le garant du multilatéralisme, de la souveraineté des États et du respect des règles internationales.
La nouveauté est que le droit international peut désormais être invoqué à géométrie variable, par tout le monde, selon les intérêts géopolitiques du moment. Il y a là manifestement une rupture avec une tradition récente de la géopolitique qui pourrait faire tâche d’huile sur la politique intérieure de la France.
Dans cette perspective, il ne fait aucun doute que la revendication ancienne de souveraineté de la Nouvelle-Calédonie devrait être reléguée aux calendes grecques, et l’on peut déjà noter dans le monde un retour de la force brutale dans les relations internationales et intérieures de chaque pays avec une possible accentuation de la répression sans états d’âmes des oppositions. Je réitère mon alerte concernant la recolonisation de l’Afrique.
La doctrine du Big Stick, résumée par la célèbre maxime « parler doucement mais porter un gros bâton », visait à légitimer l’interventionnisme américain dans ce que Washington considérait déjà comme son arrière-cour naturelle. Plus d’un siècle plus tard, Donald Trump, malgré un style différent, en réactive l’essence.
L’affirmation brutale des intérêts américains, le recours à la coercition économique, la remise en cause des alliances traditionnelles et la menace militaire explicite ou implicite constituent les piliers de sa politique étrangère. Le déploiement de forces navales dans la Caraïbe, les frappes extra-territoriales contre des embarcations, les pressions sur le canal de Panama, les revendications territoriales sur le Groenland, le chantage économique exercé sur des alliés comme le Canada, l’Union européenne ou l’Australie, les menaces à l’encontre de l’Iran et de l’Afrique du Sud, et désormais l’intervention directe au Venezuela, illustrent une continuité stratégique : les États-Unis n’acceptent aucune contestation durable de leur domination régionale, surtout lorsqu’elle touche aux ressources stratégiques énergétiques, minières ou aux routes maritimes.
Dans ce contexte, la Caraïbe redevient un échiquier stratégique majeur. Comme au temps des grandes interventions du XXe siècle, les petites nations y apparaissent moins comme des acteurs souverains que comme des espaces à contrôler, à discipliner ou à exploiter. L’histoire est sans appel : entre 1898 et 1994, les États-Unis sont intervenus à quarante et une reprises en Amérique latine pour provoquer ou faciliter des changements de régime.
Onze pays sur vingt ont subi directement ou indirectement cet interventionnisme. Haïti a été occupée, la République dominicaine envahie, la Grenade frappée militairement, le Nicaragua déstabilisé à répétition, et Cuba placé sous embargo pendant des décennies. Penser que la souveraineté formelle protège les petites nations de ces logiques relève d’une illusion dangereuse, que l’actualité vénézuélienne vient une nouvelle fois dissiper.
C’est à l’aune de cette réalité que doivent être relus les débats récurrents sur l’indépendance de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane ou même de la Nouvelle-Calédonie. Les rassemblements militants, souvent sincères et porteurs d’une aspiration légitime à la dignité et à la maîtrise du destin collectif, témoignent d’un malaise profond vis-à-vis du modèle actuel, ainsi que d’une incompréhension de la nouvelle donne géopolitique mondiale.
Mais, en réalité, ils s’inscrivent dans un imaginaire marxiste d’obédience maoïste et trotskiste hérité des années 1960 et 1970, façonné par le tiers-mondisme, les luttes de libération nationale et l’illusion d’un Sud global capable de s’émanciper durablement des grandes puissances. Or ce monde a disparu avec le retour des empires.
La chute du communisme et des idéologies tiers-mondistes, l’échec économique de nombreux États indépendants, et la recomposition actuelle des rapports de force mondiaux rendent ces projets largement irréalistes, voire dangereux.
La question n’est plus de savoir si l’indépendance est moralement souhaitable ou symboliquement désirable, mais de comprendre ce qu’elle signifierait concrètement dans le contexte géopolitique et économique actuel. Souhaiterait-on réellement substituer à la tutelle française une dépendance directe ou indirecte vis-à-vis de l’impérialisme des États-Unis ?
L’histoire rappelle qu’à la fin de la Première Guerre mondiale, la France, exsangue financièrement, a sérieusement envisagé de céder les Antilles aux États-Unis pour éponger une partie de sa dette. Ce projet, resté longtemps tabou, démontre que les territoires ne sont jamais protégés par des principes abstraits, mais par des équilibres de puissance et surtout de rapports de force. Aujourd’hui encore, ces équilibres se redessinent sans considération pour les fragilités des petits territoires.
À ce verrou géopolitique s’ajoute un verrou économique d’une ampleur inédite. L’économie des Antilles françaises repose quasi intégralement sur l’architecture budgétaire et sociale de l’État français qui s’appuie sur une puissante classe moyenne. La dépense publique constitue le cœur du système : près de 8 guadeloupéens et Martiniquais sur 10 vivent de l’argent public, plus de 40 % des emplois relèvent de la fonction publique, plus de la moitié des revenus des ménages dépendent des transferts nationaux, et l’activité commerciale repose sur un pouvoir d’achat largement administré.
Les entreprises locales ne dégagent pas suffisamment de valeur ajoutée en dépit de marges confortables, investissent peu et dépendent du crédit bancaire, lui-même adossé à une épargne qui fuirait instantanément en cas de rupture institutionnelle. Ce modèle est fragile, mais il tient encore grâce au soutien financier de la France hexagonale. Imaginer une indépendance dans ces conditions de changement profond de la géopolitique mondiale reviendrait à retirer la clé de voûte d’un édifice déjà instable.
Or, ce soutien commence précisément à se réduire avec le retrait financier progressif de l’État français. Les restrictions budgétaires, la baisse programmée des exonérations, le désengagement progressif de l’État traduisent l’essoufflement du modèle social français lui-même. Dans des territoires où la vie est déjà 30 % plus chère qu’en France hexagonale, cette contraction menace d’entraîner une spirale récessive majeure.
Dans un tel contexte, l’idée même d’indépendance, loin d’être un remède aux maux, interviendrait au moment exact où la base économique s’effondre, reproduisant mécaniquement le scénario haïtien, fait de désorganisation, de pauvreté structurelle et de dépendance internationale.
À cette fragilité s’ajoute désormais la révolution technologique de l’intelligence artificielle, qui bouleverse en profondeur les économies mondiales. Dans un monde où la valeur se concentre autour des données, des infrastructures numériques et des algorithmes, même les grandes puissances peinent à préserver leur souveraineté.
Pour des territoires insulaires, faiblement industrialisés, dépendants de l’extérieur et déjà en difficulté sur le plan éducatif et productif, cette mutation représente un risque existentiel. La destruction annoncée de milliers d’emplois dans le secteur tertiaire aux Antilles, la dévalorisation du travail et la perte de repères sociaux rendent toute aventure institutionnelle encore plus périlleuse.
La leçon du retour de la politique du Big Stick est donc claire pour les Antilles françaises. Le monde n’est plus à l’émancipation des petits États, mais à la consolidation brutale des sphères d’influence. La souveraineté n’est tolérée que lorsqu’elle ne contrarie pas les intérêts des grandes puissances.
Dans cet environnement, l’indépendance et l’autonomie politique sans base économique solide ne serait qu’une souveraineté de façade, ouvrant la voie à toutes les ingérences, à toutes les prédations et à toutes les dépendances.
L’enjeu réel pour la Guadeloupe et la Martinique n’est donc pas de poursuivre une rupture institutionnelle illusoire, mais de repenser en profondeur leur modèle économique et social dans un cadre protecteur. Le maintien dans le cadre du droit commun de l’article 73, renforcé par un véritable pouvoir normatif local, apparaît comme la seule voie réaliste permettant de préserver le lien financier avec la Nation française tout en accroissant la responsabilité politique locale.
La véritable urgence n’est pas constitutionnelle, elle est économique, sociale et culturelle : réhabiliter le travail, reconstruire une économie productive, investir dans la formation, anticiper les mutations technologiques et restaurer un sens collectif du mérite et de l’effort.
Dans un monde redevenu impérial, dominé par la force, la technologie et l’argent, la liberté ne se décrète pas, elle se construit en toute sécurité.
Pour les Antilles françaises, la lucidité géopolitique est désormais une condition de survie. Le retour du gros bâton américain dans la Caraïbe rappelle une vérité brutale : les illusions idéologiques coûtent toujours plus cher que le pragmatisme.
*Economiste et juriste en droit public