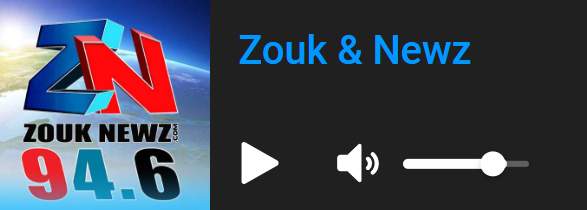PAR JEAN-MARIE NOL*
Un troisième meurtre en une semaine en Guadeloupe : désormais « La sauce coûte plus cher que le poisson » c’est la réalité de la défiance d’une société antillaise qui se désagrège dans la violence, et c’est hélas en l’état actuel des choses, un phénomène inarrêtable !
En ce début d’année 2026, la société antillaise se tient encore sous le choc des images et des récits qui ont défrayé la chronique au tournant de la nouvelle année 2026 . À Pointe-à-Pitre, dans la soirée du 4 janvier, un homme a été abattu d’une balle dans la tête en plein parcours de la Parade des Rois, premier grand rendez-vous festif du carnaval guadeloupéen, provoquant stupeur et incompréhension dans la foule réunie pour célébrer.
Et l’on déplore de surplus un 3e meurtre en 1 semaine. Il s’agit du second meurtre commis dans la zone de Pointe-à-Pitre en quelques jours, après celui du dimanche carnavalesque. Même hors du contexte festif, sur l’île voisine, Fort-de-France a récemment comptabilisé un homicide par balle d’un homme de 25 ans, lui aussi dans un contexte de violence armée banalisée et surtout l’on note le meurtre de voisinage opéré par un septuagénaire pour une question d’élagage d’un arbre et qui s’est soldé par deux victimes.
Ces drames s’inscrivent dans une onde de choc plus large qui a vu l’archipel de Guadeloupe et l’île de Martinique enregistré l’année dernière des chiffres jamais vus : en Martinique, près de quarante homicides dont une majorité par arme à feu ont été dénombrés sur l’année passée, tandis que la Guadeloupe et Saint-Martin ont dépassé la barre des cinquante meurtres sur la même période.
Cette flambée de violence n’est plus l’affaire d’un fait isolé mais bien le révélateur d’un malaise profond. Derrière les titres sensationnels, la réalité quotidienne est cruelle : des quartiers entiers vivent sous la menace permanente des bandes et des armes, dont plus de 40 000 exemplaires circuleraient sur le seul territoire guadeloupéen selon des bilans officieux.
Le phénomène dépasse les simples statistiques pour devenir une épreuve collective, frappant des familles entières, perturbant les économies locales et instaurant une atmosphère d’insécurité où planent la peur et surtout aujourd’hui la défiance.
Dans ce contexte d’insécurité croissante, l’expression populaire antillaise « La sauce coûte plus cher que le poisson » prend une acuité tragique. Elle illustre l’absurdité d’une situation où les efforts pour vivre, pour exister, pour être protégé deviennent disproportionnés par rapport au bénéfice réel que ces efforts procurent.
On ne parle plus d’un simple coût de la vie mais d’un impuissance collective à protéger l’essentiel : la vie elle-même, dans des territoires où les institutions semblent malgré tout débordées par l’ampleur des défis.
Cette crise aiguë de violence, bien qu’éclatant aujourd’hui sous les projecteurs, ne surgit pas ex nihilo. Elle s’enracine dans un terreau longuement travaillé par des fractures sociales profondes : chômage structurel, absence de discipline et de repères, inégalités persistantes, manque de perspectives pour la jeunesse, et une économie qui peine à offrir des débouchés durables.
L’injustice ressentie par une partie de la population s’exprime parfois par des actes extrêmes, alimentant un cercle vicieux où chaque homicide ou agression vient renforcer le sentiment que rien ne protège plus vraiment, ni l’institution, ni la communauté.
Pour les observateurs et acteurs locaux, cette crise est aussi symptomatique d’un échec du contrat social. Au-delà de la nécessité d’une réponse sécuritaire, c’est tout un modèle de développement qui est questionné.
Depuis plusieurs mois, les autorités ont multiplié les opérations de lutte contre les trafics de stupéfiants qui alimentent une part significative de la violence : des tonnes de drogue ont ainsi été saisies en mer par les forces françaises, pointant l’ampleur des réseaux criminels qui utilisent l’archipel comme plaque tournante de transit.
Des collaborations internationales et des extraditions de criminels vers la Martinique ont également été mises en œuvre, signe que la réponse ne peut être uniquement locale mais doit s’inscrire dans une stratégie régionale concertée.
Pourtant, malgré ces efforts, le sentiment de défiance envers les institutions reste fort. Dans une société où il devient coutumier de voir des réunions ministérielles, des plans de sécurité ou des annonces politiques qui tardent à se traduire en résultats tangibles, beaucoup estiment que les réponses restent partielles, décalées ou trop centrées sur la prévention au détriment d’une approche holistique de plus forte répression.
Cette défiance n’est pas uniquement dirigée contre l’État central : elle irrigue aussi les relations interpersonnelles, corrodant la confiance entre citoyens, fragilisant les solidarités traditionnelles et alimentant une peur durable qui s’infiltre dans la vie quotidienne.
La violence n’est plus seulement un fait divers ou un phénomène marginal, mais bien un enjeu central de la vie collective antillaise. Elle marque une société en rupture avec ses propres espoirs, ébranlée dans ses certitudes et confrontée à une urgence qui dépasse de loin les seules statistiques policières.
Les Antilles françaises se trouvent à un carrefour : continuer sur cette pente de désaffection et de peur, ou inventer de nouveaux modèles de cohésion sociale et de développement qui rendent à la vie locale non seulement sa sécurité, mais surtout sa dignité. « La sauce coûte plus cher que le poisson » est aujourd’hui l’expression de cette équation sociale devenue explosive — tant dans sa dimension symbolique que dans son impact concret sur la vie des Antillais.
Cette expression populaire, ancrée dans le quotidien antillais, dépasse aujourd’hui le simple registre de la sagesse créole pour devenir une clé de lecture puissante de la crise aiguë que traverse la société antillaise. Elle dit l’absurdité d’un système où l’accessoire écrase l’essentiel, où l’effort demandé pour survivre dépasse la valeur même de ce qui est produit ou obtenu, et où le sentiment d’injustice et surtout d’impuissance finit par miner les fondations du vivre-ensemble. Dans un contexte marqué par une violence qui semble désormais hors de contrôle, cette formule résonne comme un diagnostic social implacable.
La société antillaise est aujourd’hui travaillée par un profond sentiment de défiance. Défiance envers les institutions, perçues comme lointaines, inefficaces ou indifférentes aux réalités locales. Défiance envers les élites politiques et économiques, soupçonnées d’avoir accompagné, voire entretenu, un modèle de consommation à bout de souffle. Défiance enfin entre les citoyens eux-mêmes, dans un climat où la peur s’installe durablement et où la violence devient un langage banal, parfois même un mode d’expression.
L’augmentation des faits criminels, la brutalisation des rapports sociaux et la normalisation de l’agressivité traduisent moins une dérive individuelle qu’un malaise collectif profond.
Dans cette société insulaire historiquement marquée par la solidarité, la famille élargie et les réseaux de proximité, la violence actuelle agit comme un révélateur cruel des fractures accumulées. Chômage structurel, absence d’autorité de l’État, déclassement social, sentiment d’abandon des quartiers populaires sous main mise de bandes armées , perte de repères pour une jeunesse en quête de reconnaissance : autant de facteurs qui alimentent une colère sourde.
La promesse républicaine d’égalité réelle apparaît de plus en plus comme un mirage, tandis que le coût de la vie explose et que les perspectives d’ascension sociale se réduisent. Ici, la « sauce » – charges, contraintes, frustrations, humiliations quotidiennes – devient insupportable, alors que le « poisson », c’est-à-dire l’accès à une vie digne, reste maigre et incertain.
La violence qui s’installe ne peut être comprise uniquement sous l’angle sécuritaire. Certes, l’exigence de protection est légitime et la demande d’ordre public est forte. Mais réduire la crise actuelle à un simple problème de délinquance reviendrait à ignorer les racines profondes du mal. La violence est aussi le symptôme d’un contrat social fragilisé par une absence d’autorité, d’un modèle économique incapable d’intégrer durablement sa population active, et d’un imaginaire collectif en panne de projet commun. Elle traduit l’échec d’une société à offrir des horizons crédibles à une partie de ses enfants.
Le sentiment de défiance s’alimente également de la répétition des discours sans effets concrets. Plans successifs, annonces gouvernementales, promesses de rattrapage économique ou social : trop souvent, ces paroles se heurtent à la réalité du quotidien antillais, faite de précarité persistante et de lente dégradation des conditions de vie.
Cette dissonance nourrit un cynisme dangereux, où plus rien ne semble digne de confiance. Lorsque l’État apparaît tantôt comme un acteur absent, tantôt comme un simple gestionnaire de crises, il laisse un vide symbolique que d’autres logiques, parfois violentes, viennent combler.
Dans ce contexte, la violence devient aussi un moyen de visibilité. Elle permet d’exister dans un espace où beaucoup ont le sentiment de ne pas compter. Elle offre une illusion de puissance à ceux que l’économie, l’école ou les institutions ont laissés au bord du chemin. Mais, cette spirale est autodestructrice : elle fragilise encore davantage le tissu social, accélère l’exode des forces vives, et enferme les territoires antillais dans une image négative qui pénalise leur développement.
« La sauce coûte plus cher que le poisson » prend alors une dimension tragique. Elle exprime le ras-le-bol d’une société où l’effort de vivre devient disproportionné par rapport aux bénéfices espérés, où la tension permanente épuise les individus et les communautés. Tant que cette équation ne sera pas inversée, tant que l’essentiel – emploi, dignité, reconnaissance, sécurité, perspective d’avenir – ne primera pas sur la fête, l’accessoire et les artifices, la défiance continuera de prospérer et la violence de s’enraciner.
L’enjeu est désormais civilisationnel pour les Antilles. Il s’agit de restaurer la confiance, non par des discours incantatoires, mais par des actes tangibles, une refondation du modèle économique, une politique ambitieuse de restauration de l’autorité pour la jeunesse et une reconnaissance sincère des spécificités locales.Si nous n’y prenons garde, la fracture actuelle pourrait bien accoucher d’un régime autoritaire, d’un effondrement civique, d’une violence encore plus systémique.
Il n’est peut être pas trop tard, mais, disons le sans fard, le ver est déjà dans le fruit. Alors il est plus que temps. Aujourd’hui la Guadeloupe et la Martinique méritent mieux qu’un slogan politique utopique. Elles méritent un cap économique. Un cap lucide, ambitieux, partagé. Faute de quoi, la société antillaise risque de s’enfermer durablement dans un cycle de peur et de colère, où la sauce, toujours plus lourde, finira par étouffer définitivement le poisson.
« Sós-la kouté pli chè ki pwason-la ».
Littéralement : « La sauce coûte plus cher que le poisson ».
*Economiste et juriste en droit public