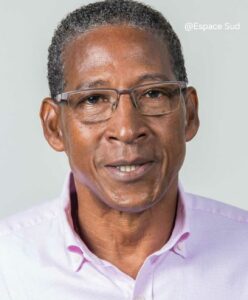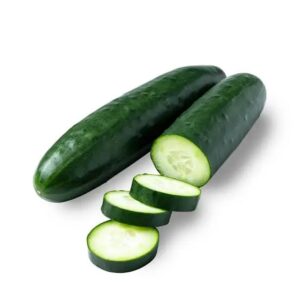PAR JEAN-MARIE NOL*
L’annonce du projet de loi de finances 2026 a résonné comme un coup de tonnerre dans les Outre-mer. Pour la première fois depuis six ans, le budget du ministère qui leur est consacré sera amputé de manière significative.
Ce recul symbolise un virage politique clair : celui d’une rigueur assumée, qui privilégie l’orthodoxie budgétaire à la cohésion économique et sociale. Derrière les chiffres, c’est une vision du lien entre la France et ses territoires d’Outre-mer qui s’effrite, laissant craindre un basculement silencieux vers le désengagement de la France au profit d’un futur rattachement direct à l’Europe.
En cherchant à réduire un déficit public devenu abyssal, le gouvernement entend économiser 30 milliards d’euros d’ici 2026, en conjuguant hausses de recettes et coupes dans les dépenses. Les Outre-mer figurent parmi les premières victimes de cette cure d’austérité : 160 millions d’euros en moins par rapport à 2025, soit une baisse de près de 6 % des crédits.
Le bât blesse d’autant plus que, en plus de la baisse des dépenses, le gouvernement propose de faire 750 millions d’euros d’économies sur le dispositif d’aides aux entreprises ultramarines en coupant notamment dans les exonérations prévues par la loi LODEOM, et en remaniant les dispositifs de défiscalisation de l’investissement productif.
Ce dernier point est l’objet de l’article 7 du budget. Il prévoit de limiter les défiscalisations aux investissements verts dans les territoires ultramarins, ce qui aura un impact direct sur l’industrie touristique (hébergement, croisières…). Un secteur clé pour les économies ultramarines.
« Dans les faits, cette réforme réduit drastiquement l’attractivité des territoires d’Outre-mer. Ces coupes budgétaires cumulées menaceraient directement l’emploi et la vitalité économique du territoire. »
« On mesure déjà les premiers impacts : gel des salaires, hausse du coût du travail, licenciements économiques, baisse de l’activité et de la productivité, perte d’attractivité, voire dépôts de bilan », alertent de concert Catherine Rodap, présidente du MEDEF Martinique, et Patrick Vial Collet président de la CCI Guadeloupe et président de l’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Outre-mer (ACCIOM), regroupant les 11 CCI ultramarines.
Ce renversement de tendance met fin à une progression budgétaire qui avait pourtant permis, depuis 2020, de compenser partiellement les handicaps structurels de ces territoires – insularité, coûts logistiques, étroitesse des marchés, dépendance énergétique et vulnérabilité sociale.
L’heure n’est plus à la réparation des handicaps structurels, mais à la restriction, au moment précis où les signaux économiques virent au rouge.
Les effets de cette rigueur budgétaire se feront sentir avec d’autant plus de violence qu’ils viennent s’ajouter à d’autres bouleversements systémiques. Le marché de l’emploi mondial traverse une mutation accélérée par l’intelligence artificielle, dont les premiers impacts se font déjà sentir sur les jeunes diplômés. Les grandes entreprises qui intègrent massivement l’IA réduisent leurs embauches d’entrants, notamment dans les métiers de la communication, dû marketing, de la gestion ou de la finance.
Selon les études de Stanford et de Harvard, l’emploi des 22-25 ans dans ces secteurs a chuté de 6 % depuis 2022, pendant que celui des profils expérimentés progressait. En France, les grandes écoles constatent une dégradation inédite de l’insertion professionnelle de leurs diplômés.
L’intelligence artificielle, censée libérer l’humain du travail répétitif, commence par exclure ceux des jeunes diplômés qui entrent sur le marché. Pour des territoires ultramarins où la jeunesse constitue la majorité de la population active, cette tendance mondiale du recours à l’intelligence artificielle pourrait devenir une bombe sociale pour la Guadeloupe et la Martinique .
Or, au moment où les économies insulaires auraient besoin de soutien pour accompagner ces transformations liées à la révolution technologique, la politique budgétaire nationale se resserre. Les dispositifs de soutien au développement ultramarin sont dans la ligne de mire.
La LODEOM, pierre angulaire des exonérations de cotisations patronales, est jugée « trop coûteuse ». Le gouvernement parle de « rationalisation », mais les acteurs économiques y voient une remise en cause de leur survie. Catherine Rodap, présidente du MEDEF Martinique, dénonce une « très mauvaise nouvelle » pour l’emploi et la compétitivité : un commerçant de quartier avec quatre salariés au SMIC verrait ses charges sociales bondir de 25 000 euros par an ; un artisan du bâtiment, de 12 000 euros.
Ces chiffres, loin d’être anecdotiques, traduisent un basculement concret du coût du travail vers des structures fragiles, déjà confrontées à la vie chère, aux retards de paiement publics et aux surcoûts d’importation.
Les dispositifs de défiscalisation, eux aussi, sont redéfinis : désormais, seules les dépenses liées à la transition écologique seront éligibles. Si l’objectif paraît vertueux, il néglige la réalité économique des îles : en excluant le tourisme, l’hôtellerie et la restauration, piliers de leurs économies, cette réforme risque de tarir les flux d’investissement productif. Le virage vert, imposé sans accompagnement, pourrait se transformer en casse économique.
Les données confirment cette inquiétude.
Selon le dernier rapport d’Allianz Trade, les défaillances d’entreprises dans les départements d’outre-mer ont augmenté de 10 % sur un an. En Guyane, la hausse atteint des niveaux vertigineux (+135 % au troisième trimestre après +440 % précédemment).
La Guadeloupe n’est pas épargnée (+27 %), et même si la Martinique et La Réunion connaissent une légère accalmie, la tendance globale reste alarmante. Les secteurs les plus touchés – services, construction, commerce, hébergement et restauration – représentent à eux seuls près de 80 % des faillites.
Autrement dit, ce sont les métiers de la vie quotidienne, ceux qui assurent la cohésion sociale et la vitalité des territoires, qui s’effondrent les premiers.
Cette contraction budgétaire et ce ralentissement économique s’inscrivent dans un contexte national déjà dégradé. L’instabilité politique française alimente l’incertitude et fragilise la confiance des marchés. Le pays emprunte désormais à des taux proches de 3,4 %, presque équivalents à ceux de l’Italie, avec une charge de la dette estimée aujourd’hui à 55 milliards d’euros par an et prévue à 100 milliards d’euros en fin 2030.
Ce poids croissant limite la marge de manœuvre budgétaire et pousse le gouvernement à serrer la vis partout, y compris là où la marge d’ajustement n’existe plus. La rigueur, en apparence vertueuse, devient contre-productive lorsqu’elle détruit les moteurs mêmes de la croissance.
Le « choc d’incertitude » évoqué par l’OFCE touche de plein fouet les Outre-mer, où la fragilité économique se conjugue à une défiance politique croissante. Les élus locaux dénoncent une surdité institutionnelle, une absence de concertation, et une gestion uniforme des territoires les plus inégaux de la République : « On ne peut pas demander à des territoires extrêmement vulnérables de faire autant d’efforts. »
Les acteurs économiques, eux, plaident pour une approche différenciée : maintenir la LODEOM, créer un « bonus vert outre-mer », soutenir les investissements locaux et replacer l’emploi au cœur des priorités.
Car, derrière ces débats techniques se joue une question de survie économique .
L’austérité, si elle se transforme en indifférence, peut devenir une faute politique majeure. Car le krach de l’économie qui vient n’est pas une abstraction : il menace directement les emplois, les entreprises et la stabilité sociale des Outre-mer. À l’heure où la République invoque la réindustrialisation et la transition écologique, elle semble oublier ceux qui, à des milliers de kilomètres, en paient déjà le prix.
Si la rigueur budgétaire est une nécessité, elle ne saurait justifier le sacrifice silencieux de la France océanique. L’histoire retiendra moins les économies réalisées que les fractures qu’elles auront creusées. Or, que restera-t-il des bénéfices espérés d’une autonomie voulue par les élus locaux avec un pouvoir normatif d’une souveraineté locale, lorsqu’on affaiblit les territoires qui incarnent la dimension mondiale de la France ?
La « France océanique », éparpillée sur quatre continents, n’est pas un luxe budgétaire : elle est une composante stratégique, économique et géopolitique de la Nation. En réduisant les leviers d’investissement et d’emploi dans ces territoires, l’État prend le risque d’aggraver la dépendance financière et la désespérance sociale.
À quelques mois du vote final du budget, une question cruciale plane : la République est-elle prête à assumer les conséquences politiques et humaines d’un tel désengagement ? Car, au-delà des milliards d’euros économisés sur le papier, ce sont des milliers d’emplois, des centaines d’entreprises, et tout un tissu social qui risquent d’être sacrifiés sur l’autel de la crise.
L’austérité appliquée aux Outre-mer n’est pas une simple ligne de compte : c’est une fracture qui s’approfondit entre l’Hexagone et ses périphéries, entre le discours d’unité nationale et la réalité d’un abandon progressif.
La rigueur a peut-être ses vertus ; mais lorsqu’elle devient indifférence, elle se transforme en faute politique.
L’histoire jugera sévèrement ceux qui, au nom des équilibres comptables, auront laissé la France océanique sombrer dans la crise.
*Economiste et juriste en droit public