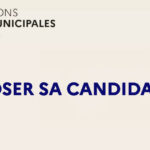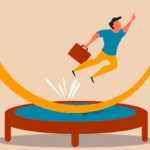PAR JEAN-MARIE NOL*
La Guadeloupe est désormais à l’épreuve du nouveau paradigme de l’économie et de la mutation du travail : entre dépendance, mutation sociétale et survie économique, et elle vit aujourd’hui un moment charnière de son histoire économique et sociale.
Le modèle qui, depuis des décennies, a assuré sa stabilité repose sur un équilibre fragile : celui d’une économie de transferts et de consommation, adossée à la solidarité nationale. L’État français, par ses subventions, ses exonérations et ses sur-rémunérations, en demeure le principal pilier.
Sans ce soutien constant, l’économie locale s’effondrerait comme un château de cartes. Mais ce modèle, à force d’avoir protégé, a fini par enfermer. L’assistanat, devenu système, s’est transformé en l’un des facteurs majeurs de la dévalorisation du travail. À force de compenser, on a fini par désapprendre à produire ; à force d’aider, on a cessé de valoriser l’effort.
Car le travail, en Guadeloupe, n’est plus perçu comme un moteur de dignité, mais souvent comme un fardeau dont la récompense semble dérisoire face aux mécanismes d’assistance. Ce décalage entre effort et rétribution a contribué à une crise silencieuse du sens du travail, et à une perte de confiance envers l’économie réelle. Loin de corriger les inégalités, l’assistanat chronique les fige. Il entretient un équilibre artificiel qui, en garantissant la survie, empêche l’élan. La Guadeloupe, en apparence protégée, se retrouve ainsi prisonnière d’un modèle d’immobilisme économique qui mine sa vitalité collective.
La Guadeloupe demeure, plus que tout autre territoire français, une économie fortement administrée. Près de 38 % des emplois salariés relèvent de la fonction publique — contre 23 % en moyenne hexagonale —, et la masse salariale publique représente entre 40 et 45 % du revenu total du travail distribué sur le territoire. À cela s’ajoutent les transferts sociaux, les retraites et les subventions diverses, si bien que plus de la moitié du revenu des ménages dépend directement de la dépense publique, donc de l’État français. Ce modèle, qui a longtemps assuré la stabilité du pouvoir d’achat et amorti les crises, agit aujourd’hui comme une double contrainte : il garantit la paix sociale tout en inhibant la croissance endogène.
La consommation locale repose essentiellement sur les salaires publics et les prestations sociales, tandis que le secteur privé, limité à des activités de faible valeur ajoutée — commerce, hôtellerie, services —, peine à se diversifier et à créer des richesses nouvelles. La Guadeloupe vit ainsi sous perfusion budgétaire, dans une économie d’équilibre plus que de développement. Le défi des années 2025–2035 sera de transformer cette dépendance en levier : faire de la dépense publique un moteur d’investissement productif, favoriser l’entrepreneuriat, et réorienter la solidarité nationale vers la création de valeur plutôt que vers la simple redistribution.
Dans ce contexte, la révolution technologique mondiale en cours — celle de l’intelligence artificielle — ne peut qu’aggraver les déséquilibres existants. Pendant des siècles, étudier était le meilleur investissement possible. Ce monde-là est désormais révolu. L’intelligence, autrefois rare et valorisée, devient gratuite et accessible à tous. Les plateformes d’IA générative, comme ChatGPT ou Gemini, bouleversent la relation au savoir, remettent en cause la hiérarchie des compétences et annoncent la fin du monopole de la connaissance humaine sur la production intellectuelle. Comme le soulignent Laurent Alexandre et Olivier Babeau dans leur récent livre
« Ne faites plus d’études ! », l’éducation telle qu’on la connaît est condamnée à se transformer radicalement. Dans un univers où les machines raisonnent plus vite que les hommes, le diplôme n’est plus une promesse, mais une formalité. La Guadeloupe, qui peine déjà à adapter son système éducatif aux besoins du marché, risque de subir de plein fouet cette nouvelle fracture numérique et cognitive.
Le travail de demain sera un travail d’adaptation permanente, d’apprentissage continu, de créativité et de résilience. Mais, cette mutation, si elle n’est pas anticipée, risque d’engendrer une véritable crise sociale. Car la disparition progressive des repères liés à la valeur du travail entraîne un vide symbolique et moral. Quand le travail ne fonde plus la reconnaissance, quand la réussite n’est plus liée à l’effort, c’est tout le contrat social qui se fissure. Les conséquences prévisibles sont multiples : perte de sens, frustration collective, montée des inégalités, repli identitaire.
Et dans une société déjà fragilisée par le chômage de masse et la dépendance structurelle à la dépense publique, ce vide pourrait se transformer en violence. Violence symbolique d’abord, dans la dévalorisation de l’effort et la défiance envers les institutions ; violence réelle ensuite, dans les comportements, les rapports sociaux et la montée d’une colère latente. Car une société qui ne reconnaît plus l’effort finit toujours par engendrer la révolte.
Or, cette mutation du travail ne se fera pas sans les entreprises, qui demeurent les véritables créatrices de valeur. L’économie guadeloupéenne, d’après les dernières données de l’INSEE, a généré 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 3,7 milliards d’euros de valeur ajoutée en 2023. Le commerce, principal moteur, représente à lui seul 46 % de l’activité marchande. Mais, derrière ces chiffres se cache une réalité préoccupante : les deux tiers de la valeur ajoutée sont absorbés par les charges de personnel, et les marges réelles demeurent faibles.
L’autofinancement est quasi inexistant. Sans les aides publiques et les exonérations de charges issues de la loi LODEOM, sans les crédits bancaires alimentés par une épargne locale de près de cinq milliards d’euros, le système s’écroulerait. La Guadeloupe repose sur trois piliers fragiles : la dépense publique, la consommation des ménages et le financement bancaire. Si l’un d’eux vacille, tout le reste s’effondre.
Le danger est clair : si le désengagement progressif de l’État, déjà amorcé à travers la réduction des exonérations sociales et des dotations publiques, se poursuit sans accompagnement, la Guadeloupe sera confrontée à une spirale récessive inédite. La contraction du crédit, la baisse du pouvoir d’achat et la précarisation des petites entreprises conduiraient à une paupérisation généralisée. Et dans un territoire insulaire où le coût de la vie reste supérieur de près de 30 % à celui de l’Hexagone, chaque réduction de transfert se traduit par un choc social majeur.
L’avenir économique de la Guadeloupe passe donc par une redéfinition de son rapport à l’État, non par une rupture. L’autonomie ne doit pas être un slogan identitaire mais un projet économique construit. Le maintien dans le cadre protecteur de l’article 73, assorti d’un pouvoir normatif renforcé, apparaît comme la seule voie réaliste : elle permettrait d’adapter les politiques publiques aux réalités locales tout en préservant le lien financier vital avec la République.
Le véritable enjeu n’est pas de couper le cordon, mais de mieux utiliser la solidarité nationale pour amorcer une diversification économique durable, orientée vers la production, la transition énergétique, la formation et l’innovation.
La Guadeloupe n’a pas besoin d’un changement de statut politique, mais d’un changement de stratégie économique. Elle n’a pas besoin d’un discours de souveraineté, mais d’un projet de prospérité. Dans ce monde où l’intelligence artificielle redéfinit la valeur du travail, le développement guadeloupéen doit reposer sur une économie du savoir, de l’innovation et de la compétence humaine. Le travail reste la première des richesses.
S’il est réhabilité, il peut redevenir le socle d’une société stable, digne et prospère. S’il continue d’être dévalorisé, la Guadeloupe risque de sombrer dans la dépendance, la colère et la résignation.
Car au fond, le danger n’est pas la pauvreté déjà existante mais l’accélération de la paupérisation.
Le vrai danger, c’est l’oubli du travail. Et avec lui, l’oubli de la liberté.
*Economiste et juriste en droit public.