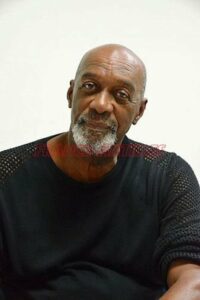PAR JEAN-MARIE NOL*
La France semble engagée sur une pente glissante, où s’entremêlent lassitude démocratique, défiance politique et quête d’autorité. L’enquête Ipsos « Fractures françaises 2025 » en dresse un constat implacable : jamais les Français n’ont été aussi pessimistes quant à l’avenir de leur pays.
Près de 90 % estiment que la France est en déclin, un record historique qui traduit un profond désenchantement vis-à-vis du système politique. Dans ce paysage morcelé, le Rassemblement national apparaît comme le grand bénéficiaire de cette crise de confiance. Son image s’est normalisée : 47 % des citoyens le jugent désormais capable de gouverner, et sa base électorale s’est considérablement élargie tandis que les partis traditionnels — de Renaissance à la gauche — s’effondrent.
Cette recomposition traduit une droitisation du paysage politique et une inquiétante banalisation des thèses identitaires. La France, secouée par les crises économiques, sociales et institutionnelles, glisse vers une polarisation accrue où le débat public s’empoisonne de peurs et de rancunes. Le président Macron, usé par les crises et discrédité par une majorité de Français, n’incarne plus ni autorité ni vision.
Ce vide politique nourrit la tentation d’un pouvoir fort, perçu comme seul rempart contre le désordre. Dans une société fragmentée par la précarité, la défiance et le sentiment de déclassement, Marine Le Pen et Jordan Bardella se positionnent comme les héritiers d’une France « fatiguée », en quête d’ordre plus que de progrès.
Dans ce contexte de défiance généralisée, seule une institution et un parti se distinguent par leur niveau de confiance : la commune et le Rassemblement national.
Mais ce basculement potentiel, loin d’être anodin, interroge la solidité du pacte républicain. Derrière le ressentiment, c’est l’édifice même de la démocratie française qui vacille. Le risque d’une mutation autoritaire n’est plus une hypothèse marginale : il s’enracine dans un contexte de crise sociale, identitaire et civilisationnelle. À mesure que les tensions s’exacerbent, le pays semble s’enfermer dans un cercle vicieux de peur et de division.
La République, autrefois garante d’un idéal d’égalité et de cohésion, se trouve aujourd’hui menacée par la tentation du repli et de la colère. Le réveil s’annonce brutal pour les Antilles -Guyane, car c’est désormais la France elle-même qui semble douter de sa propre promesse d’éclaircir le futur institutionnel. Et si on prenait un peu de hauteur pour imaginer la Guadeloupe de demain ? Entre transitions écologique et numérique, bouleversements économiques et attentes sociales, le pays se trouve à un carrefour.
Un défi futur fait référence aux obstacles ou problèmes potentiels qui peuvent survenir et affecter la gouvernance locale et l’élaboration des politiques à l’avenir. Alors, Imaginer la Guadeloupe de demain, c’est accepter de regarder en face un avenir où les incertitudes se mêlent aux promesses, où les défis s’annoncent d’une ampleur inédite, mais où demeure aussi la possibilité d’une transformation profonde.
Les Guadeloupéens, peuple résilient par essence, devront bientôt composer avec un environnement mondial et national en mutation rapide et plein de menaces. Entre crises climatiques, crise de la dette, pressions économiques, fractures sociales et révolutions technologiques, tout indique que l’archipel entre dans une ère où la lucidité et la responsabilité collective seront plus que jamais indispensables.
Le premier défi, et sans doute le plus vital, sera celui du changement climatique. L’île se trouve déjà en première ligne des bouleversements environnementaux : montée du niveau de la mer, intensification des cyclones, sécheresses plus longues et perturbations des écosystèmes marins. Ces transformations naturelles menacent non seulement les zones côtières et les infrastructures, mais aussi les ressources agricoles et touristiques, deux piliers essentiels de l’économie locale.
Plus qu’un enjeu écologique, il s’agit d’un impératif de survie : repenser la gestion du territoire, protéger les zones sensibles, régler la question épineuse des Sargasses, adapter les cultures et promouvoir des politiques énergétiques sobres et durables. Dans ce combat, la Guadeloupe devra inventer un modèle insulaire de résilience climatique qui puisse concilier préservation et développement. Mais la question de l’eau potable, déjà criante aujourd’hui, pourrait devenir demain un véritable cauchemar collectif.
Les coupures récurrentes, les réseaux vétustes et les pertes colossales dans les canalisations traduisent une crise de gouvernance et d’investissement. À l’avenir, la raréfaction de la ressource et la dégradation des infrastructures rendront cette question encore plus stratégique. L’eau, bien commun et enjeu vital, sera au cœur de la stabilité sociale et de la confiance dans les institutions locales. La maîtrise de cette ressource conditionnera l’avenir de la santé publique, de l’agriculture et même du tourisme.
À ces préoccupations environnementales s’ajoute celle de la sécurité alimentaire. L’archipel dépend aujourd’hui à plus de 80 % des importations pour nourrir sa population. Dans un contexte mondial de tensions géopolitiques, de hausse des prix et de rupture des chaînes logistiques, cette dépendance devient un risque majeur. Repenser la souveraineté alimentaire, soutenir les producteurs locaux, réhabiliter les circuits courts, orienter le développement vers l’industrie agroalimentaire et valoriser l’agroécologie apparaissent désormais comme des priorités absolues.
Le défi est autant économique que culturel : il s’agit de redonner sens à la terre et de recréer une fierté nourricière, dans un territoire où la mémoire de la canne et du rhum ne doit pas masquer l’urgence d’une agriculture vivrière durable et d’une économie basée sur la transformation des produits importés de l’étranger vers la production de produits finis à haute valeur ajoutée.
L’éducation, elle aussi, sera un pilier de la transformation à venir. Dans un monde où la connaissance devient la première ressource, l’école guadeloupéenne devra relever le défi de l’excellence et de l’adaptation. Il faudra préparer les jeunes à des métiers nouveaux, souvent encore inexistants, tout en renforçant les savoirs fondamentaux et la capacité critique. L’éducation ne pourra plus se contenter de reproduire des modèles venus d’ailleurs : elle devra être un levier d’émancipation, ancrée dans la réalité locale tout en ouvrant les esprits sur le monde.
Face à la montée du décrochage scolaire, à la violence endémique, à la fuite des talents et au désenchantement d’une jeunesse souvent en quête de sens, l’enjeu sera de redonner confiance dans l’avenir collectif. La santé représente un autre front d’inquiétude. Le vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques et les tensions hospitalières appellent une refondation du système de soins.
L’hôpital public, déjà sous pression, devra affronter la double contrainte d’un personnel médical vieillissant et d’un budget restreint. Dans le même temps, l’innovation médicale et la télémédecine offriront des opportunités nouvelles, à condition que la fracture numérique ne laisse pas une partie de la population à l’écart. La santé de demain en Guadeloupe devra être à la fois préventive, communautaire et connectée, mais surtout équitable.
La cybersécurité, souvent perçue comme un enjeu lointain, s’imposera bientôt comme une question de souveraineté insulaire. Les administrations, les hôpitaux, les entreprises et même les collectivités locales sont de plus en plus exposés aux cyberattaques. Dans une société où la donnée devient le cœur de la gouvernance, protéger les systèmes d’information est une condition de confiance démocratique et de stabilité économique. Cette vulnérabilité s’ajoute à une autre menace, plus tangible : la montée de la violence.
Les tensions sociales, le trafic de stupéfiants, le désœuvrement des jeunes et le sentiment d’abandon contribuent à installer une inquiétude diffuse dans le quotidien des habitants. Lutter contre cette violence nécessitera bien plus que des moyens policiers : il faudra réinvestir le champ de l’éducation, de la culture, de la justice , du lien social et surtout réhabiliter l’autorité de l’État
Le tourisme, pilier historique de l’économie guadeloupéenne, devra lui aussi se réinventer pour ne plus dépendre uniquement du soleil et des plages. Dans un monde en quête de sens, d’authenticité et de ressourcement, l’avenir du secteur réside dans une diversification intelligente vers le tourisme de bien-être et de santé.
La Guadeloupe possède tous les atouts pour devenir une destination de référence dans ce domaine : un climat tropical apaisant, des eaux marines aux vertus reconnues, une biodiversité exceptionnelle et un art de vivre empreint de douceur et de lenteur. La thalassothérapie, la balnéothérapie ou encore les cures thermales et holistiques pourraient constituer de puissants leviers de croissance, à condition d’y adosser des infrastructures modernes, respectueuses de l’environnement et connectées aux réseaux médicaux et hôteliers.
Cette orientation permettrait non seulement d’attirer une clientèle internationale à fort pouvoir d’achat, mais aussi de prolonger la saison touristique et de créer des emplois qualifiés dans des domaines aussi variés que la santé, l’hospitalité, le sport ou les soins du corps. Le tourisme de bien-être, bien plus qu’un simple segment de marché, incarne la possibilité d’un développement harmonieux entre économie, écologie et qualité de vie. Mais la reconquête économique de la Guadeloupe ne saurait se limiter à ses plages et à ses spas.
La culture, elle aussi, doit devenir un moteur de croissance et de rayonnement. L’île, riche d’une histoire complexe et souvent douloureuse, mérite de se doter d’un grand musée de l’histoire de la Guadeloupe, à la hauteur de sa mémoire et de sa contribution à l’histoire du monde. Ce lieu, à la fois éducatif, patrimonial et touristique, pourrait devenir un symbole fort d’identité et de transmission, tout en attirant un public local, scolaire et international. Il participerait à la reconnaissance d’un récit collectif longtemps fragmenté, et à la valorisation des héritages africains, amérindiens, européens et indiens qui tissent l’âme du pays.
Dans la même logique, la création de parcs de loisirs tropicaux — mêlant nature, aventure, découverte et culture — représenterait un formidable levier d’emploi et de diversification. Ces équipements offriraient des expériences touristiques immersives fondées sur la richesse du patrimoine naturel et culturel local : jardins botaniques, parcours écotouristiques, espaces ludiques autour de la faune et de la flore, villages artisanaux, ou encore festivals permanents autour de la musique et de la gastronomie créoles.
Ces projets permettraient de stimuler l’investissement privé, de dynamiser l’économie locale et de fidéliser une clientèle régionale et internationale.
Enfin, l’intelligence artificielle constituera sans doute l’un des défis les plus déterminants, à la fois menace et opportunité. Elle transformera la manière de travailler, d’apprendre, de soigner et de produire. Pour la Guadeloupe, territoire encore dépendant de la fonction publique et du tourisme, cette révolution numérique peut devenir un très grand risque mais aussi un levier de développement si elle est anticipée intelligemment : création de filières locales, formation des jeunes aux métiers du numérique, valorisation des données territoriales et soutien à l’innovation.
Mais, sans une stratégie claire, elle pourrait accentuer les fractures sociales, creuser le fossé entre ceux qui maîtrisent les outils et ceux qui en sont exclus.
Le contexte national n’est pas plus rassurant en terme de défis pour la Guadeloupe. La France, frappée par la « maladie du double déficit », voit se réduire sa capacité d’action publique. Le déficit extérieur appauvrit le pays, tandis que le déficit public, alimenté par une dépense sociale hypertrophiée, limite les marges de manœuvre des collectivités locales dans un contexte subi de coupes budgétaires.
Dans ce climat de rigueur budgétaire, les départements d’outre-mer, déjà fragiles, risquent d’être les premières victimes de la disette financière. Les élus guadeloupéens devront alors faire preuve d’une inventivité politique rare, en repensant leurs priorités en terme de politique publique, en mutualisant leurs ressources pour faire face à la baisse prévisible des recettes fiscales et en imaginant de nouveaux partenariats européens et caribéens.
Ainsi, le futur de la Guadeloupe ne se jouera pas uniquement dans les couloirs du pouvoir Parisien, mais dans la capacité collective à anticiper, à innover et à coopérer.
Chaque défi, qu’il soit climatique, technologique ou social, porte en lui une opportunité de renouveau. La question n’est plus de savoir si l’île pourra éviter les épreuves à venir de la crise économique et financière à venir, mais si elle saura les transformer en moteur de sa propre résilience.
Car dans ce moment d’incertitude, la Guadeloupe a peut-être entre les mains la possibilité la plus précieuse de toutes : celle de se réinventer avec une vision prospective pour redevenir un modèle d’équilibre entre économie, atouts naturels, culture et modernité.
*Economiste et juriste en droit public