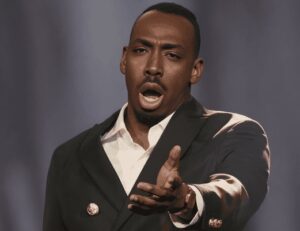PAR JEAN-MARIE NOL*
L’histoire d’Haïti qui est une nation sans État du fait même de l’histoire, illustre avec une intensité dramatique combien l’économie, dans ses logiques implacables, domine et conditionne les trajectoires politiques et les idéologies affichées.
La révolution haïtienne fut un événement historique majeur, une rupture politique sans précédent dans un monde dominé par les puissances esclavagistes. Mais, à peine la République proclamée en 1804, la réalité économique s’est imposée comme un couperet. Loin d’ouvrir un avenir radieux, l’indépendance a très vite révélé son prix : la France n’a reconnu la souveraineté haïtienne qu’en échange d’une rançon colossale en 1825, un fardeau financier dont le poids écrasant s’est transmis de génération en génération.
L’idéologie de la liberté et de l’égalité s’est heurtée à la brutalité des chiffres, et la victoire politique des anciens esclaves a été brisée d’une part par les massacres des colons détenteurs du capital voire aussi par la destruction des plantations et d’autre part du fait des mécanismes économiques de leur ancienne métropole coloniale qui a repris la main sur l’économie du pays nouvellement indépendant. C’est très exactement ce scénario catastrophe que le grand président Nelson Mandela dit madiba a déjoué avec sagesse en Afrique du Sud à l’occasion de la fin de l’apartheid.
Mais, pour ce qui concerne Haïti, ce mécanisme de domination économique et financière ne s’est pas arrêté là. À travers la Banque nationale d’Haïti, créée et contrôlée depuis Paris par le Crédit industriel et commercial, l’économie haïtienne a été littéralement asphyxiée. Loin d’être un outil d’émancipation, cette banque drainait vers la France les ressources fiscales issues du café et du sucre, privant Haïti de tout investissement durable dans les infrastructures essentielles.
Tandis que le CIC participait au financement de la tour Eiffel, symbole flamboyant de la puissance française, il vidait les caisses d’un pays exsangue. L’économie n’était plus un simple cadre neutre ; elle devenait un instrument de domination, imposant sa loi au politique et condamnant la jeune République noire à l’impuissance et au sous-développement.
Ce fardeau historique, qui a coûté entre 21 et 115 milliards de dollars selon certaines estimations, explique largement qu’Haïti figure aujourd’hui parmi les nations les plus pauvres, avec un taux de chômage vertigineux et une population majoritairement sous le seuil de très grande pauvreté, soumise en prime à un chaos sécuritaire dominé par des gangs qui sèment la terreur.
Cette tragédie dépasse le seul cadre haïtien. Elle montre que les grandes idées politiques, même lorsqu’elles prétendent rompre radicalement avec l’ordre établi, se heurtent inévitablement à des réalités économiques plus fortes qu’elles. L’exemple d’Haïti résonne douloureusement avec des situations plus proches de nous.
En Nouvelle-Calédonie ou en Martinique, les récentes violences qui ont ciblé en priorité les entreprises révèlent un malaise profond, fruit d’inégalités économiques persistantes et d’un sentiment d’abandon. Or, aussitôt après les destructions, les élus locaux réclament des milliards à l’État français pour reconstruire ce qui a été perdu.
Le paradoxe est cruel : les discours sur l’autonomie et l’affirmation politique ne suppriment jamais la dépendance structurelle aux flux économiques. Dans un contexte où les finances publiques françaises sont dégradées, ces demandes notamment de compensation dans l’accompagnement des nouvelles compétences se heurtent à une réalité comptable qui prime sur les proclamations politiques.
Ce lien de subordination entre l’économie et le politique n’est pas seulement conjoncturel ; il est inscrit dans une temporalité différente. Là où la politique veut des réponses rapides et des symboles forts, l’économie impose des délais, des équilibres, des investissements de long terme.
En Martinique et en Guadeloupe, les débats sur un éventuel changement de statut institutionnel s’enflamment sur fond de mal-être identitaire et de frustration économique, mais ces débats négligent souvent d’évaluer sérieusement le coût financier qu’impliquerait une autonomie accrue sans véritable assise économique.
L’histoire d’Haïti avertit pourtant qu’un saut politique sans assise économique solide peut se transformer en désastre durable. Il ne s’agit pas de nier les aspirations politiques, mais de rappeler que la liberté proclamée sans moyens économiques pour la soutenir risque de n’être qu’un mirage.
Cette prédominance des faits économiques se retrouve aujourd’hui à l’échelle mondiale. Les crises financières, l’inflation, les tensions géopolitiques et climatiques ramènent partout les gouvernements à la dure réalité des budgets, des dettes et des rapports de force. La loi du plus fort, économique avant d’être militaire, continue de dicter l’ordre international. Les erreurs de discernement, comme celles de Toussaint Louverture ou de Dessalines face aux rapports de force, se paient aujourd’hui au prix fort. Là encore, la politique croit parfois maîtriser le temps, mais c’est l’économie qui, par ses cycles et ses contraintes, impose ses rythmes et ses limites.
L’histoire d’Haïti nous enseigne donc que l’idéologie, si noble soit-elle, ne peut à elle seule transformer une société si elle ignore les impératifs économiques. L’économie n’est pas un simple arrière-plan, elle est l’ossature qui conditionne les ambitions politiques et sociales. C’est à cette réalité qu’il faut se confronter lucidement si l’on veut éviter que les mêmes erreurs ne se reproduisent.
Faute d’une telle lucidité, les nations, qu’elles soient insulaires ou continentales, risquent de se retrouver prisonnières de rapports de force économiques qu’elles n’ont pas anticipés, et de voir leurs rêves de liberté se dissoudre dans la spirale des crises et des dettes.
L’adage créole le rappelle avec sagesse : _« Bèf fon pa konèt malè bèf món ».
Chacun porte son fardeau, mais nul ne peut ignorer celui des autres ni se soustraire aux réalités matérielles qui structurent toute existence collective.
*Economiste