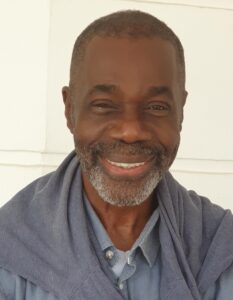PAR JEAN-MARIE NOL*
Le débat sur l’antillanisation des cadres, qui refait surface à intervalles réguliers dans les discussions publiques, ressemble à s’y méprendre à ce que l’on qualifie dans le langage courant de « serpent de mer ».
C’est-à-dire un sujet qui revient sans cesse, qui alimente les polémiques et les indignations, mais dont l’aboutissement reste perpétuellement renvoyé aux calendes grecques. La dernière visite du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, en Martinique a ravivé la flamme : les caméras de télévision ont montré un parterre de hauts fonctionnaires exclusivement métropolitains lors d’une réunion sur la sécurité, et l’opinion publique, des deux rives de la Caraïbe française, s’est aussitôt enflammée de propos tenus sous le boisseau.
Beaucoup ont vu dans ces images une confirmation de ce sentiment de dépossession, comme si les élites locales étaient systématiquement écartées du sérail décisionnel et administratif. Mais, derrière la traditionnelle émotion de type identitaire qui se dégage dans ce genre de problématique, se cache une question plus complexe, qui mérite une analyse dépassionnée : l’antillanisation des cadres est-elle une vieille lune, une idée périmée qui n’a jamais trouvé de réelle application, ou relève-t-elle de la quadrature du cercle, autrement dit d’un problème insoluble dans le cadre institutionnel actuel ?
D’abord, il convient de rappeler que la République française fonctionne selon un principe de mobilité et de rotation des hauts fonctionnaires. Les préfets, procureurs, recteurs et autres directeurs d’administrations ne sont pas enracinés à vie dans un territoire mais mutés tous les quatre ou cinq ans, suivant une logique de carrière nationale. Qu’un ministre en déplacement à Clermont-Ferrand, à Angers ou en Vendée soit entouré de préfets et de directeurs locaux originaires précisément de ces régions est une chimère : cela n’arrive quasiment jamais.
En ce sens, exiger que l’Outre-mer déroge à cette règle reviendrait à réclamer un traitement d’exception, contraire au principe même d’égalité républicaine auquel, paradoxalement, la majorité des Antillais demeure attachée en refusant pour l’heure l’indépendance. C’est là une première contradiction qu’il faut mettre en lumière : vouloir rester pleinement Français, tout en exigeant un mode de fonctionnement administratif qui n’existe nulle part ailleurs sur le territoire national.
Mais, si la règle nationale est claire, la sensibilité locale l’est tout autant. Les Antilles françaises ont une histoire singulière, marquée par la colonisation, l’esclavage et une départementalisation qui, si elle a apporté des droits et des protections sociales indéniables, a aussi alimenté le sentiment que les leviers de commandement restaient concentrés dans des mains extérieures.
Le débat sur l’antillanisation des cadres traduit donc une revendication de reconnaissance, un désir de voir refléter dans les sphères de décision la diversité et l’identité des populations locales. D’où la frustration de voir des postes stratégiques occupés massivement par des métropolitains, quand bien même ce serait le résultat d’un système de concours national ouvert à tous.
La question est donc double : d’un côté, il y a la mécanique républicaine qui impose ses règles uniformes, de l’autre, une réalité sociopolitique où les Antilles réclament davantage de visibilité et de responsabilités pour leurs propres enfants. C’est dans cet entre-deux que s’enlise depuis des décennies la polémique, renaissant à chaque visite ministérielle ou chaque nomination perçue comme « extérieure ». D’où l’impression persistante d’un serpent de mer : une cause légitime dans son intention, mais dont la résolution semble éternellement reportée.
On pourrait alors qualifier ce débat de vieille lune, tant l’idée paraît usée et sans effet. Depuis les années 1970, la revendication existe, elle a même été partiellement intégrée dans certains secteurs – l’éducation nationale, l’Université, l’hôpital, la sécurité sociale, la caisse d’allocations familiales, certaines collectivités locales ont vu émerger des cadres antillais en nombre significatif.
Mais, la haute administration régalienne reste un bastion difficilement accessible, non pas par une volonté de mise à l’écart, mais parce que les règles du jeu sont nationales, les concours exigeants et les carrières jalonnées de mobilités hors des îles. Dès lors, le sentiment de décalage persiste.
On peut aussi considérer que l’antillanisation des cadres relève de la quadrature du cercle. Car dans le cadre de la départementalisation, aucune réforme statutaire structurelle ne viendra bouleverser le principe de mobilité nationale. Même un régime d’autonomie, à l’instar de la Polynésie française, ne résoudrait pas totalement la question, puisque les secteurs régaliens – justice, sécurité, finances publiques – resteraient sous l’autorité de l’État et donc encadrés par ses propres fonctionnaires.
La seule option qui permettrait une véritable autonomie de nomination serait l’indépendance, hypothèse jusqu’ici largement rejetée par les électorats antillais. En l’état, le problème reste donc sans solution miracle.
Faut-il alors se résigner ? Pas forcément. Si l’on accepte que la fonction publique d’État continuera d’être régie par des concours nationaux et des carrières tournantes, des marges de manœuvre existent néanmoins. Cela passe par une politique plus volontariste de préparation et d’accompagnement des candidats antillais aux concours éligibles à la haute fonction publique, par une meilleure valorisation des expériences locales dans les carrières administratives, ou encore par la création de passerelles dans les entreprises publiques et privées où la question des origines ne devrait pas être un frein à l’accès aux responsabilités.
Pour ce faire, encore faudrait-il qu’il y ait une volonté de retour au pays, et c’est loin d’être gagné d’avance tant les écueils s’avèrent insurmontables avec la question du management local. L’antillanisation ne saurait être un slogan creux, mais un objectif de justice et de représentativité, construit sur des bases concrètes.
Ainsi, plutôt que de s’enfermer dans l’opposition stérile entre vieille lune et quadrature du cercle, le débat gagnerait à être replacé dans une perspective pragmatique : comment donner plus de place aux compétences locales dans le respect des règles républicaines ? Comment concilier l’universalité des concours et la nécessité d’une meilleure représentativité territoriale ? Comment transformer une frustration récurrente des postulants au retour en dynamique constructive ?
Tant que ces questions resteront sans réponse, le serpent de mer de l’antillanisation continuera de hanter le paysage politique et médiatique des Antilles françaises, revenant par vagues successives au gré des indignations populaires. Et l’exemple de la Nouvelle-Calédonie montre bien que ce problème dépasse le cadre strict de la départementalisation : malgré une autonomie institutionnelle beaucoup plus large que celle de la Guadeloupe et de la Martinique et les velléités de parvenir à un statut d’État associé à la France, ce territoire reste confronté à la même difficulté, sinon aggravée par l’absence de cadres kanaks formés à la responsabilité de gestion, de promouvoir ses propres cadres dans les rouages de l’État et de l’économie.
Là-bas aussi, les élites locales peinent à accéder aux plus hautes responsabilités, et le sentiment d’un pouvoir confisqué par l’extérieur nourrit des tensions politiques récurrentes. Autrement dit, même dans un cadre institutionnel assoupli avec l’autonomie, l’équation reste difficile à résoudre, confirmant que le débat ne tient pas seulement aux statuts mais aussi à des réalités structurelles, culturelles et économiques qui, partout Outre-mer, posent la question cruciale de la réalité du désir patriotique de la place des populations locales dans la gouvernance de leur propre territoire.
En somme, c’est L’expression de « la quadrature du cercle » qui semble la plus appropriée pour désigner ce problème de l’antillanisation des cadres dont on sait par avance, parce que cela a été dûment démontré, qu’il n’a pas pour l’instant de solution.
» Fo pa nou antwé an lagiè san baton . » (Littéralement : Il ne faut pas entrer en guerre sans bâton.)
*Economiste et chroniqueur