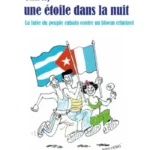PAR JEAN-MARIE NOL*
Un vent d’anarchie et de populisme souffle aujourd’hui sur la Martinique, nourri par un climat social délétère, une défiance croissante envers les institutions, et un profond sentiment de méfiance et d’abandon. A l’origine, la cause semblait claire et légitime : le coût de la vie, exorbitant, insupportable pour une majorité de foyers martiniquais.
Mais, ce qui aurait pu rester un combat structuré et solidaire tend désormais à glisser dangereusement vers des formes d’expressions radicales, dominées par la pression populaire, la remise en cause de l’ordre républicain et l’instrumentalisation d’une souffrance réelle par des courants plus radicaux. A qui la faute alors ? A l’État ? Aux élus locaux ? Ou bien à une société qui, lasse d’attendre une diminution du coût de la vie chère, a décidé de prendre les choses en main, quitte à remettre en cause les fondements démocratiques ?
Le paradoxe est criant. Tandis que l’État, en lien avec les collectivités et les acteurs économiques, se félicite d’un premier bilan encourageant du protocole contre la vie chère – une baisse moyenne des prix de 8,4 % constatée fin janvier 2025, avec plus de 81 % des références en diminution – la rue pourtant gronde , portée par des mouvements de plus en plus déterminés . La réunion du 24 avril à Fort-de-France entre le préfet, la CTM, les distributeurs et les socio-professionnels avait pour but d’apporter transparence et méthode.
L’objectif est clair : agir sur plusieurs leviers pour faire baisser durablement les prix des produits de consommation courante, notamment via la suppression de l’octroi de mer et de la TVA sur certaines familles de produits, ou encore la compensation des frais d’approche. En somme, des mesures concrètes, chiffrées, suivies.
Et pourtant, la défiance citoyenne persiste. Pourquoi ? Parce que derrière les chiffres, il y a des réalités quotidiennes qui ne se traduisent pas aussi rapidement dans le panier de la ménagère. Le citoyen, fatigué d’attendre des résultats palpables, peine à faire confiance à des institutions qui, par le passé, ont trop souvent échoué à répondre à ses attentes. Et dans ce vide de confiance, certains groupes émergent.
Le RPPRAC, par exemple, un collectif se revendiquant protecteur des peuples et des ressources afro-caribéennes, prend aujourd’hui la parole au nom de la population. Leur revendication ? L’organisation immédiate d’assises de la vie chère par Serge Letchimy , en présence de tous les députés ultramarins. Face au refus du président du Conseil exécutif, Serge Letchimy, de s’engager dans cette voie – préférant des ateliers en septembre – le collectif hausse le ton en occupant le parvis de la CTM et exige sa démission.
Cette situation illustre bien une dérive préoccupante : une petite frange de la société, se sentant ignorée, entend désormais imposer la démission du président de la CTM et un diktat aux élus, dans une logique d’affrontement plutôt que de coopération. La menace n’est plus seulement sociale, elle devient institutionnelle. Lorsque la rue dicte le calendrier politique, lorsque des associations minoritaires imposent leurs vues au nom d’un peuple dont elles s’érigent porte-paroles autoproclamés, c’est l’ordre démocratique lui-même qui vacille.
C’est l’exemple même du populisme dont le concept désigne l’instrumentalisation de l’opinion du peuple par des partis et des personnalités politiques qui s’en prétendent le porte-parole alors qu’ils appartiennent le plus souvent aux classes sociales supérieures de la départementalisation.D’où un rapport très problématique à la démocratie, par essence pluraliste : les populistes prétendent être les seuls à représenter le peuple et tous ceux qui s’opposent à eux et contestent leur revendication morale d’un monopole de la représentation populaire se voient automatiquement exclus du « vrai peuple ».
Il ne s’agit plus d’une simple mobilisation citoyenne, mais d’un véritable climat pré- insurrectionnel, où le populisme et l’anarchisme se mêlent, portés par un rejet viscéral des figures d’autorité et des cadres institutionnels.
Car c’est bien d’anarchie qu’il s’agit. Pas au sens philosophique noble du terme, où la société s’organiserait sans hiérarchie par la coopération et l’autogestion, mais bien d’un désordre structurel, d’un rejet de l’État, de la CTM et de ses représentants, perçus comme des obstacles plus que des alliés. Une société sans dirigeants, sans gouvernement, sans cadre reconnu : voilà ce que certains semblent appeler de leurs vœux, au nom de la dite souffrance populaire. Mais l’anarchie, dans ce contexte, n’est pas un projet de société ; c’est un cri de révolte, un symptôme d’un système perçu comme à bout de souffle.
Et pourtant, les efforts existent. Le préfet Étienne Desplanques l’a rappelé : il n’y a pas eu d’inflation intentionnelle, et les engagements sont suivis avec rigueur. Les prochaines étapes, notamment avec la suppression de la TVA depuis mars, devraient confirmer cette dynamique. La loi annoncée par le ministre des Outre-mer, manuel Valls, contre la vie chère, en cours d’élaboration, vise à renforcer encore ces dispositifs, notamment sur les frais d’approche et les tarifs d’export.
Mais, l’impatience, légitime après tant d’années de promesses non tenues, alimente aujourd’hui une radicalisation du discours et des pratiques.
A qui la faute, donc ? A chacun, un peu. À l’État, qui a trop longtemps tardé à traiter en profondeur les spécificités en matière de vie chère des territoires ultramarins. Aux élus locaux, parfois perçus comme déconnectés ou trop prudents. Aux mouvements populaires eux-mêmes, quand l’émotion et la passion l’emporte sur la raison, et que l’indignation devient colère destructrice avec à clé émeutes, pillages et destructions massives d’entreprises. Mais, surtout à une absence de dialogue franc et structuré, à un manque de lisibilité sur les actions entreprises, et à une fracture sociétale qui ne cesse de se creuser.
Il est encore temps d’inverser la tendance. Mais cela exige de chaque acteur – État, collectivités, société civile – qu’il sorte de ses postures. Que les institutions assument leurs responsabilités avec courage et transparence. Que les mouvements citoyens construisent plutôt qu’ils ne détruisent.
Que chacun renoue avec une vision commune de l’intérêt général. Sans quoi, le vent mauvais qui souffle aujourd’hui sur la Martinique ne sera pas celui du changement, mais celui de la rupture.
« Lentérésan sé pou an tan »
Traduction littérale : Faire son intéressant, c’est pour un temps.
Moralité : Cela ne sert à rien d’être arrogant et de proférer des oukases à tout bout de champ. Attention au retour de bâton.
*Economiste