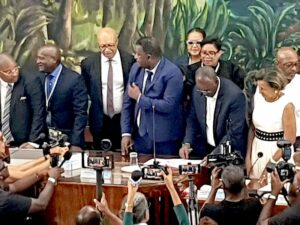PAR JEAN-MARIE NOL*
L’économie guadeloupéenne, structurellement fragile et très dépendante des transferts publics et subventions, reste aujourd’hui dans une position d’extrême vulnérabilité.
Sa pérennité repose presque entièrement sur l’appui jusqu’ici constant de l’État français, dont les subventions, exonérations sociales et sur-rémunérations de vie chère constituent la clé de voûte de son équilibre général. Dans ce contexte, il serait à la fois économiquement irrationnel et politiquement dangereux de prétendre rompre voire même affaiblir ce lien vital au nom d’une idéologie passéiste déconnectée des réalités.
L’autonomie institutionnelle, telle qu’envisagée dans le cadre de l’article 74 de la Constitution, pourrait rapidement se traduire par un effondrement du modèle économique local si elle s’accompagnait d’un recul du soutien financier et normatif de l’État.
Le maintien dans le droit commun dans une étape de transition de l’article 73, assorti d’un renforcement du pouvoir normatif local, préconisé par certains élus locaux et intellectuels, semble apparaître ainsi comme la seule voie raisonnable pour assurer à la Guadeloupe un avenir à la fois stable, solidaire et soutenable.
Les données économiques les plus récentes confirment cette dépendance. En 2023, les entreprises guadeloupéennes ont généré 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 3,7 milliards d’euros de valeur ajoutée, selon une étude de l’Insee. Le commerce y demeure le moteur central, représentant à lui seul 46 % de l’activité.
Derrière ces chiffres se cache une réalité plus inquiétante : les deux tiers de la valeur ajoutée sont absorbés par les charges de personnel, et les marges réelles, souvent fragiles, ne permettent qu’un autofinancement limité.
En d’autres termes, l’économie guadeloupéenne reste avant tout une économie de consommation, alimentée par les transferts publics, les salaires de la fonction publique et les dispositifs de compensation ultramarins. Sans ces apports, le modèle s’effondrerait rapidement. Dans cet ordre d’idée, force est de souligner que dès que les aides publiques et dotations sont en diminution en Guadeloupe, alors pour compenser le manque à gagner, c’est le contribuable qui paye la facture finale avec l’augmentation des impôts locaux
Cette dépendance, souvent dénoncée par les partisans d’un autre choix de société, n’est pas un choix politique mais un héritage structurel. L’insularité, la faible diversification productive, la taille réduite du marché et la dépendance logistique à la France hexagonale imposent une forme d’économie d’assistance partielle. C’est là un fait irréfutable et qui relève de la réflexion de bon sens .
Ce n’est pas un stigmate, mais un constat lucide. Sans transferts publics, comment expliquer le maintien d’un niveau de vie quasiment comparable à celui de l’Hexagone, l’existence d’une importante classe moyenne, la vitalité du commerce ou même la survie de nombreux services publics essentiels ? Comment, surtout, garantir la stabilité sociale dans une société déjà marquée par un chômage massif des jeunes, une précarité grandissante et une dépendance accrue aux emplois publics ?
C’est dans le commerce que cette fragilité est la plus manifeste. Le rapport de l’INSEE montre que ce secteur, bien qu’il constitue près de la moitié du chiffre d’affaires total de l’économie marchande, repose sur une dynamique de consommation directement soutenue par les revenus publics. Les 6,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires générés par le commerce en 2023 ne traduisent pas une véritable productivité locale, mais plutôt une activité de redistribution des revenus versés par l’État et les collectivités.
La sur-rémunération des fonctionnaires, les transferts sociaux et les exonérations de charges servent en réalité de carburant à cette économie de circulation monétaire. Si ces dispositifs venaient à être réduits, la consommation s’effondrerait mécaniquement, entraînant dans sa chute la rentabilité des commerces, la trésorerie des entreprises et l’emploi salarié.
À cette dépendance directe s’ajoute une autre dimension tout aussi essentielle : celle du financement privé. Le secteur bancaire joue en Guadeloupe un rôle stabilisateur déterminant. Les établissements de crédit, nourris par une épargne locale estimée à près de 5 milliards d’euros, soutiennent les ménages et les entreprises par des prêts à la consommation, des crédits immobiliers et des facilités de trésorerie.
Cette épargne, véritable poumon financier du territoire, alimente l’investissement et compense la faiblesse de la rentabilité des entreprises. Si la confiance venait à se déliter ou si les flux publics diminuaient, le système bancaire local serait directement affecté. Les risques d’impayés augmenteraient, les liquidités se raréfieraient et l’accès au crédit se restreindrait, enclenchant une spirale déflationniste dramatique.
Ainsi, le commerce, soutenu par la dépense publique et l’épargne privée, illustre à lui seul la précarité de l’équilibre économique guadeloupéen. L’économie repose sur trois piliers : la dépense publique, la consommation des ménages et le financement bancaire. Si l’un d’eux vacille, tout le système s’effondre comme un château de cartes. Et ce sont la classe moyenne et les couches populaires qui paieraient le prix le plus lourd.
Car derrière les équilibres comptables se joue une réalité humaine : celle d’une société où le pouvoir d’achat, déjà contraint par la cherté de la vie, se verrait laminé. Les ménages les plus modestes, privés d’aides, et les petites entreprises, asphyxiées par la contraction du crédit, seraient emportés dans un processus de paupérisation accéléré.
Les aides publiques, sous forme d’exonérations de charges sociales issues de la loi LODEOM de 2009, d’aides à l’investissement ou de sur-rémunération des fonctionnaires, sont le socle sur lequel repose la dynamique économique locale. Ces dispositifs soutiennent près de 50 000 entreprises, principalement des TPE et PME. Pourtant, les récentes annonces gouvernementales, prévoyant une réforme de ces exonérations et une économie budgétaire de 750 millions d’euros d’ici 2026, suscitent déjà l’inquiétude.
Si une telle réforme devait s’appliquer sans mesures compensatoires, l’impact sur l’emploi, les marges des entreprises et le pouvoir d’achat serait désastreux. L’Hexagone, confronté à un déficit des finances de l’État de 170 milliards d’euros et d’un déficit de la Sécurité sociale de 23 milliards d’euros, cherche à réduire ses dépenses. Or, dans ce contexte de rigueur, la Guadeloupe, dépendante de ces transferts, serait la première victime d’un désengagement précipité de l’État.
Ce désengagement ne serait pas seulement économique, mais aussi éminemment social. Le tissu associatif, déjà fragilisé par la baisse des subventions publiques, est un amortisseur essentiel dans la société guadeloupéenne. Quarante pour cent des associations ont déjà réduit leur masse salariale, neuf pour cent ont engagé des licenciements. Or, c’est précisément ce secteur qui maintient un lien social, culturel et éducatif fondamental, notamment dans les quartiers populaires. Si les coupes budgétaires se poursuivent, c’est tout un pan de la cohésion sociale qui risque de s’effondrer.
Dans le même temps, les augmentations successives de la Contribution sociale généralisée (CSG) ou la réduction envisagée des primes de fin d’année pour les bénéficiaires du RSA ,dans le projet de budget 2026, fragilisent encore davantage les ménages modestes.
En Guadeloupe, où le coût de la vie reste supérieur de près de 30 % à celui de la France hexagonale , ces ajustements budgétaires ne sont pas de simples variables d’ajustement : ils conditionnent la survie économique de dizaines de milliers de foyers. Même les dispositifs de soutien ponctuels, comme le chèque énergie 2025 pouvant aller jusqu’à prés de 300 euros, illustrent cette précarité structurelle : ils compensent à court terme des déséquilibres profonds que seule la solidarité nationale peut absorber durablement.
Face à ce tableau, certains élus locaux continuent de prôner sans réflexion forte et surtout sans aucune visibilité de l’avenir, un changement radical , au nom d’un projet de souveraineté politique ou d’émancipation administrative. Mais, cette revendication, aussi légitime qu’elle puisse paraître dans l’absolu, devient périlleuse si elle n’est pas précédée d’une réflexion économique prospective et sérieuse sur un changement de modèle économique, et d’un véritable plan de transition vers une économie de production avec le soutien de l’Europe.
Revendiquer un statut mal pensé dans le contexte actuel, c’est oublier que la Guadeloupe n’a aucune richesse propre connue à ce jour , n’a ni la base fiscale, ni le tissu productif, ni les ressources naturelles nécessaires pour compenser la fin des transferts publics. L’idéologie, lorsqu’elle supplante le pragmatisme, conduit souvent au désastre.
La France, de son côté, ne peut plus se permettre d’être dans une générosité sans contrepartie, et laisse donc entrevoir un basculement institutionnel vers l’Union Européenne. Les contraintes budgétaires qui pèsent sur l’État imposent une rationalisation des dépenses. Mais cette rationalisation doit être menée avec discernement, en distinguant ce qui relève du confort budgétaire de ce qui constitue un impératif de solidarité nationale.
Maintenir la Guadeloupe dans le giron de l’article 73, tout en lui conférant une capacité normative accrue, permettrait de conjuguer deux nécessités : d’une part, la préservation du lien financier et institutionnel avec la République ; d’autre part, l’adaptation des normes et politiques publiques aux réalités locales. C’est un équilibre subtil, mais c’est aussi le seul chemin viable vers une autonomie de gestion responsable et non une autonomie irréparable de rupture, car sur le plan géopolitique il n’existe malheureusement aucune autre alternative .
Le défi pour la Guadeloupe n’est donc pas de couper le cordon avec l’État, mais de mieux valoriser les transferts existants pour amorcer une diversification économique réelle. L’autonomie ne doit pas être un saut dans le vide, mais l’aboutissement d’un processus de consolidation. Avant de songer à se libérer du soutien français pour de sombres raisons de nature identitaire, encore faut-il être capable d’assurer soi-même les dépenses publiques, de garantir la stabilité des salaires, de soutenir le tissu productif et d’assumer la charge sociale et fiscale d’un territoire insulaire complexe à la merci de menaces climatiques et sur, et c’est sans compter le danger existentiel de la révolution technologique de l’intelligence artificielle.
En définitive, la Guadeloupe n’a pas besoin d’un changement de statut de l’article 74 pour progresser, mais d’une refondation du pacte de développement avec l’État. La priorité n’est pas de débattre de souveraineté, mais d’efficacité et de stabilité. Le réalisme économique doit primer sur l’illusion politique.
L’avenir du territoire dépend moins des discours d’émancipation que de la lucidité collective à reconnaître que, sans transferts publics, sans solidarité nationale, sans épargne locale mobilisée et sans vision économique partagée, la Guadeloupe risquerait de s’engager dans une spirale de déclin irréversible.
Le maintien dans le cadre protecteur de l’article 73, accompagné d’un pouvoir normatif renforcé, demeure aujourd’hui la condition sine qua non de la survie et du développement harmonieux de l’archipel.
_ »Two présé paka janmin fè jou ouvè « -_
Traduction littérale : Être trop pressé ne fait pas le jour commencer plus tot. Signifie qu’il ne sert à rien de courir, qu’il vaut mieux accomplir les choses en toute lucidité.
Moralité : Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
*Economiste et juriste en droit public