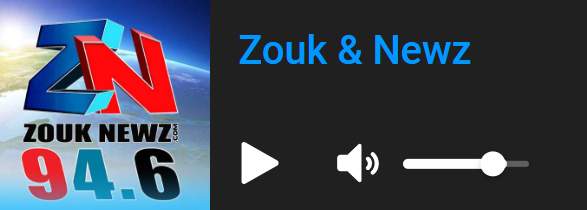Cette Cubaine est gestionnaire immobilière chez Greystar, l’une des plus grandes sociétés de gestion immobilière au monde.
L’histoire de Yanely Moreno est celle d’une femme qui a dû défier la mort à plusieurs reprises avant de pouvoir recommencer à zéro. Son arrivée aux États-Unis n’a pas été un parcours migratoire classique : elle a emprunté des routes dangereuses, a été kidnappée, a marché pendant des jours sans aucune certitude de survie, a subi des violences, la faim, des menaces et a cru, à un moment donné, ne jamais revoir sa famille.
À son arrivée aux États-Unis, la réalité n’a pas été facile non plus. Elle a dû accepter tous les emplois qu’elle pouvait trouver, s’adapter à une culture totalement différente et faire face à la solitude et à la vulnérabilité que connaissent des milliers de migrants sans réseau de soutien. Ses premières années ont été une succession de petits boulots, de sacrifices et d’apprentissages difficiles, alors qu’elle tentait de se stabiliser dans un pays qui offre des opportunités, mais qui exige aussi discipline, résilience et courage.
Aujourd’hui, cette même femme qui vivait autrefois dans la peur constante de la mort est gestionnaire immobilière chez Greystar, l’une des plus grandes sociétés de gestion immobilière au monde. Elle est à la tête de River Landing, l’un des projets immobiliers mixtes les plus importants du sud de la Floride, qui combine plus de 528 logements et un centre commercial de plus de 9 300 mètres carrés. Son ascension n’est pas le fruit du hasard : elle est le résultat d’années d’efforts, d’études, d’une éthique de travail irréprochable et d’un instinct de survie qu’elle a transformé en leadership.
Quelles valeurs vous ont été inculquées durant votre enfance ?
Quand j’étais petite, mon père me disait qu’être jolie et avoir un homme à charge avait un prix et que cela ne durait pas. Que la seule chose qui m’appartenait vraiment, c’était ce que j’étais capable d’apprendre, car le savoir ne prend pas de place. Il m’a appris que je devais étudier, être indépendante et ne pas me laisser faire par les hommes. Voilà l’éducation qu’il m’a donnée.
Qu’avez-vous étudié à Cuba ?
Je suis entrée à l’École Lénine en 1995, censément à la fin de la Période Spéciale. Là-bas, j’ai quitté le cocon familial. Mes parents étaient d’origine modeste : mon père était chauffeur de taxi et ma mère employée de bureau, tous deux très engagés dans la Révolution à l’époque. Je voulais étudier le droit, mais je n’ai pas obtenu la note requise et, comme il y avait une pénurie d’enseignants, on nous obligeait à choisir l’enseignement comme option. Je me suis retrouvée à l’Institut pédagogique Enrique José Varona, en spécialisation anglais. J’y ai étudié pendant quatre ans, mais je n’ai pas pu obtenir mon diplôme à ce moment-là car je suis tombée enceinte.
Avez-vous également suivi des cours du soir de comptabilité ?
Oui. J’ai suivi une formation de technicien comptable de niveau intermédiaire pour les travailleurs. Je l’ai fait parce que le père de mon fils rêvait d’émigrer. Il est finalement parti. Pas moi. À l’École Lénine, on nous conditionne à croire que nous sommes le terreau de la Révolution, alors je n’envisageais pas d’émigrer.
Quand votre perspective a-t-elle changé ?
Quand je me suis retrouvée seule avec mon fils. Je devais m’occuper de lui et subvenir à ses besoins. J’ai commencé à travailler chez Cadeca, un bureau de change, à l’époque où il y avait un système de double monnaie. J’y ai travaillé pendant cinq ans, avec des gardes de 24 heures suivies de gardes de 72 heures à l’aéroport. Je vivais confortablement. Mais un jour, il y a eu un contrôle : plusieurs de mes collègues ont été arrêtés pour « trafic illégal de devises ». Cela m’a effrayée et m’a fait comprendre que ce n’était pas le pays où je voulais élever mon fils, qu’il était impossible de vivre honnêtement.
Avez-vous repris vos études ?
Je suis retournée à l’université pour terminer mon diplôme, car je voulais devenir guide touristique et me préparer à quitter le pays. Le père de mon fils a fait une demande de regroupement familial en 2006 ou 2007. Cela a pris des années. En 2015, mon fils est arrivé aux États-Unis à l’âge de 13 ans. Je me concentre toujours sur ce que je peux contrôler, alors j’ai vendu ma maison et mes biens et je suis partie en Équateur, où aucun visa n’était requis. C’est là que mon aventure a commencé.
Comment s’est passé ce voyage ?
L’expérience la plus difficile que j’aie jamais vécue. Traverser l’Équateur, la Colombie, le Panama et l’Amérique centrale… c’était incroyablement éprouvant. Nous avons quitté Necoclí dans un bateau surchargé. Nous avons escaladé une montagne de nuit, sans dormir. Lors d’une descente, j’ai glissé et me suis retrouvé suspendu à une falaise. Mon compagnon m’a sauvé avec une corde. Nous sommes arrivés à Puerto Obaldía, où vivaient plus de 500 Cubains. Nous avions le choix entre la jungle et un petit avion. Nous n’avions pas d’argent, mais nous avons réussi à trouver un vol au bout d’une semaine.
Comment s’est passée votre expérience au Panama et en Amérique centrale ?
La police panaméenne nous a très mal traités. En tant qu’immigrants, vous ne valez rien, vous n’avez aucune protection. Ils vous regardent comme si vous n’étiez personne. Nous vivions dans la peur constante des vols, des viols, des disparitions. C’était très dur.
Que s’est-il passé au Mexique ?
À Tapachula, presque tous les Cubains se sont rendus à l’immigration, mais je ne voulais pas aller en prison. Nous avons décidé de longer la côte Pacifique pour éviter les points de contrôle jusqu’à Salina Cruz. Là, nous sommes tombés entre les mains d’hommes armés. Ils nous ont enfermés dans une cabane, nous ont pris nos téléphones et nous ont séparés : les femmes d’un côté, les hommes de l’autre. Nous y sommes restés une semaine, victimes de coups, de menaces et de demandes de rançon. Ce sont des souvenirs que j’ai encore du mal à surmonter.
Avez-vous réussi à vous échapper ?
Un jour, ils nous ont enlevé nos bandeaux et nous ont dit que nous pouvions continuer. Les passeurs étaient dehors. Nous sommes arrivés à l’aéroport pour poursuivre notre voyage, mais avant d’embarquer, la police mexicaine nous a arrêtés et emmenés à la prison de Las Agujas, où sont détenus les criminels sans papiers. Ils ont exigé 20 000 dollars pour notre libération. Nous y sommes restés 36 jours. La faim, les violences physiques, tout ce qu’on peut imaginer d’une prison. La seule chose qui me donnait de la force, c’était mon fils qui m’attendait.
Comment avez-vous vécu vos retrouvailles avec votre fils à votre arrivée aux États-Unis ?
Je suis arrivée un mercredi et son père me l’a amené le jeudi. Mon fils était un étranger pour moi. En deux mois et demi, il avait tellement grandi et changé. J’étais anéantie. Nous nous sommes serrés dans les bras et il m’a demandé de lui raconter le voyage. Je lui ai dit que je ne lui dirais rien, mais que j’étais là maintenant et que tout allait bien.
Comment se sont passés vos premiers mois à Miami ?
Difficiles. Ma famille avait une petite entreprise de gestion de copropriétés. Ils m’ont trouvé un emploi à 8 $ de l’heure. Je suis arrivée avec 20 000 $ de dettes. Je n’aimais ni Miami ni les États-Unis. Je vivais dans un studio à Kendall avec cinq autres personnes. Je ne comprenais rien au système scolaire. Je pleurais tous les jours dans la salle de bain en me demandant : « Qu’est-ce que je fais ici ? » Mais je voyais mon fils s’adapter, apprendre l’anglais, se faire des amis. Et je me suis dit : « S’il y arrive, je peux y arriver aussi. »
Quels autres défis avez-vous rencontrés durant cette période ?
Un an et demi plus tard, on a diagnostiqué chez ma compagne un cancer de la gorge de stade 4. Nous n’avions pas d’assurance maladie. Nous sommes allés à l’hôpital Jackson Memorial, et 21 jours plus tard, elle en est sortie avec une trachéotomie, incapable de parler, et suivant des séances de radiothérapie et de chimiothérapie. Au milieu de tout cela, j’ai vu une annonce sur Craigslist pour un poste de gestionnaire de portefeuille aux Keys. J’ai acheté une robe chez Ross, je suis allée à l’entretien et j’ai dit quelques petits mensonges pour paraître mieux préparée, mais l’intervieweur a perçu mon enthousiasme et m’a donné ma chance.
Comment avez-vous progressé professionnellement ?
Grâce à un travail acharné. Plus tard, un recruteur m’a appelée pour me proposer un poste de gestionnaire d’un gratte-ciel de plus de 400 appartements en centre-ville. L’augmentation de salaire était énorme, tout comme les responsabilités. Cet immeuble avait un budget de 15 millions de dollars. Après cela, j’en suis arrivée là où je suis aujourd’hui.
En quoi consiste votre travail actuellement ?
Je gère un budget annuel de plus de 20 millions de dollars pour cet immeuble. J’analyse le marché, gère les recettes et les dépenses, contractualise les services, encadre le personnel, supervise la maintenance et rédige des rapports financiers pour les propriétaires et la société de gestion. L’immeuble compte 528 logements, allant du studio au T4. Le loyer d’un T4 peut atteindre 12 000 $ par mois ; celui d’un studio se situe entre 1 900 $ et 2 000 $.
Source : Cubanet
Lien : https://www.cubanet.org/cuba-no-tenia-vida-para-mi-manager-de-la-inmobiliaria-mas-grande-del-mundo/