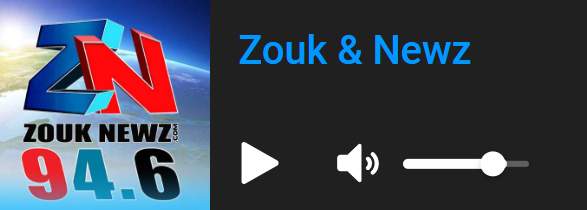Les années 1990 arrivèrent, et Nelson Pino embarqua sur un radeau. Il dériva pendant six jours, la mort planant au loin. Plus tard, il subit la perte définitive de sa mère alors qu’il était encore détenu à la base navale de Guantanamo.
En 1980, sa mère tenta de faire sortir Nelson et sa sœur de Cuba par Mariel. Lorsqu’ils furent prêts, son père arriva avec la police pour les empêcher de partir. Il avait à peine sept ans lorsqu’il vit sa mère se faire arrêter, sous les jets d’œufs des voisins qui les insultaient en criant « vermine ! », « vermine ! ». Seule, malade, avec deux jeunes enfants, elle fut profondément marquée par cette humiliation publique et son arrestation.
Dès lors, il comprit ce que signifiait être mis à l’écart. Il vit sa mère, souffrant d’une dépression nerveuse, se détériorer, porter le fardeau de la stigmatisation, et pourtant ne jamais baisser les bras. D’elle, il hérita d’une solide éthique du travail et d’une détermination à réussir.
Les années 90 arrivèrent et Nelson Pino embarqua sur un radeau. Il dériva pendant six jours, la mort planant au loin. Puis, alors qu’il était encore détenu à la base navale de Guantanamo, il perdit définitivement sa mère, laissant sa sœur de 15 ans seule. Il finit par atteindre les États-Unis et commença à occuper des emplois modestes. Aujourd’hui, il est à la tête d’une entreprise florissante et de trois restaurants.
— Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance ?
Mon enfance a été merveilleuse, une enfance d’apprentissage, d’épanouissement, une enfance qui a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd’hui. J’avais une mère courageuse, une femme qui m’a tant appris sur l’entrepreneuriat, car elle n’a jamais cessé de travailler. Elle est décédée très jeune, mais son empreinte a été immense. Nous n’étions que ma sœur, ma mère et moi, et nous étions très heureux. Nous sortions, nous nous amusions, et même si nous vivions dans un pays aux besoins nombreux, nous ne manquions de rien. Je le dois à ma mère et à ma famille, qui ont toujours lutté, fait preuve d’esprit d’entreprise et de persévérance. Je voulais suivre cette même lignée, cette même tradition familiale.
— À quel moment avez-vous commencé à réaliser qu’il n’y avait pas d’avenir à Cuba ?
Très jeune, j’ai vu la différence. J’ai compris qu’il n’y avait pas d’avenir dans un pays où l’on ne pouvait pas s’épanouir au-delà de certaines limites. J’ai commencé à réfléchir à comment partir. Mes oncles étaient partis très jeunes, en 1981. Ma mère a divorcé de mon père quand j’avais environ six ans. Ensuite, elle s’est remariée avec quelqu’un qui voulait partir par Mariel.
— Avez-vous essayé de partir par Mariel ?
Oui. En 1980, nous avons essayé de partir. J’avais environ sept ans, et je me souviens d’être allé à Mariel, dans un endroit qui ressemblait à un bâtiment avec beaucoup de chaises où des gens attendaient. Les quais étaient là. Mon père est arrivé avec la police parce que nous partions sans sa permission. Ma mère a été arrêtée. Elle est tombée très malade à ce moment-là. Il y a eu tout le drame : les œufs, les cris, le retour à la maison. Le pire, c’était que beaucoup des gens du quartier qui nous avaient agressés venaient ensuite prendre un café avec nous. C’est comme ça à Cuba. On n’oublie pas, mais il faut apprendre à pardonner, car la rancune nous poursuit toute une vie. Ma mère a beaucoup souffert, et nous avons raté l’occasion de partir quand j’avais sept ans et ma sœur cinq.
— Comment as-tu vécu ce rejet ?
On te traitait comme un criminel. J’étais très jeune et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais j’avais peur. Voir une mère seule, malade, avec deux petits enfants, et ne rien pouvoir faire pendant que des adultes te criaient dessus et te jetaient des pierres et des œufs… ça marque. Ma mère a toujours souffert de troubles mentaux. Tout cela, ajouté aux pénuries quotidiennes — d’eau, de nourriture, au stress constant — a laissé des cicatrices. J’éprouvais de la honte, de la confusion, de la culpabilité… Je ne savais pas qui était responsable. Je sentais que je devais les protéger parce que j’étais le fils ; mais je n’étais qu’un enfant.
—En as-tu déjà parlé à ton père ?
Je ne l’ai jamais confronté directement à ce sujet. Il vit à Cuba. Je l’aide parce que c’est mon père. Mais je n’ai jamais pu lui pardonner. J’ai toujours gardé ça pour moi. Peut-être qu’il verra cette vidéo, et ce sera la première fois, en 51 ans, que je le dirai devant une caméra. Je n’ai jamais eu le courage de lui en parler en face. Cela m’a profondément marquée ; cela a compromis mon avenir et a eu un impact considérable sur ma mère, qui était mon pilier, mon héroïne, mon tout. Je l’aime, mais il est vrai que cela m’a énormément affectée. Après cela, mon père a continué sa vie et, contrairement à ma mère, il n’était pas toujours présent.
— Est-ce que cela a influencé votre refus de vivre à Cuba ?
Oui. Ce n’était pas de la haine, mais un profond rejet. Je savais que je ne pourrais pas être la personne que je voulais être là-bas. Je voyais les parents de mes amis, leurs grands-parents, tous dans la même situation : ils luttaient pour survivre, pour avoir un vélo, de quoi manger. Je savais que les choses n’allaient pas s’améliorer. On ressentait aussi le rejet à l’école quand ils ont appris que j’avais essayé de partir. Tous les professeurs n’étaient pas comme ça, mais il y avait clairement une différence dans la façon dont ils nous traitaient.
— Vous avez essayé de partir à nouveau…
Oui, en 1991. Je voulais déjà quitter l’école, et mon père m’a trouvé du travail dans un motel, le Vista Alegre, à l’entretien. Là-bas, avec une débroussailleuse, on a fabriqué un moteur pour un radeau. On a tout construit avec beaucoup d’efforts. On était six. Quand on a été prêts, des hommes nous ont découverts, prétendant être à la pêche aux crabes. Ils ont promis de ne pas nous trahir, mais quarante minutes plus tard, les militaires sont arrivés. Ils nous ont arrêtés. J’ai été emprisonné à Villa Marista pendant plus d’un mois. J’avais environ 16 ans.
— Et finalement, en 1994 ?
Nous sommes partis en 1994. Nous avons passé six jours en mer. Notre radeau était endommagé et nous en avons trouvé un autre avec deux corps. Ce radeau nous a sauvé la vie à six. La marine américaine nous a secourus. Ils nous ont emmenés à Guantanamo, puis au Panama. J’y suis resté six mois. En décembre de cette année-là, ma mère est décédée à 42 ans. Ma sœur s’est retrouvée seule à Cuba à 15 ans. J’ai passé un an et trois mois à Guantanamo avant d’arriver aux États-Unis.
— Comment êtes-vous arrivé ici ?
Mon grand-père était déjà ici. Il était comme un père pour moi, le pilier de la famille. Il m’a trouvé un emploi dans une boulangerie. Plus tard, j’ai travaillé dans le câble, chez MediaOne, puis j’ai commencé à chercher des moyens de créer ma propre entreprise.
— D’où vous vient votre goût pour le travail manuel et l’entrepreneuriat ?
J’ai toujours eu un atelier à la maison. On fabriquait des barbecues, des meubles, on faisait de la soudure. J’ai commencé avec des food trucks. J’ai travaillé, j’en ai acheté un, puis deux, puis d’autres. J’ai vendu, investi, connu des échecs, mais je me suis relevé. J’ai lancé une entreprise sans permis, ils l’ont fermée. J’ai recommencé. Ici, on tombe, on se relève, et on n’oublie pas l’expérience.
— Comment vous êtes-vous lancé dans la construction de food trucks ?
Ma femme et moi avons commencé avec une petite boutique. Ensuite, nous nous sommes mis à vendre du matériel de restauration. Quelqu’un nous a demandé si nous fabriquions des food trucks, et nous avons dit oui. Nous en avons fabriqué un, puis un autre, et encore un autre. De gros contrats ont suivi : des écoles, de grandes entreprises. Nous avons constitué une équipe solide. Avec Reef Technology, nous avons fabriqué plus de 100 camions. C’était un contrat de plusieurs millions de dollars qui nous a donné un coup de pouce considérable. Après cela, nous avons commencé à fabriquer des salles de bains, des cuisines… Notre entreprise s’appelle S4L Industries.
— Nelson, vous avez aussi des restaurants maintenant…
Oui, au départ c’était un passe-temps. On a ouvert Cubiche, puis Butcher Cuisine à Miami Lakes, et enfin Cubiche Barbecue Ranch, un ranch avec de la musique live et un grill. J’aime travailler, être sur le terrain. Je travaille sept jours sur sept et je m’y sens bien.
— Quel conseil donneriez-vous à ceux qui débutent ?
Il faut être reconnaissant envers ce pays. Apprenez de ceux qui ont de l’expérience. Le travail acharné ne tue personne. Il faut d’abord se construire des bases solides et s’enraciner, puis prendre du plaisir. Concentrez-vous sur ce que vous aimez et faites-le. Les échecs sont formateurs. C’est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd’hui.
— Et votre sœur ?
Ma sœur est une battante. Elle est devenue médecin à Cuba, immunologiste. On ne l’a pas laissée partir. Elle est venue aux États-Unis pour un congrès et elle est restée. Aujourd’hui, elle est médecin ici et elle exerce. Elle a fait tellement de sacrifices et elle a déjà fait venir sa famille. La voir réussir est une de mes plus grandes joies. »
— Si vous étiez resté à Cuba, Nelson, que pensez-vous qu’il se serait passé ?
Je ne me vois pas travailler pour le gouvernement. J’aurais peut-être fini en prison, ou perdu. À Cuba, tenter sa chance est dangereux. Chacun se débrouille comme il peut. Je suis reconnaissant d’être parti et pour tout ce que j’ai pu construire.
Source : Cubanet
Lien : https://www.cubanet.org/estuvimos-seis-dias-en-el-mar-y-una-balsa-con-dos-muertos-nos-salvo-la-vida/