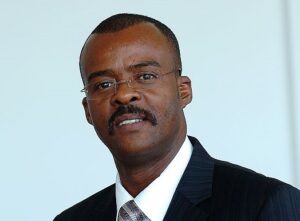Un mois et demi après son arrivée en Guadeloupe, le préfet de Région, Thierry Devimeux, aborde les sujets importants de la Guadeloupe : l’eau qui ne coule pas toujours dans les robinets, l’agriculture est moribonde, les sargasses, la violence scolaire, les violences, le nombre important de morts sur les routes, les difficultés des entreprises. Le préfet Devimeux a pris les dossiers à cœur, avec la conscience que le territoire n’est pas facile mais qu’il existe des solutions à mettre en œuvre avec les élus et les Guadeloupéens.
PAR ANDRÉ-JEAN VIDAL ET CÉCILIA LARNEY

maire de Basse-Terre

président de la Région

président du Département
La Guadeloupe, premières impressions ?
Je suis très agréablement surpris par la gentillesse des gens. Ils m’interpellent dans la rue, me disent « Bonjour », me souhaitent la bienvenue en permanence.
Un dossier prégnant : l’eau. Que peut-on en dire ?
Je ne comprends même pas comment les Guadeloupéens ont pu résister depuis aussi longtemps. Une gestion aussi désastreuse de ce qui est essentiel à la vie, au développement d’un territoire ! C’est un scandale. Ça va être très compliqué d’avancer parce qu’il faut de l’ingénierie qu’il n’y a pas, il faut une volonté interne que je ne vois pas vraiment. Il faudra aussi beaucoup, beaucoup d’argent. Il faudrait bien sûr que les usagers se remettent à payer l’eau. C’est la condition, le point de départ.
Une fois que j’ai dressé cette situation catastrophique, je vois des petites lueurs quand même. J’avais travaillé ce dossier avant d’arriver en Guadeloupe. La création du syndicat unique est une bonne idée. Il n’y a pas d’autre solution. Tous les autres discours qui laissent penser qu’on pourrait revenir à la solution d’avant sont de mauvaises idées. Gérer de l’approvisionnement, de la distribution et de l’assainissement, c’est tout cela qu’il faut faire. Le président du SMGEAG me semble très volontaire. En tout cas, j’ai beaucoup d’échanges avec lui.
« C’est clair que la Guadeloupe va continuer
à souffrir d’un manque d’eau. »

Ce président était pourtant à la tête de la précédente structure qui a failli. Ne faudrait-il pas changer de gouvernance à la tête du SMGEAG ?
Je n’en sais rien. Moi, je fais avec ce qui est le rôle de l’État et ce n’est pas de prendre la main sur ce dossier. Ce serait désastreux. Je suis là pour accompagner le territoire, mais pas pour faire à la place des élus. Ce n’est pas que je ne veux pas, c’est, qu’encore une fois, dans notre système, il y a une démocratie locale qu’il faut respecter. Il y a des élus locaux et je suis là pour les accompagner si je le souhaite, mais s’ils ne veulent pas, je ne les accompagne pas. Je ne suis surtout pas là pour faire à leur place. Ce serait revenir à un temps de l’après-guerre qui n’est plus, où l’État décidait pour les territoires.
Je suis, je le dis encore une fois, volontaire pour accompagner, et pour cela, je me mobilise. C’est le travail que je fais en ce moment. Le président du syndicat et la dernière réunion du Conseil syndical qui ont acté la création de la régie, c’est bien. Mais, ce n’est qu’une toute petite première marche sur un escalier qui peut compter 500 marches. J’espère que cela va être possible.
Je travaille en confiance avec le président du SMGEAG. D’ailleurs, je travaille tout autant en confiance avec les présidents des deux grandes collectivités parce qu’on a besoin d’eux aussi. Alors, est-ce qu’on y arrivera ? C’est beaucoup trop tôt pour le dire. La Guadeloupe va continuer à souffrir d’un manque d’eau, ça c’est clair. On n’arrivera pas à résoudre le sujet très vite. Mais, il faut y croire parce qu’on n’a pas d’autre solution que d’y croire. Il n’y a pas d’autre solution que d’avancer dans ce sens.
« Si le SMGEAG, via son comité syndical, n’est pas animé
avec une volonté farouche par les forces politiques,
cela ne marchera pas. »
La gouvernance à 4 dont on ne sait pas si elle est toujours d’actualité est-elle efficiente, au-delà des mots et des bonnes intentions ?
La gouvernance à 4 est toujours d’actualité. Peut-être que le défaut qu’elle a eu ces dernières années, c’est d’être très pilotée par l’État et que le syndicat, qui normalement est au cœur des dispositifs, se sentait un peu relégué à la marge. C’est vrai que le syndicat a besoin des grands partenaires, Etat-Région-Département.
Bien sûr qu’il faut une gouvernance à 4, mais pilotée par le syndicat. Il faut structurer. J’ai 11 assistants techniques, payés à 100% par l’État, qui sont au quotidien auprès de l’administration du syndicat. Il faut que cette administration s’en saisisse. Il faut qu’ils les pressurent, qu’ils apprennent de leur expérience, qu’ils fertilisent leur savoir-faire grâce à eux. C’est la seule condition aujourd’hui.
On a dit souvent, et je l’ai dit plusieurs fois, qu’il fallait 2 milliards pour rénover le réseau d’eau et le réseau d’assainissement et qu’on mettra cinquante ans. Mais oui il faudra des milliards et il faudra que les Guadeloupéens paient l’eau et l’assainissement et moi je mettrai la force de frappe de l’Etat pour faire en sorte de contraindre les Guadeloupéens à payer. C’est indispensable sinon on n’y arrivera jamais.
Ceci dit, le préalable de tout cela, c’est que le syndicat se structure, se professionnalise, pour être en capacité de relever ce challenge. Aujourd’hui, la priorité des priorités, c’est d’avoir un syndicat qui fonctionne. La seconde priorité, qui vient tout de suite après, c’est des sous pour qu’il puisse investir, rénover les réseaux, offrir un service de meilleure qualité.
On a parfois l’impression que Ferdy Louisy, le président de ce syndicat, est un peu seul.
Je le pense aussi.
On a même l’impression qu’il n’est pas soutenu.
Ce que j’ai constaté, et c’est peut-être le défaut de ce syndicat, c’est que, quand il a été créé par la loi, il y a eu un transfert des EPCI vers le syndicat, elles-mêmes ayant eu cette compétence par les communes. Les territoires, communes et intercommunalités, ne se sentent plus concernés par le sujet, alors qu’ils sont au cœur du sujet. Si ce SMGEAG, via son comité syndical, n’est pas animé avec une volonté farouche, par les forces politiques, cela ne marchera pas.
Effectivement, aujourd’hui, le président ne me semble pas très soutenu par les communes et les intercommunalités. D’ailleurs, je réfléchis à des actions pour faire comprendre aux collectivités locales, aux intercommunalités qu’elles sont la clé, qu’elles sont à la source du problème et qu’elles sont aussi la solution du problème. Le syndicat, c’est la cerise sur le gâteau et le gâteau, ce sont les collectivités locales.
« Nous avons besoin d’une agriculture puissante
et l’agriculture aujourd’hui n’est pas suffisamment puissante. »

Alors que les aides à l’agriculture restent constantes ou augmentent sensiblement, l’agriculture — et l’élevage — local produit de moins en moins. Certains syndicats demandent des états-généraux, qu’on mette tout à plat. Que faire ?
Je suis assez partant pour des états-généraux de l’agriculture. Même si mes services me disent que nous avons déjà tous les diagnostics, qu’on sait ce qui se passe, qu’on sait pourquoi cela ne marche pas. Effectivement, cela ne marche pas.
Aujourd’hui, l’agriculture est dominée par deux grandes productions, la banane et la canne à sucre, qui resteront les deux grandes productions qui structurent l’agriculture en Guadeloupe, mais il faut aller plus loin. Il faut renforcer la diversification et là, nous sommes à la peine. La filière viande bovine s’effondre, la filière volaille végète, le maraîchage végète aussi. Nous avons besoin de développer ces filières. Il y a, il faut le dire, un manque d’attractivité de ces métiers agricoles auprès des jeunes, de la relève possible. Alors, effectivement, des états-généraux pourraient nous permettre de nous réveiller collectivement. Je suis favorable à y participer si c’était décidé parce que, clairement, nous avons besoin d’une agriculture puissante et que, tout aussi clairement, l’agriculture aujourd’hui n’est pas suffisamment puissante.
« Il faut absolument qu’on arrive à répondre
aux enjeux et à la demande des agriculteurs. »
La souveraineté alimentaire fait partie de la feuille de route de la DAAF. On en est loin ! On importe de plus en plus.
On a du mal à diversifier. Je dis bien diversifier. La canne et la banane resteront. C’est le complément de la canne et de la banane qui permettra de développer d’autres choses. L’autosuffisance alimentaire, on en est très loin, parce que l’agriculture n’est pas en mesure aujourd’hui, de répondre à ce défi. Il faut une feuille de route claire, des ambitions. Je pense que les agriculteurs les ont, quoique le monde agricole soit encore très divisé. Il faut un portage politique fort pour amener les financements. Nous avons la chance dans ce territoire d’avoir une grande quantité de fonds européens et en particulier le FEADER qui est là pour accompagner ces états-généraux de l’agriculture.
Une intersyndicale agricole représentative s’est plainte que les dossiers du FEADER mettent trop longtemps à être traités. Il y aurait un problème de logiciel…
Il y a quelques années, j’ai été autorité de gestion du FEADER, entre autres. C’était sur un autre territoire. Il y avait 2 milliards d’euros à gérer, à La Réunion. Je connais parfaitement les difficultés techniques, administratives qu’il y a dans la gestion des fonds européens. C’est compliqué à gérer et pourtant, il faut être ultra réactif parce que ce sont des outils très puissants pour accompagner, impulser, l’économie du territoire. Quand on parle du FEADER, du FEDER, du FSE, du FEAMPA, ces outils sont très puissants. La Guadeloupe en a besoin donc il faut absolument qu’on arrive à répondre aux enjeux et à la demande des agriculteurs.
« Nous payons entre 80 et 100% du ramassage
des sargasses, soit 20 millions depuis quatre ans. »
Les sargasses. Faut-il une loi pour changer les choses ?
Les sargasses sont l’une des conséquences du dérèglement climatique. On subit. Tout l’arc caribéen, l’Amérique centrale, le sud de l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, la côte ouest de l’Afrique. C’est un phénomène lié au réchauffement climatique de la mer et à l’augmentation des pollutions, des matières azotées qui arrivent dans la mer par les grands fleuves : le fleuve Congo, l’Amazone, le Mississipi… On n’y peut rien. La seule chose que nous pouvons faire, c’est de limiter l’arrivée des sargasses sur nos côtes, sur les plages. Avec tous les désagréments que cela génère. Nous pouvons essayer de les ramasser, ce que font les communes aidées par l’Etat.
Nous payons entre 80 et 100 % du ramassage des sargasses, soit 20 millions depuis quatre ans. Nous pouvons faire en sorte que ces sargasses n’approchent pas des côtes, c’est mieux. Nous mettons en place des barrages flottants, des barrages déviants… Mais, ces actions-là sont très tributaires des courants marins, c’est de l’artisanat. Nous avons du mal, parce qu’on connaît encore mal le phénomène, de passer de l’artisanat à quelque chose qui soit de l’anticipation.
Nous n’arriverons pas à anticiper tant que nous ne connaîtrons pas bien cette algue. C’est pour cela que l’action de l’Etat est à trois niveaux : la recherche, c’est-à-dire comment mieux comprendre la biologie de cette algue pour, peut-être, demain, en limiter la reproduction. Ce sont les financements de l’Agence nationale pour la recherche, l’ANR, des financements européens, des financements internationaux pour que des chercheurs se penchent sur la question. L’argent est là et des équipes, partout dans le monde, sont mobilisées.
Le deuxième sujet c’est que, quand les sargasses sont là, on gère sur nos côtes. Pour l’instant, c’est de l’artisanat et il faut développer des systèmes pour éviter que les sargasses n’arrivent sur nos plages.
« L’Etat en Guadeloupe n’a pas baissé les bras
et reste très mobilisé dans la lutte contre les sargasses. »
Le troisième sujet est d’étudier l’impact sur la santé publique. Nous sommes sur ce sujet mais nous ne communiquons pas assez. Tous les Guadeloupéens savent que cela sent mauvais, que les sargasses dégagent de l’anhydride sulfureux. Nous avons des capteurs, il y a des alertes régulières, ce qui est très bien. Mais, c’est le point de départ et maintenant, il faut mesurer avec précision quels sont les impacts sur la santé humaine. Des études épidémiologiques sont faites, menées par des laboratoires et des chercheurs à partir des données de Guadeloupe, de Martinique et d’autres pays du monde.
Nous subissons, contrairement aux algues bleues en Bretagne pour lesquelles beaucoup de gens font un parallèle. En Bretagne, on ne subit pas parce c’est dû à l’agriculture bretonne, aux élevages de porcs. Les matières azotées vont dans la mer, amenées par les rivières, ce qui permet aux algues de se multiplier. Si on arrive à réguler une agriculture bretonne plus performante, on règle de fait le problème des algues.
Les sargasses ne sont pas la faute des Guadeloupéens, on n’y peut rien, on essaie de lutter. Pour les algues bleues, l’Etat a mis 130 millions d’euros pour lutter contre le phénomène, dont 110 millions d’euros pour modifier les pratiques agricoles et assécher la source et 20 millions pour le ramassage, le nettoiement d’un linéaire côtier de 1 200 kilomètres. En Guadeloupe, nous avons mis 20 millions d’euros sur le linéaire côtier comme en Bretagne sauf qu’il n’y a que 400 kilomètres de côtes. L’Etat en Guadeloupe n’a pas baissé les bras et reste très mobilisé. Pour les habitants des communes qui sont impactées, c’est l’enfer ! Je salue l’implication de la Région, du Département, des collectivités, nous sommes tous engagés, mais nous n’avons pour l’instant pas réglé le problème.
« Je m’organise pour que nous puissions saisir les voitures. »
La sécurité routière : 42 morts à ce jour sur les routes. Plus qu’en 2024. Que peut-on faire ?
Très bonne question que j’ai tendance à retourner à ceux qui me la posent ! Je constate qu’il y a beaucoup de gens qui ont des comportements inappropriés, et c’est un terme « soft » pour en parler. Il y a des gens qui conduisent n’importe comment, en téléphonant, sans regarder à gauche et à droite… 42 morts, c’est une chose mais, sur ces 42 morts, il y a des gens qui n’avaient rien demandé, qui n’ont fait aucune erreur, qui étaient sur un espace public, la route, et qui se sont fait tuer par un chauffard qui, lui, n’a pas respecté le code de la route parce qu’il était alcoolisé, drogué, etc. C’est insupportable !
Ma réaction, c’est dire qu’il faut faire plus de contrôles par les forces de l’ordre. On voit des gendarmes quasiment à tous les ronds-points. Il faut augmenter le nombre de retraits de permis de conduire. Je vais, prochainement, durcir les pénalités, pour retirer plus de permis encore et augmenter la pression sur les mauvais conducteurs. Je m’organise pour que nous puissions saisir les voitures. Quelqu’un qui commet une grosse bêtise, un gros excès de vitesse, par exemple, si aujourd’hui on lui dit d’appeler un proche pour conduire la voiture jusqu’à la maison, demain ce sera la confiscation de la voiture et il faudra la récupérer à la fourrière. Il y aura un délai de rétention de sept jours pendant lesquels le chauffard va payer l’amende, les frais de garde à la fourrière. Si après, cela ne sert pas de leçon…
Quand on sait le rapport de certains conducteurs à la voiture…
Oui, et c’est l’une des explications, je pense, aux incivilités routières, peut-être exacerbée par des frustrations. Comme partout en France, les gens se libèrent au volant de leur voiture. La voiture est un exutoire de puissance. Autre effet pervers, c’est l’autosolisme. Tout le monde a sa voiture et se promène tout seul dans cette voiture. Cela génère des embouteillages, des énervements, des frustrations, d’où des incivilités. Sans oublier l’effet de serre, qui abîme la planète, génère le réchauffement climatique, le recul du trait de côte, des sècheresses ou des inondations, etc. Il y a un vrai sujet sociétal du rapport des Guadeloupéens à la voiture.
« Il n’est pas acceptable que dans l’école
circulent violences, armes, drogues. »

Les violences scolaires sont de plus en plus fréquentes. Que proposez-vous ?
L’école est le lieu de l’apprentissage, de l’émancipation. Quand on a appris, qu’on est moins ignare, on comprend mieux le monde, on est mieux inséré à la société et on peut mieux contribuer au développement de celle-ci. Il faut que l’école fonctionne et, pour que celle-ci fonctionne, il faut des enseignants engagés, c’est le cas. Il faut des bâtiments de qualité, et je trouve que ce que j’ai visité est de plutôt bonne qualité et il faut surtout que cette école soit une zone de quiétude. Il n’est pas acceptable que dans l’école circulent violences, armes, drogues. Ce n’est pas tolérable. Quand c’est le cas, les conditions ne sont pas réunies pour que nos enfants apprennent en toute sérénité.
Nous avons eu des consignes du ministère de l’Intérieur que nous appliquons en Guadeloupe : des contrôles à l’extérieur, parce que les lycées et les collèges ne sont pas déconnectés de la société, mais aussi des contrôles à l’intérieur, ce que j’ai fait le 7 octobre au lycée de Lamentin. Il y a eu une grosse opération qui a un peu surpris les jeunes. Quand vous faites rentrer les gendarmes avec les chiens anti-drogue dans les classes, cela permet de faire passer le message. On ne peut pas se permettre de laisser passer des armes, de la drogue dans les collèges et les lycées. On doit pourvoir travailler sans tension, ni violence. Ces actions vont continuer.
Nous allons travailler avec le président du conseil régional pour améliorer la sécurité passive des lycées : enceintes bien fermées pour qu’il n’y ait pas de grillages troués et des gens qui font des intrusions, et des tourniquets pour recenser les personnes qui entrent ou sortent, avec leurs badges, afin de savoir où sont les élèves, surtout en cas de difficultés. Il s’agira aussi d’installer des portiques pour éviter qu’on entre avec des armes. Il y a plein de régions de l’Hexagone avec des portiques dans tous les lycées. Avec le président de Région, nous nous sommes mis d’accord pour que, dans les lycées, la Région puisse renforcer la sécurité passive. Il y aura aussi des caméras qui contribueront à pacifier l’intérieur des lycées parce que, quand les jeunes savent qu’ils sont filmés dans la cour, ils font plus attention.
La Guadeloupe est exposée à différents risques naturels. Est-on prêts ?
L’événement que nous avons vécu il y a quelques jours, Jerry, qui n’était pas un événement climatique majeur, mais une tempête tropicale qui a secoué un peu, m’a montré que le système était résilient : tout le monde s’est mis en action, Etat et collectivités, la population qui est habituée à ce type de risque s’est mise à l’abri, a suivi les consignes. Nous avons eu un mort à déplorer, c’est regrettable. Mais, globalement, je trouve que la Guadeloupe est bien préparée et c’est une force. Les événements climatiques vont se multiplier et la question de la préparation de la gestion de ces événements est fondamentale. La gestion de l’événement et de l’après, la résilience, pour qu’on se prépare pour le coup suivant, c’est acquis.
« La sécurité n’est pas l’affaire que de l’Etat
et des forces de l’ordre. »
Les violences de toutes natures sont de plus en plus exacerbées. Les forces de sécurité intérieures ont-elles les moyens de leurs missions ?
Oui. Les violences sont de plus en plus exacerbées. Au sein de la société guadeloupéenne, les armes y circulent de plus en plus. Les gens, pour un oui ou un non, s’énervent, dans la sphère familiale ou pour arracher une chaîne en or. On ne va pas se contenter de l’arracher, on va menacer la personne avec un pistolet.
Le ministre de l’Intérieur, quand il est venu il y a deux mois, a fait des annonces pour renforcer les moyens, c’est fait. La deuxième compagnie de gendarmes mobile est là, la demi-compagnie de gardes républicains est là, les moyens de l’OFAST ont été renforcés. Tout est en place et les forces de l’ordre ont les moyens de leurs missions. Mais, la sécurité n’est pas l’affaire que de l’Etat et des forces de l’ordre.
Le ministre Retailleau disait souvent qu’il faut encourager le continuum de sécurité. Ce sont les forces d’Etat, le préfet avec les forces de l’ordre, l’Etat-Justice qui doit condamner les délits et les crimes et, en amont, ce sont les collectivités locales, avec leurs polices municipales, leurs équipements de vidéosurveillance et c’est aussi l’affaire de tout le monde : des parents qui sont responsables de leurs enfants, des gens qui n’hésitent plus à dire qu’ils ont repéré un point de deal. Il faut que ces interventions continuent.
Tout le monde doit se sentir acteur de la sécurité : dès qu’il y a un élément de la chaîne qui est défaillant, cette chaîne s’affaiblit et l’efficacité est réduite. La sécurité, c’est un Etat présent, et il l’est. Tous les autres partenaires doivent être présents avec vigueur. Et, en particulier, les habitants, et j’insiste sur ces habitants qui doivent être présents.
« L’Etat surveille de près la santé économique du territoire. »
La Guadeloupe a un fort taux de liquidation d’entreprises. José Gaddarkhan, président de la Fédération du BTP, a alerté sur le fait que la fermeture d’une carrière, à Deshaies, entraînait un marasme et des risques pour les entreprises de son secteur, avec un cortège de liquidations, de chômeurs. Que peut-on faire ?
L’Etat surveille de près la santé économique du territoire. D’abord, parce que le territoire est petit, donc l’économie est petite et ainsi plus sensible aux dysfonctionnements. Dysfonctionnement de concurrence potentielle, dysfonctionnement de la chaîne de paiement des entreprises. Nous sommes très vigilants pour surveiller l’état de santé des entreprises, les délais de paiement de celles-ci, surveiller le nombre de faillites, les comportements vertueux ou pas des chefs d’entreprise, qui paient ou pas leurs charges. Ce sont des éléments très importants parce qu’on sait que le moindre grain de sable peut entraîner des difficultés.
Vous citez la carrière de Deshaies, qui met en difficulté, parce qu’elle est fermée, le secteur du BTP. Nos difficultés, c’est surtout des délais de paiement anormalement longs, ici. On ne peut pas obliger une entreprise à supporter des délais de paiement hors normes alors qu’elle n’y est pour rien, qu’elle a fait le service pour lequel elle doit être rémunérée. Je pense aux collectivités, au CHUG, qui ont des délais de paiement trop importants.
L’Etat, non ?
Pour ce qui est de l’Etat, nous en sommes à 13 jours contre 132 pour les collectivités. Nous avons, aussi, un rôle dans l’accompagnement des investissements. Une entreprise qui fonctionne bien est une entreprise qui investit. Et ici, puisque le marché est restreint, que les capacités des entreprises sont plus complexes, que les banques sont plus frileuses, l’Etat doit être là pour accompagner avec la défiscalisation, les aides directes. Nous sommes là pour accompagner le territoire.