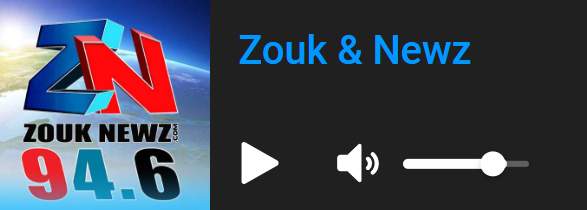Quand les Casques bleus ont quitté Haïti, le 15 octobre 2017, ils ont emporté bien plus que des containers, des véhicules et des uniformes.
Ils sont partis avec une mémoire stratégique complète, patiemment construite depuis treize ans : des cartes criminologiques mises à jour plusieurs fois par semaine, des dossiers détaillés sur les chefs de gang, des analyses de flux financiers, des doctrines opérationnelles testées sur le terrain. Une architecture de renseignement qui n’a jamais trouvé preneur. Pas par rétention, mais parce que rien n’était prêt pour la recevoir.
C’est ce que note l’International Peace Institute dans son rapport sur la transition post-MINUSTAH : la mission est partie “sans plan clair de transfert des capacités”, dans un contexte où aucun organisme haïtien n’était en mesure d’absorber, sécuriser ou exploiter ces données (IPI, 2018). On ne transmet pas une base de renseignement à un espace administratif vide. Et pourtant, c’est exactement ce qui s’est produit.
Pendant les années où la MINUSTAH affrontait les gangs, le cœur de la mission n’était pas les blindés, ni les patrouilles, ni les checkpoints. C’était une petite cellule : le Joint Mission Analysis Centre. Le JMAC fusionnait rapports de patrouille, sources humaines, images satellitaires, observations discrètes sur le terrain. Il produisait des dossiers complets : habitudes des chefs, déplacements, relais, zones de refuge, sources de liquidité. En 2007, c’est ce travail qui a permis d’arrêter Zachari, puis Ti Bazile, Evens Jeune, Belony, Ti Will. Rien de spectaculaire. Juste un renseignement méticuleux.
Après le séisme de 2010, cette machine s’est encore perfectionnée. Les cartes produites alors : densité de population, points de contrôle informel, axes de mobilité criminelle préfiguraient déjà les frontières du pouvoir armé en 2020 ou 2025. Ceux qui ont consulté ces documents soulignent à quel point la fragmentation actuelle de Port-au-Prince était visible dans les couches SIG que la mission mettait à jour chaque semaine (Security Council Report, 2017). La MINUSTAH pouvait prédire ce qui se déroulerait ensuite.
Mais aucune institution haïtienne n’a reçu ce savoir. Aucun organisme n’a hérité des cartes, ni des méthodes, ni des protocoles. L’OIF, dans sa note sur le post-MINUSTAH, rappelle que la mission a quitté un pays où “aucune structure nationale pérenne n’avait été mise en place pour garantir la continuité des capacités” (OIF, 2022). Ce n’est pas que l’État a oublié. C’est qu’il n’a jamais reçu.
Pendant ce temps, les gangs évoluaient. En l’absence de surveillance structurée, ils ont pu se transformer sans contrainte. Ils se sont armés à un niveau inédit. En 2007, ils disposaient surtout de pistolets et de fusils artisanaux. En 2025, le pays compte entre 270 000 et 500 000 armes à feu, selon Robert Muggah, dont une part considérable contrôlée par les groupes criminels : AR-15, AK-47, fusils de précision de calibre .50, munitions de guerre venant principalement de Floride. La puissance de feu dépasse parfois celle de la police.
Ils se sont fédérés. Au lieu d’une multitude de petites bandes, Haïti fait désormais face à de grandes coalitions : le G9, le G-Pèp, Viv Ansanm. Plusieurs milliers de combattants organisés, contrôlant près de 80 % de la capitale selon les estimations onusiennes. Une coordination que la MINUSTAH n’avait jamais rencontrée dans ces proportions.
Ils ont bâti des économies diversifiées. Kidnapping, carburant, marchés, routes, transferts. Comme le montre Robert Fatton, ces groupes ne sont plus seulement des prédateurs : ils sont devenus des acteurs qui capturent la rente, structurent des territoires, imposent des règles. Ils incarnent ce que la littérature nomme la “criminal governance” : une autorité parallèle, avec sa fiscalité, sa justice, sa police informelle.
Ils ont pris la parole. Publiquement. Caméras, ultimatums, discours. En 2024, une alliance criminelle peut forcer la démission d’un Premier ministre et fermer un aéroport. C’est une mutation politique, et non plus simplement criminelle.
Pendant que les gangs montaient en puissance, l’État avançait dans le noir. Sans outil de suivi, sans données, sans doctrine. Après le départ de la MINUSTAH, aucun relais n’a été mis en place. Les commissariats abandonnés, les véhicules immobilisés, les communications en panne. La police s’est repliée vers des interventions ponctuelles, brèves, sans continuité : exactement le modèle que Kalyvas identifie comme le plus propice à l’enracinement de la violence.
Ce n’était pas une défaillance morale. C’était une défaillance structurelle. Pour transmettre, il faut un réceptacle. Pour hériter, il faut une institution. Haïti n’avait ni l’un ni l’autre.
La MINUSTAH avait pourtant compris quelque chose d’essentiel : on ne stabilise pas une zone avec une opération, mais avec une présence. « Nettoyer, tenir, construire. » Une logique patiente, qui combine renseignement, occupation du terrain et reconstruction. Ce savoir existe. Il a été éprouvé. Mais personne, en 2017, n’a été en mesure de le faire vivre après le départ de la mission.
En 2025, la Force de répression des gangs (FRG ) arrive. Avec ses analystes, ses cartes, ses doctrines. Une nouvelle mémoire s’accumule. Une nouvelle machine se met en marche. Rien ne garantit qu’elle réussira, mais sa capacité d’analyse sera réelle. La question, pourtant, n’est pas là. Elle est ailleurs : que restera-t-il quand elle partira ?
Si une cellule nationale n’est pas créée maintenant pour recevoir ce que la FRG découvrira, alors l’histoire se répétera. Comme en 2017. Comme en 2004. Une mission arrive, comprend, agit, s’en va et le pays se retrouve seul, avec un vide plus lourd qu’avant.
Mais cela n’a rien d’inéluctable. D’autres nations ont su transformer l’aide internationale en capacité durable. La Colombie a absorbé les méthodes américaines au point d’en faire sa doctrine. Le Salvador a institutionnalisé l’analyse post-conflit. Le savoir étranger n’est pas fait pour rester étranger : il est fait pour devenir local.
Et c’est là que se joue l’avenir. Non dans une bataille décisive contre un groupe armé. Non dans une intervention spectaculaire. Mais dans la création, au cœur de l’État, d’un espace où le savoir ne se perd plus. Où les missions internationales ne repartent plus avec ce qu’elles ont appris. Où la mémoire devient une continuité et non une parenthèse.
Ce qui vient maintenant peut être une rupture. La FRG ne restera pas éternellement. Mais son départ n’est pas condamné à ouvrir un gouffre. Il peut être un seuil. Un passage. La première fois où Haïti décide que la connaissance produite sur son territoire lui appartient. La première fois où une architecture étrangère devient une capacité nationale.
Rien n’oblige le pays à répéter le scénario de 2017. Rien n’interdit d’inventer un autre avenir. L’histoire n’est jamais écrite d’avance. Elle attend que quelqu’un la prenne au sérieux.
La véritable question est simple : cette fois-ci, Haïti décidera-t-elle de garder la mémoire ?
Source : Le Nouvelliste
Lien : https://lenouvelliste.com/article/262400/la-minustah-savait-letat-na-jamais-recu-les-donnees