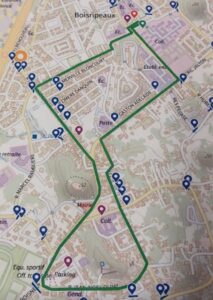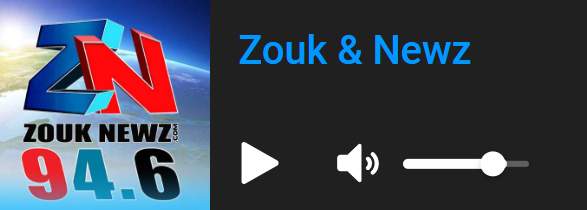PAR JEAN-MARIE NOL*
Le paysage économique guadeloupéen contemporain, marqué par la domination d’intérêts martiniquais békés et de groupes métropolitains, ne peut être compris sans revenir à une donnée structurante et largement méconnue du débat public : l’absence durable d’une bourgeoisie nationale endogène capable de se reproduire, de s’organiser et de porter un projet politique et économique autonome.
Cette absence n’est ni le fruit d’une fatalité culturelle ni celui d’un simple retard de développement, mais le résultat d’un enchaînement historique singulier, violent et profondément différencié de celui qu’a connu la Martinique, qui a brisé très tôt les conditions matérielles et symboliques de l’émergence d’une classe bourgeoise guadeloupéenne au sens plein du terme.
Dans toutes les sociétés capitalistes, la bourgeoisie ne se définit pas seulement par la richesse, mais par un faisceau de caractéristiques objectives : la détention durable des moyens de production, la capacité à transmettre un capital économique et symbolique sur plusieurs générations, l’existence de lignées familiales solidement ancrées dans un territoire, une sociabilité spécifique, des réseaux d’alliance et une conscience de classe suffisamment structurée pour produire une idéologie justifiant sa domination.
En ce sens, la bourgeoisie constitue bien une classe sociale au sens marxiste, c’est-à-dire un groupe dominant qui, au-delà de ses divisions internes, partage des intérêts communs et développe des représentations du monde visant à naturaliser sa position. Or, en Guadeloupe, ce processus a été interrompu, fragmenté, puis durablement empêché, d’où les balbutiements du nationalisme.
Sous l’Ancien Régime, les premiers colons français installés en Guadeloupe correspondaient, pour une part, à cette bourgeoisie coloniale naissante. Certains disposaient de capitaux, d’autres de titres ou de prestige social, beaucoup cherchaient à convertir dans le Nouveau Monde des ressources symboliques ou financières devenues insuffisantes en métropole. À leurs côtés, une masse bien plus nombreuse de « petits blancs », engagés pour trente-six mois, constituait la base laborieuse de la colonisation. Exploités dans des conditions proches de l’esclavage, ces engagés ne formaient pas une bourgeoisie, mais ils furent l’un des socles humains sur lesquels se construisit l’économie de plantation.
L’introduction massive de l’esclavage africain transforma radicalement cette société en instaurant une hiérarchie fondée sur la couleur, qui offrit aux blancs, même pauvres, une position sociale relative supérieure, consolidant ainsi une stratification raciale durable.
Ce système, profondément inégalitaire, permit l’émergence d’une classe dominante blanche locale, détentrice des terres, des sucreries et des circuits commerciaux, autrement dit d’une bourgeoisie coloniale guadeloupéenne. Mais cette bourgeoisie, contrairement à celle de la Martinique, ne survécut pas aux secousses révolutionnaires.
La Révolution française, et plus particulièrement l’épisode de 1794 sous Victor Hugues, constitua une rupture décisive. Les colons blancs guadeloupéens furent massivement ruinés, exilés ou totalement exterminés, souvent davantage par les révolutionnaires envoyés de l’Hexagone que par les anciens esclaves eux-mêmes. Ce moment historique, rarement intégré à l’analyse économique contemporaine, a détruit la continuité lignagère indispensable à la reproduction d’une bourgeoisie nationale.
La Martinique, restée à l’écart de la tourmente révolutionnaire, conserva au contraire une grande partie de sa classe dominante blanche. Les békés martiniquais purent maintenir leurs patrimoines fonciers, bénéficier de fortes indemnités pour la perte des esclaves, préserver leurs réseaux familiaux et transmettre leurs entreprises de génération en génération.
C’est cette continuité historique qui explique aujourd’hui leur puissance économique et leur capacité à investir hors de leur territoire d’origine, notamment en Guadeloupe. Là où la Martinique a connu une adaptation progressive de sa bourgeoisie aux transformations du capitalisme, la Guadeloupe a subi une rupture brutale qui a laissé un vide durable, et qui explique le paysage actuel de l’économie.
Les « blancs créoles » ou « blan péyi » de Guadeloupe, souvent confondus dans le débat public avec les békés, ne constituent pas une bourgeoisie nationale au sens classique. Pour beaucoup, ils ne sont pas les descendants directs des premiers colons exterminés à la fin du XVIIIe siècle, mais des Français installés ultérieurement pour faire fonctionner l’économie sucrière ou occuper des positions intermédiaires dans le fonctionnement de l’administration.
Les blancs créoles et « Blancs-Matignon », groupe singulier issu d’une implantation ancienne et relativement isolée, illustrent cette complexité : s’ils constituent un groupe social spécifique, fortement endogame et enraciné, ils n’ont jamais disposé de la masse critique de capitaux ni de la reconnaissance politique suffisante pour structurer une bourgeoisie hégémonique à l’échelle de l’archipel.
Cette disparition précoce de la bourgeoisie blanche locale a eu des conséquences profondes sur la trajectoire économique guadeloupéenne. Privée de classe capitaliste nationale capable de porter un projet économique autonome, la Guadeloupe s’est trouvée progressivement intégrée à des logiques exogènes : d’abord celles de l’État colonial, puis celles de l’État assimilationniste, enfin celles des grands groupes métropolitains et martiniquais.
Le capital n’a pas disparu, mais il est devenu majoritairement extérieur, contrôlé par des acteurs dont les centres de décision, les stratégies et les intérêts fondamentaux ne sont pas enracinés localement.
Dans la théorie marxiste, le nationalisme bourgeois est l’idéologie par laquelle la classe dominante cherche à transcender les antagonismes de classe au nom d’une unité nationale. Or, en Guadeloupe, l’absence d’une bourgeoisie nationale a rendu impossible l’émergence d’un tel nationalisme.
Le nationalisme guadeloupéen s’est développé sans classe dominante locale pour le porter, ce qui explique son caractère paradoxal, fragmenté et souvent cantonné au registre culturel ou identitaire symbolique. Faute de bourgeoisie nationale, le discours nationaliste ne s’est pas adossé à une stratégie économique cohérente de contrôle des moyens de production, mais s’est exprimé principalement comme une contestation de la domination extérieure, sans capacité réelle à la remplacer.
Les débats mémoriels contemporains, qu’ils s’inscrivent dans la tradition marxiste d’Henri Bangou ou dans des écritures historiques issues de cercles blancs créoles, révèlent cette fracture fondamentale. D’un côté, une histoire centrée sur la conscience politique noire et la résistance à l’esclavage, qui fonde une identité guadeloupéenne majoritaire mais ne débouche pas sur une classe capitaliste endogène.
De l’autre, une mémoire blanche créole marquée par la perte, le déclassement et la disparition d’un pouvoir économique autrefois réel, mais désormais largement transféré à des acteurs extérieurs. Ces récits ne sont pas de simples divergences historiographiques : ils traduisent l’impossibilité historique d’une synthèse nationale autour d’un projet économique porté de l’intérieur.
C’est dans ce vide structurel que se sont engouffrés les békés martiniquais et les groupes métropolitains. Leur domination actuelle ne relève ni d’un complot ni d’une supériorité raciale intrinsèque, mais d’une trajectoire historique où la continuité du capital, des réseaux familiaux et des savoir-faire entrepreneuriaux a été préservée chez les uns et brisée chez les autres.
La Guadeloupe n’a pas manqué d’élites, ni de talents, ni même d’entrepreneurs issus des milieux populaires ou « de couleur », mais elle a manqué d’une bourgeoisie nationale capable de s’imposer durablement comme classe dominante locale.
Ainsi, le paysage économique guadeloupéen actuel apparaît moins comme une anomalie que comme la conséquence logique d’une histoire de ruptures, de violences politiques et de discontinuités sociales. Comprendre l’absence d’une bourgeoisie nationale en Guadeloupe, ce n’est pas ressasser le passé, mais éclairer les mécanismes profonds qui continuent de structurer la dépendance économique du territoire.
Tant que cette question ne sera pas posée en termes historiques et structurels, le débat sur l’indépendance, l’autonomie politique, le développement endogène, l’autonomie économique ou la souveraineté restera prisonnier de lectures morales ou identitaires, incapables de saisir la racine véritable des déséquilibres actuels. Seule la réflexion sur une autonomie économique avec une réforme de l’actuel modèle économique et social pourrait enrayer la domination d’acteurs étrangers au territoire et rebattre les cartes du développement.
Pour conclure — en tenant compte des mutations économiques, technologiques, sociales et sociétales qui façonnent déjà le présent — il faut lire l’absence d’une bourgeoisie nationale en Guadeloupe non comme une malédiction immuable mais comme une contrainte historique dont la trajectoire peut être infléchie d’ici 2035 si des choix publics et privés cohérents sont opérés. La combinaison d’infrastructures numériques désormais disponibles, d’une transition énergétique amorcée, d’une pression sociale sur l’emploi et le coût de la vie, et d’une recomposition des rapports de propriété crée à la fois des risques de reproduction des dépendances et des opportunités réelles de relocalisation et de création de capitaux endogènes.
Le déploiement massif de la fibre optique, achevé récemment et susceptible de rendre la Grande-Terre et la Basse-Terre pleinement connectées, change radicalement l’équation : il abaisse le coût d’accès aux marchés numériques, permet l’apparition de nouveaux entrants locaux et services à forte valeur ajoutée locaux (édition logicielle, plateformes, services cloud locaux pour l’administration et les entreprises) et facilite la formation à distance d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. Mais à lui seul l’accès ne suffit pas : il faut que circulent aussi le capital et l’épargne, les compétences managériales et les instruments financiers adaptés à l’archipel.
La trajectoire énergétique amorcée — conversion de centrales vers la biomasse , l’hydrogène et projets renouvelables tel que la géothermie— peut réduire la vulnérabilité importée des énergies fossiles et offrir une base industrielle locale (maintenance, filières de biomasse, stockage, microgrids). En rendant l’électricité plus verte et potentiellement moins soumise aux chocs internationaux, la Guadeloupe gagne un atout pour attirer des investissements industriels légers et des data centers régionaux, condition sine qua non pour capter une partie des services numériques aujourd’hui hébergés hors territoire.
Mais, encore une fois, il s’agit d’un levier : sans appropriation locale des actifs (modèles de participation citoyenne, clubs d’investissements, coopératives, partenariats publics-privés favorisant l’actionnariat local), ces filières risquent de bénéficier surtout à acteurs extérieurs déjà structurés.
Le précédent réunionnais — ouverture récente d’infrastructures de type data center Tier 3 — montre qu’un positionnement régional sur l’hébergement et la souveraineté des données est possible et rentable, à condition d’anticiper normes, sécurité et résilience climatique. La Guadeloupe, ambitieuse, pourrait viser la création d’un pôle numérique régional (data center, back-up, hubs cloud, services télécoms) pour servir l’arc caribéen francophone ; ce serait une manière visible de construire des actifs stratégiques locaux et de créer des emplois qualifiés, tout en limitant la fuite des services vers des plateformes métropolitaines.
Mais, là encore, la gouvernance des projets (qui détient, qui gère, qui profite) déterminera si ces gains renforcent une bourgeoisie nationale ou au contraire consolident la dépendance à des groupes extérieurs.
Sur le plan social et démographique, la Guadeloupe affronte des défis lourds : des taux de chômage structurellement élevés et une précarité qui alimentent la désaffection envers les filières scolaires et professionnelles classiques. Sans politiques volontaristes de formation, d’appui à l’entrepreneuriat (incubateurs, capital-risque régional, accompagnement des PME) et de promotion de l’industrialisation légère, les gains technologiques risquent de rester marginaux.
C’est pourquoi toute stratégie visant à favoriser l’émergence d’une bourgeoisie économique endogène doit lier développement des infrastructures et construction d’écosystèmes humains — écoles techniques, université appliquée, formation continue — qui permettent la reproduction non seulement du capital financier mais aussi du capital humain et social. Les données récentes montrent que le territoire reste fragile sur l’emploi ; sans insertion durable des jeunes dans des métiers porteurs, la dynamique de création de richesse risque d’être interrompue.
Enfin, la réalité politique et le poids des grands groupes familiaux martiniquais et métropolitains — héritiers d’une continuité patrimoniale que la Guadeloupe n’a pas eue — ne disparaîtront pas spontanément. La question n’est pas de mener une lutte identitaire symbolique, mais d’inventer des instruments institutionnels et économiques permettant la capitalisation locale : régimes fiscaux incitatifs pour l’investissement local, foncières citoyennes pour l’acquisition progressive de terres et d’actifs productifs, encouragement des participations croisées entre acteurs locaux, et cadres réglementaires protégeant les petites et moyennes entreprises contre la captation oligopolistique. Sans ces instruments, et surtout sans changement de la « mentalité de fonctionnaires » la modernisation technologique et énergétique risque de consolider les bénéficiaires actuels plutôt que d’en créer de nouveaux.
En somme, l’avenir économique prévisible de la Guadeloupe à l’horizon 2030–2035 offre deux scénarios plausibles : l’un, pessimiste, où la modernisation reste extraite — fibre, énergie verte, data centers — mais contrôlée par des acteurs extérieurs, renforçant la dépendance et les inégalités ; l’autre, proactif, où ces mêmes mutations servent de matrice à l’émergence d’un capitalisme local durable, fondé sur l’appropriation collective d’actifs stratégiques, la montée en compétence des populations et des mécanismes institutionnels favorisant l’actionnariat et l’entrepreneuriat locaux.
Transformer l’absence historique d’une bourgeoisie nationale en une stratégie de développement inclusif suppose donc d’articuler simultanément infrastructures, formation, financements et gouvernance — c’est-à-dire d’agir sur les conditions mêmes de reproduction d’une classe dirigeante locale, mais démocratiquement ancrée et socialement ouverte. Cela est possible ; cela exigera du temps, des choix courageux et une vision partagée. Mais, s’engager dès à présent dans un processus d’autonomie politique est incontestablement courir à l’échec sur toute la ligne, vu le tarissement prévisible des investissements publics.
Pwan digad !
*Economiste et juriste en droit des affaires*