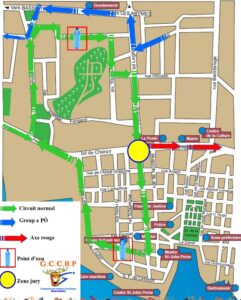PAR JEAN-MARIE NOL*
L’un des signaux les plus préoccupants pour l’avenir institutionnel et économique de la Guadeloupe réside dans l’incapacité chronique de ses élus à anticiper les crises structurelles, notamment dans la gestion des services publics essentiels.
L’exemple emblématique demeure celui de la gestion de l’eau. Les territoires de Guadeloupe et de Martinique font aujourd’hui face à une menace dont la gravité n’a pas été suffisamment anticipée par leurs responsables politiques : celle d’un effondrement progressif de leurs finances publiques locales, déjà fragilisées par des années de gestion approximative, de dépenses peu maîtrisées et d’un manque criant de vision prospective stratégique.
Le drame silencieux de la gestion de l’eau en Guadeloupe en constitue l’illustration la plus frappante. Alors que près de 60 % des eaux distribuées continuent de se perdre dans un réseau vétuste, le syndicat chargé de l’eau et de l’assainissement, le SMGEAG, se retrouve au bord de la cessation de paiement, accablé par un déficit abyssal de près de 100 millions d’euros , ainsi que des factures impayées des usagers avoisinant les 50 millions d’euros.
Cette quasi-faillite d’origine collective n’est pas le fruit du hasard, mais bien la conséquence directe d’années d’errances managériales, d’absence de planification, de responsabilité diluée et de décisions politiques remises toujours au lendemain. Les élus n’ont pas su anticiper l’inéluctable : un réseau vieillissant, des investissements colossaux nécessaires, une gouvernance éclatée et, au final, une perte de confiance massive des usagers envers les institutions.
Aujourd’hui, l’urgence est telle que la survie même du syndicat exige des mesures drastiques, des plans d’action accélérés, des dispositifs de télégestion et une mobilisation générale des citoyens. Or cette situation n’est que le miroir grossissant d’un danger plus vaste : la gestion des collectivités locales de Guadeloupe pourrait suivre exactement le même chemin.
Car ce qui s’est produit pour l’eau – corruption de dirigeants dans le passé , désinvestissement, incohérences politiques, confusion institutionnelle et retards accumulés – menace désormais de se reproduire à l’échelle des finances publiques locales. Ce parallèle est d’autant plus inquiétant que la conjoncture nationale accentue la fragilité des territoires ultramarins : les coupes budgétaires de l’État, la réduction progressive des exonérations, la contraction des recettes fiscales et la montée des déficits conduisent mécaniquement à un modèle voué à la rupture si les collectivités n’engagent pas un changement radical de gestion et de stratégie.
La crise du SMGEAG n’est pas un accident : elle est un avertissement. Elle montre ce qu’il en coûte de ne pas anticiper, de ne pas réformer, de ne pas moderniser. Elle révèle que l’inaction n’est pas neutre : elle se paye en pénuries d’eau, en infrastructures délabrées, en baisse de qualité de service et, surtout, en perte de confiance des citoyens.
Si cette même logique de laisser-faire, de pilotage à vue et de dépendance systématique à l’État perdure dans la gestion générale des collectivités, alors la Guadeloupe et la Martinique se dirigeront fatalement vers une crise encore plus profonde, comparable à celle des 54 départements métropolitains en quasi-faillite. Et cette fois-ci, il ne s’agira plus seulement d’eau, mais d’éducation, de routes, d’action sociale, de culture, d’entretien des infrastructures, bref : de l’ensemble des piliers du vivre-ensemble.
Cette crise, loin d’être un accident isolé, constitue un avertissement majeur : sans une rupture nette dans les méthodes de gouvernance, les collectivités locales de Guadeloupe risquent de basculer dans un scénario identique, reproduisant mécaniquement les mêmes erreurs, les mêmes retards, la même incapacité à gérer durablement les biens communs.
La Guadeloupe et la Martinique abordent aujourd’hui un tournant historique où se conjuguent un modèle économique à bout de souffle, une mutation profonde du travail et un désengagement progressif de l’État. Ces territoires ultramarins, longtemps portés par un système de transferts massifs et de dépenses publiques généreuses, se retrouvent à l’épreuve d’un changement de paradigme dont les conséquences seront déterminantes pour les décennies à venir.
Leur économie, fondée sur la consommation plutôt que sur la production, s’est construite autour d’une solidarité nationale qui a assuré stabilité sociale et maintien du pouvoir d’achat. Mais cette même solidarité, indispensable, est devenue le terreau d’une dépendance structurelle qui fragilise aujourd’hui tout l’édifice.
À force de compenser les fragilités, de subventionner les déséquilibres et d’amortir les crises, le système a progressivement atrophié la capacité autonome de création de richesse. Le travail lui-même s’est dévalorisé, comme vidé de son essence, transformé en simple variable d’ajustement dans un modèle où la précarité côtoie les conforts relatifs des statuts publics.
L’assistanat, au lieu de corriger les inégalités, les a figées ; au lieu de stimuler les énergies, il a installé un immobilisme économique qui pèse sur l’ensemble de la société.
En Guadeloupe, près de 38 % des emplois salariés relèvent de la fonction publique, contre 23 % en Hexagone. La masse salariale publique représente à elle seule près de la moitié du revenu total du travail distribué sur l’île, tandis que les transferts sociaux et les subventions diverses complètent un système où plus de la moitié du revenu des ménages provient directement de l’État.
La Martinique présente une situation similaire, avec un secteur public omniprésent et une économie privée cantonnée à quelques activités à faible valeur ajoutée. Ces chiffres traduisent une réalité : les territoires vivent sous perfusion budgétaire, dans une économie d’amortissement plutôt que de développement.
Le secteur privé, structurellement faible, ne parvient ni à attirer suffisamment d’investissements, ni à créer un nombre significatif d’emplois productifs. Cette dépendance extrême n’est plus tenable dans un pays où, sous la pression des déficits, l’État réduit progressivement son soutien financier.
Les annonces récentes de coupes dans les exonérations sociales, dans les dotations et dans les aides sectorielles constituent déjà un signal clair : le cycle de l’expansion budgétaire est terminé.
Dans l’Hexagone, la situation financière des collectivités locales est devenue alarmante, et elle envoie un avertissement sévère aux territoires d’Outre-mer. Cinquante-quatre départements sont désormais en situation de quasi-faillite, pris au piège entre l’envolée de leurs dépenses sociales, l’imposition de nouvelles charges par l’État et l’effondrement des recettes, notamment dues à la chute des transactions immobilières.
Certains comme la Gironde affichent des déficits historiques dépassant les 90 millions d’euros, au point de frôler la mise sous tutelle. D’autres réduisent drastiquement les budgets culturels, ferment des centres de santé, diminuent les aides sociales ou renoncent à des investissements structurants.
La Charente, incapable de voter un budget équilibré, a déjà été placée sous tutelle préfectorale, rappelant la réalité d’un risque longtemps jugé théorique. Ces décisions, douloureuses mais imposées par les contraintes financières, témoignent d’une vérité implacable : aucun territoire n’est à l’abri.
Et si des départements métropolitains, mieux dotés en ressources fiscales et moins dépendants de l’État que les territoires ultramarins, se retrouvent en grande difficulté, qu’en serait-il pour la Guadeloupe et la Martinique, dont l’équilibre économique repose presque entièrement sur les transferts nationaux ?
Dans ce contexte, la bonne gestion des collectivités locales n’est plus un impératif administratif : elle devient une question de survie économique et sociale. L’heure n’est plus aux dépenses de confort, aux recrutements non maîtrisés ou à la multiplication d’organismes parapublics peu performants. Les collectivités doivent désormais anticiper un environnement budgétaire durablement contraint, où chaque euro mal utilisé aura un impact direct sur la cohésion sociale, la capacité d’investissement et la qualité de vie des habitants.
L’enjeu n’est pas d’attendre que Paris compense, mais de réformer de l’intérieur, de rationaliser les dépenses, de moderniser l’action publique et d’engager enfin des politiques orientées vers la création de valeur et non vers la seule redistribution.
Dans un territoire où le coût de la vie dépasse de 30 % celui de l’Hexagone, où les entreprises peinent à absorber les chocs et où la jeunesse se trouve en perte de repères, la moindre contraction budgétaire peut déclencher une onde de choc sociale.
L’avenir économique de la Guadeloupe et de la Martinique dépendra de leur capacité à se réinventer sans rompre avec l’État, mais en redéfinissant intelligemment leur rapport à lui. L’autonomie ne saurait être un slogan identitaire ; elle doit devenir un projet économique fondé sur la responsabilisation, l’adaptation normative et l’efficacité de la dépense.
Au contraire de l’article 74, l’article 73 de la Constitution, s’il est renforcé d’un pouvoir normatif, permet d’élaborer des politiques publiques mieux adaptées aux réalités locales tout en préservant l’indispensable soutien financier national. La véritable transformation ne réside pas dans une rupture politique, mais dans une révolution de la stratégie économique : réformer le modèle économique, investir dans les compétences, dans la transition énergétique, dans l’innovation, dans la production agricole et industrielle, dans l’économie du savoir.
Le travail, première richesse des nations, doit être réhabilité non comme une contrainte, mais comme un vecteur d’émancipation et de prospérité collective.
À l’heure où le monde bascule vers l’intelligence artificielle, où les métiers se reconfigurent et où la valeur ajoutée dépend de plus en plus des compétences humaines, la Guadeloupe a une chance unique : celle de reconstruire un modèle où l’effort, la créativité et la production redeviennent les moteurs de la société.
Mais, si le travail continue d’être dévalorisé, si la gestion locale reste marquée par l’approximation et le clientélisme, si la solidarité nationale demeure mal utilisée, alors la paupérisation déjà perceptible en Guadeloupe s’accélérera inexorablement à l’avenir dans un contexte de crise financière à venir.
*Economiste et juriste en droit public