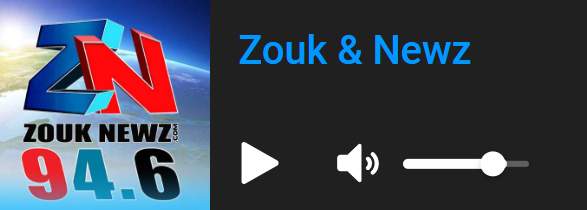PAR JEAN-MARIE NOL*
La vie chère aux Antilles n’est ni un accident conjoncturel ni une dérive temporaire des marchés, mais l’expression la plus visible d’un modèle économique profondément déséquilibré, hérité de l’histoire coloniale et perpétué sous des formes modernes.
En Martinique comme en Guadeloupe, le combat contre la cherté de la vie revient de manière cyclique dans le débat public, porté par des mobilisations populaires, des négociations institutionnelles et des promesses politiques de textes de lois récurrentes. Pourtant, malgré l’intensité des colères et la légitimité des revendications, rien ne change fondamentalement. Les prix restent durablement plus élevés qu’en France hexagonale, le pouvoir d’achat s’érode et le sentiment d’injustice sociale s’enracine. Cette répétition de l’échec n’est pas le fruit du hasard : elle révèle une impasse structurelle.
Le coût de la vie aux Antilles est sensiblement supérieur à celui de l’Hexagone, avec des écarts sur l’alimentation qui atteignent en moyenne plus de 40 % selon les données de l’Insee. Cette situation est souvent expliquée par des facteurs techniques — éloignement géographique, surcoûts de transport, petitesse des marchés, faibles volumes importés — qui, bien que réels, ne constituent que la surface du problème. En réalité, ces éléments masquent une cause plus profonde : la persistance d’un modèle économique fondé presque exclusivement sur l’importation, la concentration capitalistique et la dépendance structurelle vis-à-vis de la métropole.
L’économie antillaise est organisée autour de circuits d’approvisionnement longs, coûteux et verrouillés, dans lesquels une poignée de grands groupes exerce un contrôle décisif sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du port jusqu’au consommateur final. Cette concentration est particulièrement visible dans la grande distribution, l’automobile, l’agroalimentaire et la logistique. Le groupe Bernard Hayot, omniprésent dans les territoires ultramarins, est devenu le symbole de cette domination économique.
Présent dans quasiment tous les secteurs de la consommation courante, il capte une part considérable des dépenses des ménages, avec des niveaux de marges et de rentabilité sans équivalent en France hexagonale. Cette position dominante, aujourd’hui au cœur de plusieurs enquêtes judiciaires du parquet national financier, nourrit une économie de rente où la concurrence est faible, souvent fictive, et où les prix élevés deviennent la norme plutôt que l’exception.
Mais, réduire la vie chère à la seule responsabilité d’un acteur, aussi puissant soit-il, serait une erreur d’analyse. Le problème est systémique. Ce modèle économique, hérité du pacte colonial, a été conçu pour faire des Antilles des territoires de consommation dépendants, non des espaces de production autonomes.
La structuration de l’économie locale n’a jamais permis l’émergence d’une base productive suffisamment diversifiée, capable de réduire la dépendance aux importations, d’assurer une souveraineté alimentaire minimale ou de créer des filières industrielles locales compétitives. Cette dépendance est renforcée par un cadre institutionnel, fiscal et réglementaire largement calqué sur celui de l’Hexagone, sans réelle prise en compte des spécificités géographiques, économiques et culturelles des territoires ultramarins.
Les discussions actuelles à l’assemblée nationale sur un projet de loi sur la vie chère s’inscrivent dans cette contradiction. Elles se focalisent sur des mesures conjoncturelles — baisses de prix ponctuelles avec le dispositif du bouclier qualité prix , accords temporaires avec la grande distribution, aides ciblées pour les ménages les plus modestes, ajustements fiscaux à la marge — qui agissent comme des pansements sur une plaie ouverte.
Ces dispositifs peuvent apporter un soulagement momentané, mais ils ne modifient en rien les rapports de force économiques ni la structure du modèle. On tente de corriger les effets sans jamais s’attaquer aux causes, ce qui condamne mécaniquement toute tentative de réforme à l’échec.
L’État français, de son côté, se trouve face à une équation politique et budgétaire complexe. Remettre en cause le modèle économique des Antilles reviendrait à reconnaître l’échec de plusieurs décennies de politiques publiques ultramarines. Cela créerait également un précédent susceptible d’être revendiqué par l’ensemble des territoires d’outre-mer, de la Guadeloupe à La Réunion, en passant par la Guyane et la Polynésie.
Or, dans un contexte de dégradation rapide des finances publiques, l’État se montre de plus en plus réticent à engager des réformes structurelles coûteuses. Les exemples de la continuité territoriale ou du fonds de compensation sur le fret maritime, pourtant largement insuffisants, illustrent cette frilosité. L’extension de dispositifs inspirés du modèle corse à l’ensemble de l’outre-mer représenterait près de 920 millions d’euros par an, une somme jugée insoutenable par le gouvernement.
À cela s’ajoute le cadre européen, souvent présenté comme une contrainte technique mais qui constitue en réalité un verrou politique majeur. Les territoires ultramarins, bien que situés à des milliers de kilomètres de l’Europe, sont soumis aux mêmes normes que les États membres de l’Union européenne.
Le marquage CE, les règles sanitaires, environnementales et industrielles rendent extrêmement difficiles les échanges commerciaux avec les pays voisins de la Caraïbe, de l’Amérique du Sud ou de l’Amérique du Nord, pourtant géographiquement proches et économiquement complémentaires. Importer depuis l’Hexagone, malgré les distances et les surcoûts, reste souvent plus simple juridiquement que commercer avec des territoires voisins. La récente dérogation obtenue pour les matériaux de construction démontre pourtant qu’une adaptation du droit européen est possible lorsque la volonté politique existe.
Mais, cette avancée demeure limitée et ne concerne qu’un secteur précis, alors que l’essentiel des dépenses des ménages porte sur l’alimentation, l’énergie et les biens manufacturés.
La généralisation de ces dérogations se heurte à la crainte de fragiliser l’unité du marché intérieur européen et de créer des distorsions de concurrence. Pourtant, persister dans le statu quo revient à condamner les économies ultramarines à une dépendance chronique et à une vie chère structurelle.
Les produits importés des régions voisines seraient souvent mieux adaptés aux réalités climatiques, culturelles et économiques locales, tout en étant moins coûteux et plus rapides à acheminer. Favoriser ces échanges régionaux permettrait non seulement de réduire les prix, mais aussi de renforcer l’intégration économique des Antilles dans leur environnement naturel, aujourd’hui largement ignoré.
Au fond, la vie chère aux Antilles est le symptôme d’un déséquilibre politique majeur. Elle révèle l’incapacité à repenser en profondeur les relations entre la France et ses territoires ultramarins, au-delà des ajustements techniques et des compromis temporaires. Tant que le modèle économique restera fondé sur l’importation massive, la concentration capitalistique et la dépendance aux transferts publics extérieurs, toute négociation tendant à réviser les effets pervers du système sera condamnée à l’échec.
La colère sociale qui s’exprime régulièrement n’est pas une anomalie, mais une réaction rationnelle face à un système perçu comme injuste, verrouillé et obsolète. C’est là dans ce contexte qu’il y a urgence à faire évoluer le modèle économique de la Guadeloupe et de la Martinique. En effet, la nécessité de changer le modèle économique de la Guadeloupe et de la Martinique ne relève plus aujourd’hui d’un débat idéologique ou d’un exercice intellectuel abstrait, mais d’un impératif historique dicté par l’épuisement manifeste d’un système arrivé à ses limites structurelles.
Depuis la départementalisation, l’économie guadeloupéenne et Martiniquaise s’est profondément transformée, passant d’un modèle productif fondé sur l’agriculture d’exportation à une économie massivement tertiarisée. En 2024, près de 88 % de la population active est employée dans les services, tandis que le secteur primaire ne représente plus que 2 % des emplois et le secteur secondaire à peine plus de 10 %. Cette mutation a permis une élévation indéniable du niveau de vie, une modernisation rapide des infrastructures et une amélioration du confort matériel, mais elle a aussi installé une dépendance structurelle à la consommation, aux transferts publics et à un modèle redistributif dont la soutenabilité est désormais remise en question.
La Guadeloupe se trouve ainsi enfermée dans une contradiction profonde. Les Guadeloupéens expriment massivement leur aspiration à un autre modèle de société, moins consumériste, plus durable, plus productif et plus inclusif. Dans le même temps, les comportements économiques continuent de reproduire les logiques qu’ils critiquent : primauté de la consommation sur l’investissement productif, crédit bancaire orienté vers l’achat de biens importés plutôt que vers la création de valeur locale, préférence collective pour la sécurité statutaire plutôt que pour la prise de risque entrepreneurial.
Cette dissonance entre aspirations et pratiques révèle le cœur du problème guadeloupéen : un modèle économique qui repose sur la dépense et la redistribution plus que sur la production, dans un territoire où l’appareil productif demeure structurellement faible.
Cette fragilité est d’autant plus préoccupante que la croissance économique de la Guadeloupe est durablement atone. Depuis 2015, elle oscille autour de 1 % par an, un rythme insuffisant pour créer des emplois en nombre suffisant, financer les investissements publics, maintenir les politiques sociales et préparer les transitions à venir.
Les projections les plus optimistes n’annoncent qu’une légère embellie avant une stagnation durable, notamment sous l’effet d’un ralentissement de la consommation des ménages. Ce plafonnement n’est pas un simple indicateur conjoncturel : il annonce un risque réel de déclin, alimentant un cercle vicieux fait de faibles recettes fiscales, de tensions sur l’investissement public, de perte d’attractivité économique et d’incapacité à offrir des perspectives à la jeunesse.
Le modèle consumériste qui a longtemps soutenu la croissance locale montre aujourd’hui des signes d’essoufflement irréversibles. Fondé sur la stimulation permanente de la demande dans une économie largement dépendante des importations et des transferts publics, il ne peut plus constituer une stratégie viable. Continuer à miser essentiellement sur la consommation dans un territoire qui produit peu revient à organiser une impasse économique et sociale.
Ce paradoxe est d’autant plus frappant que les Guadeloupéens, à l’instar de l’ensemble des Français, expriment un rejet croissant du consumérisme : une large majorité souhaite une transformation profonde du système économique et une société où la consommation occuperait une place moindre. Pourtant, la publicité, les promotions, l’obsolescence programmée et l’offre permanente de crédit continuent de structurer les comportements, tandis que le système bancaire privilégie encore largement le financement de la consommation au détriment de la production.
À cette impasse structurelle s’ajoutent des mutations majeures qui rendent le statu quo intenable. L’intelligence artificielle et la révolution numérique menacent directement de nombreux emplois tertiaires et administratifs, alors même que le secteur public constitue l’un des principaux amortisseurs sociaux de la Guadeloupe et de la Martinique. Dans un contexte de contraintes budgétaires accrues, l’État est désormais incité à contenir, voire à réduire, ses effectifs.
Parallèlement, le changement climatique fragilise les bases mêmes des secteurs traditionnels, en particulier l’agriculture et le tourisme, déjà confrontés à des coûts élevés, à une concurrence internationale intense et à une faible valeur ajoutée locale. Dans ces conditions, l’idée selon laquelle l’agriculture ou le tourisme pourraient redevenir les moteurs du développement relève davantage du mythe que d’une stratégie économiquement fondée.
L’échec actuel du modèle productif agricole est pourtant largement documenté. Malgré une hausse massive des aides européennes, la part de l’agriculture dans l’emploi et dans la création de richesse n’a cessé de reculer, illustrant un déclin structurel que ni les subventions ni les discours sur l’autosuffisance alimentaire ne parviennent à enrayer. Les coûts de production élevés, liés notamment à la parité sociale, à l’insularité et à la faible productivité, rendent les productions locales peu compétitives face aux importations.
La persistance du mythe de l’autosuffisance alimentaire totale relève davantage de la démagogie que d’une stratégie réaliste dans un monde régi par les avantages comparatifs. L’agriculture ne peut être qu’un secteur d’appoint, orienté vers la sécurité alimentaire de base et la préservation des savoir-faire, mais elle ne saurait constituer le moteur central de la création de richesse.
Le problème fondamental de la Guadeloupe n’est donc ni institutionnel ni statutaire, mais bien économique et stratégique. Le modèle issu de la départementalisation, fondé sur la stimulation de la demande par l’injection massive de fonds publics, a atteint ses limites parce qu’il n’a jamais permis l’émergence d’un véritable cercle vertueux de production locale.
La consommation des ménages demeure largement supérieure à la production marchande du territoire, créant un déséquilibre chronique entre ce qui est consommé et ce qui est produit. Dans ces conditions, l’investissement, souvent présenté comme la solution miracle, risque de n’être qu’une illusion s’il n’est pas orienté vers des secteurs à forte valeur ajoutée, maîtrisés localement et porteurs de souveraineté économique.
Changer de modèle économique implique donc une rupture assumée avec les illusions du passé et une réorientation stratégique vers une économie de production fondée sur l’innovation, la transformation et la maîtrise des chaînes de valeur. Cela suppose de faire des choix clairs, de hiérarchiser les priorités et d’accepter que tout ne puisse être développé simultanément.
Les technologies de l’information et de la communication, l’économie de la connaissance, l’agro-transformation, les énergies renouvelables, la valorisation des ressources naturelles et le développement de services à forte intensité technologique offrent à la Guadeloupe de véritables opportunités de repositionnement, à condition de ne pas les aborder comme de simples relais de dépendance ou de consommation.
Mais, cette transformation ne pourra réussir sans une refondation du contrat social et une évolution profonde des institutions économiques. Il s’agit de concilier la préservation d’un haut niveau de protection sociale avec l’exigence de création de richesses, en renforçant la formation, en adaptant les compétences aux besoins de l’économie de demain et en soutenant un entrepreneuriat productif et innovant.
La question de la détention du capital, de la gouvernance politique des investissements et de la redistribution de la valeur créée doit être placée au cœur du débat public avec le processus de l’autonomie qui devrait s’appuyer sur l’article 73 renforcé, faute de quoi la modernisation économique se traduira par une simple reconduction de la dépendance sous des formes renouvelées.
Cette exigence de transformation devient d’autant plus pressante que le socle même sur lequel repose le modèle guadeloupéen — l’État-providence français — entre dans une phase de fragilisation profonde. La crise du modèle social hexagonal et la déliquescence des finances publiques annoncent une recomposition inévitable des politiques de redistribution.
Les alertes récentes de responsables économiques de premier plan sont sans équivoque : sur environ 3 500 milliards d’euros de dette publique française, près de 2 000 milliards sont directement liés aux prestations sociales. Retraites, assurance maladie, minima sociaux et allocations chômage ont été durablement financés par l’endettement, dans un contexte de croissance insuffisante pour en absorber le coût. L’État-providence, souvent présenté comme un acquis intangible, a été qualifié de « surexploité, comme on surexploite la nature », croissant plus rapidement que l’économie réelle qu’il est censé soutenir.
Dans ce contexte, l’hypothèse d’un ralentissement, voire d’une réduction progressive des aides sociales ne relève plus du tabou idéologique mais d’une contrainte budgétaire quasi mécanique. Les appels à une diminution drastique des dépenses sociales et à un moratoire sur les nouveaux droits sociaux, à la désindexation temporaire des retraites — pourtant déjà plus généreuses que la moyenne européenne — et à une redéfinition du périmètre de la solidarité nationale traduisent un changement de paradigme profond.
Pour la Guadeloupe, cette perspective est lourde de conséquences. Elle signifie que le modèle fondé sur la compensation permanente des fragilités économiques locales par des transferts nationaux arrive à un point de bascule. La croyance selon laquelle l’État pourra indéfiniment absorber les déséquilibres structurels du territoire devient de moins en moins crédible.
Dès lors, ne pas engager dès maintenant la transition vers un modèle économique productif, innovant et créateur de valeur locale reviendrait à exposer la société guadeloupéenne à un choc social brutal lorsque les mécanismes de solidarité se contracteront. La question n’est plus seulement celle du développement ou de l’autonomie économique, mais celle de la soutenabilité sociale à moyen terme. Produire davantage de richesses sur place, sécuriser l’emploi hors du périmètre public, élargir la base fiscale locale et réduire la dépendance aux transferts nationaux ne sont plus des options théoriques, mais les conditions mêmes de la préservation du pacte social.
À défaut, la Guadeloupe risquerait de subir de plein fouet l’ajustement d’un modèle social français à bout de souffle, sans disposer des amortisseurs économiques nécessaires pour en atténuer les effets . Le combat contre la vie chère ne pourra aboutir qu’au prix d’une remise en cause courageuse de ce modèle économique , impliquant une diversification réelle de l’économie, un soutien massif à la production locale, une ouverture maîtrisée aux échanges régionaux et une redéfinition des règles du jeu économique.
À défaut, les Antilles continueront de subir les conséquences d’un système hérité du passé, incapable de répondre aux défis contemporains, et le vent de la colère continuera de souffler sur ces territoires, rappelant que, parfois, comme le dit le proverbe créole, « fò on dézòd pou mété on lòd ».
À l’horizon 2030–2035, deux trajectoires se dessinent clairement. L’une prolonge la dépendance, où fibre, énergie verte et infrastructures numériques restent contrôlées par des acteurs extérieurs, laissant la Guadeloupe dans une modernité sans souveraineté économique. L’autre parie sur la disparition du modèle économique actuel corrélée avec la création nouvelle d’un capitalisme local inclusif, fondé sur la circulation de l’épargne, la montée en compétence, la gouvernance partagée et la transmission intergénérationnelle du capital. Cette seconde voie exige une réforme profonde du modèle économique et social, ainsi et surtout de la construction de réseaux mondiaux d’entrepreneurs par la région Guadeloupe, bien plus qu’une autonomie politique formelle qui, dans le contexte de tarissement prévisible des investissements publics, conduirait à l’échec.
L’histoire a effectivement coupé l’arbre de la bourgeoisie nationale à la racine. Mais le sol, aujourd’hui, n’est plus stérile avec la jeune génération de guadeloupéens exilés à l’étranger . Déconstruire la chaîne mentale économique et monétaire, c’est accepter de semer autrement à l’aide de la diaspora , en s’appuyant sur l’intelligence collective d’entraide héritée des tontines et mutuelles, sur les outils de la nouvelle économie et sur une vision lucide de l’histoire. Ce n’est ni un retour au passé ni une imitation servile de modèles extérieurs, mais la construction patiente des conditions de reproduction du capital local par une nouvelle classe dirigeante locale, ouverte, compétente et durable.
En sus de la teneur de mon propos et dans le prolongement de la réflexion de la déconstruction de la chaîne mentale économique et monétaire du guadeloupéen, je propose que l’on installe dans toutes les communes de la Guadeloupe un office de l’entrepreneuriat local, avec de surcroît à la clé un recensement de toutes les personnalités du monde économique de la diaspora natives de la commune. C’est à ce prix que l’entrepreneuriat guadeloupéen pourra enfin sortir de la marge et devenir un pilier central du développement économique et social du territoire.
_“Connais ton adversaire, connais-toi, et tu ne mettras pas ta victoire en danger.” “Connais le ciel et connais la terre, et ta victoire sera totale.”_ Sun Tzu* …l’art de la guerre.*
_ »Koko toujou ka pwan rasin… mé sé koté ou ka planté’y ki ka fè la difewans. »
_
*Economiste et juriste en droit public