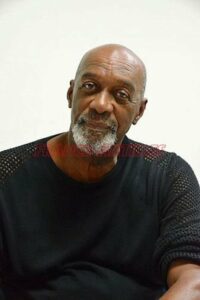PAR JEAN-MARIE NOL*
La Guadeloupe traverse une période charnière de son histoire institutionnelle et économique, mais au lieu d’affronter lucidement les réalités, elle semble souvent s’enfermer dans un déni collectif nourri de non‑dits identitaires et raciaux.
Le récent congrès des élus sur l’autonomie a été un révélateur brutal de cette fracture : alors qu’il était question de l’évolution statutaire du territoire, aucun dialogue préalable n’avait été engagé avec les acteurs économiques et sociaux par le président du Conseil départemental**, comme si le monde de l’entreprise ne méritait pas voix au chapitre. Un forum citoyen ultérieur, organisé en urgence par le président du Conseil régional, a tenté de corriger le tir, mais le mal était fait.
Cette omission volontaire illustre la persistance d’un vieux réflexe idéologique où l’économie réelle est tenue à distance, comme contaminée par une histoire coloniale douloureuse et par le fait que, dans l’imaginaire collectif, la majorité des chefs d’entreprise seraient extérieurs à l’identité antillaise.
Pourtant, l’économie guadeloupéenne est à la croisée de multiples défis, qu’il s’agisse de la cherté de la vie, du foncier bloqué, de l’absence de stratégie industrielle, de la crise de l’eau et des transports ou encore des invasions de sargasses qui défigurent les côtes. À cela s’ajoute la fragilité des finances publiques locales et une dépendance structurelle vis‑à‑vis de l’État français.
Mais, derrière ces urgences tangibles se cache un problème plus profond, presque tabou : la question raciale et identitaire, alliée à une inculture économique qui imprègne trop souvent les élus comme la population. Dans un contexte où la figure de l’entrepreneur a mauvaise presse, la pensée économique se dissout dans un discours public saturé d’idéologie et de revendications identitaires, laissant le champ libre à des visions politiques court‑termistes.
Ce rejet de l’entreprise s’enracine dans l’histoire d’un territoire où la richesse fut longtemps accaparée par les colons et où les structures économiques restent marquées par des héritages esclavagistes. Les entreprises, en particulier celles tenues par des métropolitains ou des étrangers (Chinois, Haïtiens), sont perçues comme des profiteurs, accusées de marges excessives dans un contexte d’importations massives et de prix élevés. Les mouvements sociaux, souvent dirigés contre des commerces symboles du système économique, traduisent une colère profonde contre une structure jugée injuste.
Mais, cette défiance, nourrie par l’histoire, ne suffit pas à expliquer l’incapacité actuelle à construire un nouveau modèle économique avec un tissu économique autonome. C’est surtout l’absence de culture économique, alliée à une vision politique enfermée dans un romantisme identitaire, qui freine l’innovation et bride les initiatives locales.
Ce fossé entre politique économique et politique sociale illustre le mal‑être guadeloupéen. L’économie repose presque entièrement sur les transferts publics et sur l’emploi public, instaurant un esprit de fonctionnariat qui décourage la prise de risque et l’entrepreneuriat. La politique sociale, fondée sur la redistribution et la protection des acquis, crée des attentes sans offrir de réponses durables.
Faute de réformes structurelles et d’un encouragement résolu à l’initiative privée, l’économie reste figée dans une dépendance vis‑à‑vis de l’État et dans une spirale d’immobilisme. Pendant ce temps, les jeunes diplômés quittent massivement l’île, privant le territoire de talents et de créativité, tandis que ceux qui restent se heurtent à un environnement peu propice à l’innovation, d’où une certaine insatisfaction.
Le résultat est une économie peu compétitive, incapable de répondre aux chocs majeurs comme la crise de la vie chère ou la contestation passée autour de la vaccination. L’administration locale, trop souvent confiée à des profils juridiques et non à des experts économiques, peine à élaborer des politiques publiques efficaces.
Le discours dominant continue de privilégier l’idéologie de l’autodétermination héritée du tiers‑mondisme à une réflexion rationnelle sur la création de richesses. Or, dans un monde bouleversé par l’intelligence artificielle, par les mutations industrielles et par la réduction programmée des dépenses publiques, la Guadeloupe ne peut plus se permettre de s’accrocher à des schémas dépassés.
Il faut désormais une véritable vision prospective et une catharsis collective. Repenser la question identitaire et raciale non pas comme un frein mais comme un moteur de cohésion sociale, dépasser les rancunes héritées du passé pour envisager l’entreprise non plus comme un adversaire, mais comme un partenaire indispensable.
Encourager l’entrepreneuriat local, diversifier l’économie, promouvoir l’agriculture et l’industrie locale, développer une culture économique dans les écoles et mieux former les futurs élus à la gestion publique et à l’innovation sont des étapes incontournables. La diaspora et les jeunes générations doivent s’emparer de ce débat, par le dialogue et la maïeutique, clarifier les idées identitaires confuses qui freinent encore le développement.
La Guadeloupe ne pourra affronter l’inégalité croissante des richesses mondiales et les conséquences de la crise de la dette qu’en bâtissant un modèle économique autonome et compétitif. Il est temps de sortir du déni de l’importance de l’économie, de réconcilier mémoire et modernité, et de replacer l’économie au cœur du projet collectif d’évolution institutionnelle. Car, comme le rappelait Confucius, « celui dont la pensée ne va pas loin verra ses ennuis de près. »
À l’horizon 2030, l’avenir de la Guadeloupe dépendra de sa capacité à transformer ses inégalités sociales actuelles et fractures identitaires et raciales en levier de cohésion pour un développement durable et équilibré avec l’aide de tous sans esprits partisans ni ressentiments , mais avec toutefois une pensée empreinte de clairvoyance pour mettre un terme aux discriminations et inégalités.
*Economiste
** Voici la liste des acteurs auditionnés ou consultés dans le cadre des travaux préparatoires au Congrès des élus de 2025, dont les acteurs économiques (source Conseil départemental)