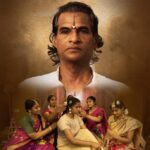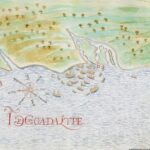PAR JEAN-MARIE NOL*
Le péril jeune aux Antilles n’est pas une simple formule médiatique ou un cliché alarmiste. C’est une réalité sociale, culturelle et psychologique qui s’impose désormais comme l’un des défis les plus urgents des sociétés guadeloupéenne et martiniquaise.
La génération Z, née entre 1995 et 2010, y concentre toutes les fragilités d’un monde devenu incertain, hyperconnecté et dépourvu de repères éducatifs solides. Souvent accusée d’inconstance, de manque de discipline, d’individualisme ou de désintérêt pour le travail, elle reflète surtout les défaillances d’un cadre collectif déstructuré. Les chiffres révèlent aujourd’hui l’ampleur d’un malaise qui dépasse largement les frontières caribéennes, mais qui se manifeste aux Antilles avec une acuité particulière.
La jeunesse qui grandit aujourd’hui en Guadeloupe et en Martinique évolue dans un environnement saturé de réseaux sociaux, traversé par l’instabilité économique, inquiété par les risques écologiques, et marqué par des crises sanitaires, familiales et institutionnelles successives.
Cette génération, ultra-connectée mais souvent isolée, informée mais déracinée, n’a pas hérité des piliers éducatifs qui permettaient autrefois aux jeunes de se structurer. L’effacement progressif des figures d’autorité, notamment masculines, et le recul du cadre parental ont laissé un vide que ni l’école ni les institutions locales n’ont su pleinement compenser.
Beaucoup de jeunes n’ont jamais rencontré un cadre solide, fait d’adultes cohérents, de limites claires, d’exigence constructive. Et ce vide éducatif, loin d’être anodin, s’étend désormais à des domaines essentiels comme l’insertion professionnelle ou la santé mentale.
Au niveau national, l’INSEE estime que 1,5 million de jeunes sont sans emploi, ni formation, ni stage. Santé Publique France indique que 40 % d’entre eux souffrent d’anxiété ou de dépression, tandis que 65 % ne font plus confiance aux institutions, selon IPSOS. Les employeurs eux-mêmes signalent une difficulté croissante à les intégrer : manque de motivation, absence d’initiative, déficit de savoir-être, faibles compétences communicationnelles.
Mais, derrière ces symptômes se cache un phénomène beaucoup plus profond : une génération élevée dans un monde numérique sans limites, exposée en permanence à des contenus anxiogènes, aux cyberviolences, aux addictions, et qui peine à construire une identité stable dans un environnement où tout est instantané, volatile, soumis à la comparaison sociale permanente.
Aux Antilles, ce malaise atteint pourtant des niveaux bien plus inquiétants que dans l’Hexagone. Selon l’UNCCAS, 39 % des jeunes ultramarins souffrent de dépression, contre 25 % à l’échelle nationale, avec des pics vertigineux : 44 % en Martinique, 52 % en Guyane. Plus de la moitié des CCAS d’outre-mer considèrent désormais la jeunesse comme la population la plus touchée par les problématiques de santé mentale.
Ce phénomène n’est pas seulement psychologique ; il est aussi environnemental et social. Aux Antilles, les facteurs aggravants se multiplient : pollution au chlordécone, brumes de sable persistantes, invasion régulière des sargasses, éco-anxiété climatique, violences urbaines croissantes, précarité économique, difficultés d’accès au soin.
Le cumul de ces vulnérabilités crée une spirale de détresse où se mêlent fatigue chronique, repli, violence, perte de sens, décrochage scolaire et professionnel, conduisant parfois à des pensées suicidaires chez près d’un jeune sur trois.
Ce tableau alarmant s’inscrit aussi dans un contexte où les jeunes peinent à trouver leur place dans un marché du travail devenu exigeant et mouvant. Les attentes professionnelles des nouvelles générations – flexibilité, équilibre vie privée-vie pro, sens au travail – se heurtent aux réalités locales d’un marché étroit, peu diversifié, marqué par le chômage structurel et la dépendance aux emplois publics.
Le stress scolaire et professionnel est massif : 87 % des jeunes se disent stressés par leurs études, 75 % par leur travail, avec des taux de dépression particulièrement élevés chez les chômeurs, indépendants ou salariés précaires. Les jeunes femmes, plus exposées que les hommes, voient leur santé mentale détériorée par la pression sociale, les troubles du sommeil, la charge émotionnelle et l’instabilité économique. Quant aux jeunes urbains, ils cumulent isolement, désespoir et précarité, particulièrement dans les agglomérations antillaises où l’emploi se raréfie et où la violence devient un mode d’expression de frustration.
Dans ce paysage déjà fragilisé pour l’équilibre des jeunes par les bouleversements économiques mondiaux, un autre facteur vient nourrir l’inquiétude d’un véritable « péril jeune » aux Antilles : l’explosion du narcotrafic et ses effets dévastateurs sur la santé mentale et la violence juvénile.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 22 tonnes de stupéfiants ont déjà été saisies en 2025 par les Forces armées aux Antilles, des cargaisons qui atteignent désormais cinq à dix tonnes par interception, témoignant d’une intensification spectaculaire du trafic transatlantique. Cette déferlante de cocaïne, d’héroïne et de drogues de synthèse irrigue les territoires antillais et expose une jeunesse vulnérable à des substances de plus en plus puissantes, avec des conséquences directes sur les troubles psychiques, les comportements violents et l’emprise des réseaux criminels.
Les affaires récentes – dont les 239 kg de cocaïne débarqués discrètement dans un conteneur à Marseille en provenance des Antilles – illustrent la porosité croissante entre les îles et les grandes filières mafieuses. Dans un contexte où la santé mentale des jeunes est déjà mise à rude épreuve par les pressions sociales, le chômage et les mutations technologiques, cette infiltration massive de la drogue agit comme un accélérateur de risques, minant les fondements mêmes de la cohésion sociale antillaise.
Pourtant, les expériences menées par plusieurs structures éducatives ou d’accompagnement montrent qu’un retour à un cadre clair, stable et incarné peut changer la donne. Trois semaines sans téléphone dans un environnement structurant permettent parfois de faire chuter drastiquement les troubles anxieux.
Des adultes fiables, exigeants et cohérents, des horaires fixes, une vie collective imposée, un effort physique quotidien, un travail manuel régulier : autant de repères simples mais essentiels, capables de transformer la posture de jeunes perdus dans le brouillard numérique. Lorsque l’autorité redevient incarnée, notamment par une présence masculine constante, rassurante et cohérente, beaucoup de jeunes retrouvent confiance, discipline et projet de vie. L’absence de cadre paternel, de limites fermes mais justes, explique en grande partie cette hypersensibilité, cette réactivité excessive et cette difficulté à faire face à la frustration qui caractérise une partie de la génération Z antillaise.
Le péril jeune n’est donc pas une génération en crise, mais une société en panne de transmission. Ce n’est pas la jeunesse qui serait défaillante ; c’est l’environnement éducatif, familial et institutionnel qui ne remplit plus sa mission de structuration. Aux Antilles, où les difficultés sociales, économiques et environnementales se cumulent, cette fragilisation atteint un seuil critique.
Mais au-delà des enjeux économiques, politiques ou identitaires, une menace plus silencieuse et profondément déstabilisante commence à poindre : celle de l’impact psychique de l’intelligence artificielle sur les jeunes générations de Guadeloupéens et de Martiniquais. Car l’IA n’est plus seulement un outil ou un moteur de productivité ; elle s’insinue désormais dans le territoire intime de la relation humaine.
Les chatbots émotionnels, devenus capables de simuler l’attention, l’écoute, la tendresse et même l’amour, bouleversent déjà les codes traditionnels des interactions sociales. Comme l’explique la psychologue guadeloupéene Maguy L. , la tendance naturelle de l’être humain à créer des liens avec ce qui semble le comprendre ouvre la voie à des attachements profonds, parfois plus forts que ceux noués avec des personnes réelles.
L’émergence des « partenaires virtuels » – proposés par Candy AI, Replika, Anima ou Kindroid – accentue ce glissement. Ces IA calibrées pour répondre aux désirs affectifs et sexuels, disponibles en permanence, personnalisables jusque dans leur prénom et leur caractère, créent une illusion de relation parfaite, sans conflit ni frustration. Or ce mirage risque de fragiliser encore davantage une jeunesse déjà exposée à la solitude, à l’isolement numérique et aux angoisses identitaires.
Le danger est réel : perte de repères émotionnels, confusion entre interaction simulée et réel affectif, désinvestissement des relations humaines, et, à terme, une possible accentuation des troubles mentaux dans des sociétés antillaises où les fragilités psychologiques sont souvent tues, minimisées ou mal prises en charge.
L’irruption de l’IA dans la vie sentimentale n’est pas un simple gadget technologique : c’est une rupture anthropologique dont la Guadeloupe et la Martinique n’ont pas encore pris la mesure. Laisser les jeunes générations se construire au contact de partenaires artificiels, façonnés pour répondre à leurs moindres attentes, reviendrait à amplifier un déséquilibre déjà profond entre aspirations personnelles et réalité sociale.
Si l’autorité publique ne se saisit pas rapidement de cette question, le choc culturel, affectif et mental pourrait être aussi dévastateur que silencieux, et s’ajouterait aux nombreux défis déjà présents.
Il devient urgent de mettre en place dans toutes les communes de Guadeloupe et Martinique un contrat local pour la santé mentale, le CLSM de manière préventive pour restaurer un cadre éducatif cohérent, d’investir massivement dans la santé mentale dès l’école élémentaire , de renforcer la présence parentale – notamment paternelle –, de protéger les jeunes contre les dérives numériques, et de leur redonner un horizon professionnel lisible.
Faute de quoi, une génération entière risque de s’installer durablement dans la détresse, l’errance ou la violence. Le péril jeune n’est pas une fatalité, mais cela est déjà un danger virtuel pour la société antillaise : c’est donc un appel à reconstruire les fondations mêmes de la société antillaise, avant un potentiel écroulement sociétal inévitable. A méditer ce proverbe créole : _« Ou vwé jodi, men ou poko vwé ayen a demen »_
Traduction littérale : Tu vois aujourd’hui, mais tu n’as rien encore vu de demain.
*Economiste et juriste en droit public