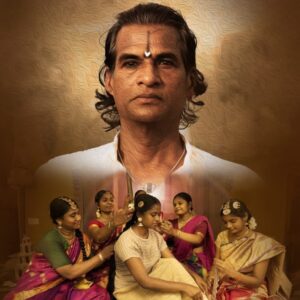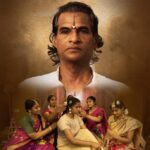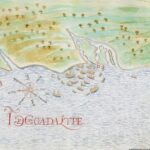PAR JEAN-MARIE NOL*
Sous un ciel alourdi en France par les crises politiques, institutionnelle, économiques, financière et technologiques, voire aussi plombé par les incertitudes ouvertes à l’heure des congrès sur l’autonomie sans aucune visibilité, et vision prospective du lendemain, un nouvel ordre mondial se dessine, porteur de menaces directes pour la Guadeloupe et la Martinique.
Tandis que la France vacille sous l’effet d’une instabilité prolongée, l’économie française s’enlise dans la crise de défiance, la confiance s’effondre et les repères traditionnels du travail se délitent. Tout cela se traduit par un absentéisme massif au travail et un désintérêt professionnel patent pour la génération Z.
Selon une estimation d’un économiste, l’absentéisme pourrait en réalité coûter plus de 100 milliards d’euros à l’ensemble du budget (et pas uniquement les 17 milliards qui pèsent sur la Sécurité Sociale à cause des arrêts maladie). Pour réduire les absences, il faudra s’attaquer aux causes racines du mal-être au travail.
Mais, c’est loin d’être gagné d’avance, car les entreprises augmentent la pression sur les salariés. Ainsi, force est de souligner que les acquis sociaux sont d’ores et déjà menacés. Le monde est en train de changer et personne aux Antilles ne semblent en avoir conscience, et surtout pas les syndicats. C’est là un retour de boomerang avec : « Retour au bureau, pression, zéro flexibilité… Depuis six mois, l’atmosphère a radicalement changé » : dans les entreprises, les chefs reprennent la main.
Depuis que le marché du travail s’est retourné, les salariés ne sont plus en position de force pour réclamer augmentations ou avantages en nature. En quête d’efficacité à court terme, les employeurs rognent sur le télétravail et augmentent la pression sur les effectifs.
Aux conséquences déjà prévisibles de la crise économique, politique et surtout institutionnelle née de la dissolution de l’Assemblée nationale et suite à la démission de Sébastien Lecornu s’ajoute désormais une mutation sociétale d’une ampleur inédite qui ne saurait être contrecarrer par la nomination d’un autre gouvernement : celle engendrée par la révolution technologique et l’irruption massive de l’intelligence artificielle.
Près de la moitié des entreprises dans le monde ont déjà réduit leurs effectifs à cause de l’IA, et plus de la moitié prévoient d’en employer moins dans les années à venir. Ce choc silencieux, qui bouleverse les fondements du marché du travail, menace d’accentuer le déséquilibre économique et social des territoires ultramarins, déjà fragilisés par la précarité et la désespérance des jeunes générations confrontées au chômage de masse.
Alors que l’humanité s’interroge encore sur les limites éthiques et sociales de ces nouveaux outils, les premiers effets concrets de cette transformation se font déjà sentir sur le marché du travail. Selon une récente étude du cabinet LHH, filiale du groupe Adecco, près de la moitié des entreprises à travers le monde ont déjà réduit leurs effectifs à cause de l’intelligence artificielle, et 54 % prévoient d’employer moins de personnes dans les cinq prochaines années.
Cette évolution, loin d’être marginale, traduit une recomposition radicale du monde professionnel où l’algorithme tend à supplanter l’humain dans des tâches toujours plus nombreuses, plus complexes, et désormais même plus créatives.
Le phénomène, d’abord cantonné aux secteurs technologiques, s’étend désormais à la finance, à l’assurance, à l’ingénierie et à l’administration publique. Des entreprises comme Microsoft reconnaissent que 30 % de leur code informatique est désormais généré par des systèmes d’IA. Derrière ces chiffres, c’est une profonde rupture sociale qui s’annonce : celle d’une société du travail fragilisée, où la reconversion devient la norme et où l’insécurité professionnelle gagne même les catégories autrefois protégées. En France, comme ailleurs, les cadres ne sont plus épargnés. Les experts parlent déjà d’une « obsolescence accélérée » des compétences, tandis que les formations professionnelles peinent à suivre le rythme des innovations.
Les salariés, souvent inconscients de l’ampleur de cette transformation, sous-estiment encore les conséquences à long terme. Seuls 12 % d’entre eux reconnaissent avoir perdu leur emploi en raison de l’IA, mais les économistes notent que ces chiffres ne font qu’effleurer la réalité d’une transition beaucoup plus vaste et insidieuse. Les personnes licenciées à cause de l’automatisation retrouvent plus difficilement un emploi : à peine 37 % y parviennent dans les trois mois, contre 46 % pour les autres. Et celles qui se reconvertissent sont contraintes, dans 58 % des cas, de changer radicalement de métier, signe d’une fracture structurelle entre l’ancien et le nouveau monde du travail.
Dans les Antilles, où le tissu économique repose principalement sur les services publics, le tourisme et le commerce de proximité, cette révolution technologique risque d’avoir un impact dévastateur. La robotisation des services administratifs, la numérisation du secteur bancaire et la montée de l’IA dans le tourisme intelligent pourraient marginaliser des milliers de salariés peu ou pas qualifiés. Le risque est d’autant plus grand que ces territoires disposent d’un accès limité à la formation continue et aux filières technologiques.
Et pour ne rien arranger, l’on note que l’économie française, elle, paie le prix fort de son désordre institutionnel, et qui aura des répercussions fâcheuses aux Antilles. Selon l’OFCE, seize mois de crise politique ont coûté 15 milliards d’euros et amputé la croissance de 0,5 point. L’investissement se fige, la consommation recule, et la défiance des marchés fait bondir les taux d’intérêt à dix ans au-dessus de 3,5 %, fragilisant le crédit immobilier et rendant l’accès au logement de plus en plus inabordable, notamment pour les jeunes Antillais.
Dans un contexte où la vie chère et l’emploi précaire constituent déjà des fardeaux lourds à porter, la hausse des taux agit comme un couperet : elle ferme la porte à la propriété et à la stabilité, deux piliers essentiels de l’intégration sociale.
Mais au-delà des chiffres, c’est le tissu humain qui s’effiloche. En Guadeloupe et en Martinique, la crise économique et financière va bientôt se doubler d’une détresse psychologique alarmante. Selon une enquête de la Mutualité Française, 39 % des jeunes ultramarins se déclarent déjà aujourd’hui en dépression, contre 25 % en métropole.
Les chiffres atteignent même 44 % en Martinique et 37 % en Guadeloupe. Manque de soins, tabous culturels, insuffisance de psychiatres et d’équipes mobiles : tout concourt à amplifier un mal-être qui ronge silencieusement la société.
Dans ces territoires où parler de santé mentale reste encore perçu comme une faiblesse ou une folie, les dispositifs d’écoute et de prévention, bien que courageusement menés par des associations locales, peinent à endiguer la vague de stress et d’angoisse.
À cette fragilité sociale vient désormais se greffer l’incertitude technologique. L’intelligence artificielle, tout en promettant des gains de productivité, fait planer la menace d’un chômage structurel. Les emplois administratifs, financiers et tertiaires — majoritaires en Guadeloupe et Martinique — figurent parmi les plus exposés à l’automatisation. Les jeunes, souvent peu formés aux métiers du numérique, risquent d’être les premiers exclus d’un marché du travail remodelé par les algorithmes. La peur du déclassement, déjà omniprésente, s’intensifie à mesure que les entreprises accélèrent leurs transitions digitales.
Dans le monde, 58 % des salariés déjà ont dû changer de métier après un licenciement lié à l’IA, signe d’un bouleversement durable des trajectoires professionnelles.
Ainsi, sous la pression combinée des crises politiques, financières et technologiques, la Guadeloupe et la Martinique se trouvent à la croisée des chemins. Les secousses de la France hexagonale et les mutations globales du capitalisme financier et numérique ébranlent les équilibres sociaux les plus fragiles. Ce nouvel ordre économique, en gestation sous un ciel d’incertitudes, pourrait bien consacrer l’avènement d’un monde où le travail se dématérialise, la croissance s’essouffle et l’humain vacille.
La dimension psychologique de ce bouleversement ne doit pas être sous-estimée. Dans un contexte où l’économie est en souffrance , où les repères professionnels s’effritent, l’angoisse du déclassement devrait bientôt s’installer durablement. La crise de la santé mentale, illustrée par le taux alarmant de jeunes en dépression dans les DROM, trouve ici une nouvelle cause structurelle : la perte de repères dans un monde en mutation accélérée.
Dans ce contexte, les Antilles apparaissent comme le baromètre d’un basculement global : celui d’une civilisation confrontée au paradoxe de son propre progrès, où la modernité, loin d’émanciper, semble désormais menacer le droit fondamental de chacun à espérer au progrès social , fruit du passé de la période de départementalisation.
Dans ce basculement où le progrès semble aujourd’hui se confondre avec la perte de sens , la Guadeloupe et la Martinique se trouvent à la croisée des chemins : choisir d’être spectatrices d’une mutation imposée ou actrices d’une reconversion collective, lucide et humaniste, pour ne pas subir le choc du désordre et du chaos du monde qui vient.
Sous ce ciel de France lourd de menaces, la Guadeloupe et la Martinique apparaissent comme les sentinelles d’un basculement dans un dangereux monde global. Ce nouvel ordre économique, encore en gestation, risque de se construire sur les ruines d’un modèle social épuisé. Si la France continentale s’inquiète de la hausse de ses taux et de l’ampleur des déficits publics qui seront alourdis par la future progression exponentielle de la charge de la dette ( intérêts ), les Antilles, elles, redoutent la montée du désespoir.
Car, au bout de cette crise, ce n’est pas seulement la solvabilité d’un État qui se joue, mais la santé morale d’une jeunesse insulaire dont les rêves s’éloignent à mesure que monte le coût de la vie. La mutation de l’économie mondiale pourrait bien être aussi celle des consciences : une ère où la valeur d’une société ne se mesurera plus seulement à la courbe de sa croissance économique ( PIB) , mais à la capacité de son peuple à espérer encore un changement de paradigme pour sauver ce qui peut encore l’être , nonobstant le proverbe créole suivant :
« Lajan pa ka rété la ki ni laswè ».
*Economiste et juriste en droit public