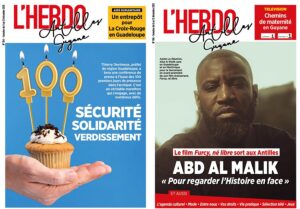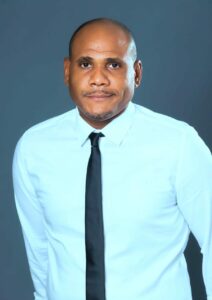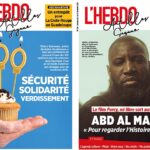PAR JEAN-MARIE NOL*
Le coup de rabot annoncé sur le budget de l’Outre-mer marque sans doute plus qu’une simple inflexion budgétaire : il s’apparente à un tournant historique dans la gouvernance des territoires ultramarins.
A travers cette réduction de moyens et la redéfinition progressive des compétences, c’est un véritable basculement stratégique qui se dessine — celui d’un transfert partiel, puis peut-être total, de la gestion politique et surtout économique de l’Outre-mer vers l’Union européenne.
Cette hypothèse, encore taboue dans le débat public, prend aujourd’hui une consistance nouvelle à la lumière des signaux faibles envoyés par le gouvernement français et du contexte budgétaire national qui ne laisse plus aucune marge de manœuvre financière aux régions et territoires d’outre-mer.
En effet, la France n’a plus les moyens de financer indéfiniment les 36 milliards d’euros que représente chaque année le coût global de l’Outre-mer pour ses finances publiques.
Derrière la rhétorique du « recentrage budgétaire » ou de la « rationalisation de la dépense publique » se profile une réalité plus brutale : l’hexagone , asphyxiée par la dette et contrainte par les règles européennes de discipline budgétaire, prépare une redéfinition profonde de sa relation avec ses territoires éloignés. D’ores et déjà, nombre de compétences concernant l’Outre-mer — développement régional, coopération régionale, politique agricole, environnement, pêche ou cohésion sociale — ont été transférées à l’Union européenne, souvent dans l’indifférence générale.
Ce qui hier apparaissait comme un simple cofinancement communautaire devient peu à peu un mode de gestion intégré, plaçant les régions ultramarines dans l’orbite administrative et financière de Bruxelles. Le signe avant coureur qui m’a mis sur la piste de la stratégie cachée du désengagement de la France en Outre-mer au profit de l’Europe est le nouveau statut concocté pour la Nouvelle Calédonie.
Dans la décennie prochaine, je pense que l’ensemble des territoires d’Outre-mer seront directement rattachés à l’Union Européenne sur le plan institutionnel et non plus à la France et donc se posera la question du maintien des droits sociaux qui découlent de l’appartenance jusqu’à présent à la France.
L’examen du projet de loi de finances 2026 illustre parfaitement cette orientation. Pour la première fois depuis 2020, les crédits alloués au ministère des Outre-mer pour financer les politiques d’aide aux entreprises, d’accès au logement, la continuité territoriale ou encore le soutien aux collectivités sont prévus en nette baisse par rapport à l’année précédente.
En 2026, le projet de loi de finances initial prévoit 2,827 milliards d’euros de crédits de paiement pour les Outre-mer (-160 millions d’euros en un an). Le bât blesse d’autant plus que, en plus de la baisse des dépenses, le gouvernement propose de faire 750 millions d’euros d’économies sur le dispositif d’aides aux entreprises ultramarines en coupant notamment dans les exonérations prévues par la loi LODEOM, et en remaniant les dispositifs de défiscalisation de l’investissement productif.
Le budget des Outre-mer, après plusieurs années d’augmentation continue, subit donc une baisse sensible , et les dispositifs d’aides aux entreprises ultramarines voient leurs exonérations et avantages défiscalisés sévèrement restreints. Le gouvernement entend limiter ces dispositifs aux investissements « verts », excluant ainsi des pans entiers de l’économie touristique, déjà fragilisée.
Derrière cette orientation écologique de façade se cache une autre logique : conditionner les aides à des programmes compatibles avec les financements européens, ce qui faciliterait, à terme, un transfert de tutelle ou de pilotage politique et économique vers l’Union Européenne.
A la fin de cette décennie le ministère des Outre-mer sera amené à disparaitre car c’est l’Union Européenne qui prendra le relais de la France, d’ailleurs nous avons déjà un passeport européen.
Cette perspective s’inscrit dans un contexte politique et social particulièrement tendu. La Guadeloupe, comme la Martinique ou la Guyane, traverse une crise profonde et multiforme : explosion de la violence, perte de repères, faillite du système éducatif, exode massif de la jeunesse, services publics en déliquescence, économie endettée, et vieillissement démographique et surtout quête identitaire.
Ces symptômes révèlent moins un accident conjoncturel qu’une défaillance structurelle de la décision publique, nationale comme locale. L’État a longtemps géré l’Outre-mer selon une logique de guichet et de dépendance, mais les élus locaux ont, eux aussi, péché par manque de vision et d’anticipation. Le court-termisme électoral et le clientélisme ont pris le pas sur la planification et la prospective, condamnant les territoires à une stagnation chronique.
Dans ce climat d’asphyxie financière , la stratégie du gouvernement français, bien que rarement explicitée, semble limpide pour nous en notre qualité d’économiste : transférer progressivement la charge et la responsabilité de la gestion des Outre-mer à l’Europe. Et c’est pourquoi la France pousse à l’autonomie des départements français d’outre-mer avec l’assentiment et l’appui de nos élus qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Le changement statutaire est la condition pour intégrer institutionnellement le giron juridique de l’Europe et ne plus supporter la charge financière des minima sociaux et des 40% de vie chère.
Le discours officiel évoque des « convergences de politiques publiques », mais la réalité pourrait être celle d’un désengagement progressif méthodique. Ce basculement, s’il venait à se confirmer, répondrait à une double nécessité : budgétaire, d’une part, pour soulager les comptes publics français ; politique, d’autre part, pour inscrire les régions ultramarines dans un cadre institutionnel plus vaste, celui de l’Union européenne, perçue comme une garantie de continuité financière et de stabilité réglementaire, et n’ayant pas la charge mentale du passé colonial de la France.
Avec la rattachement direct de l’outre-mer à l’Union Européenne, on changera de paradigme car il y aura le basculement d’une société de consommation héritage de la départementalisation à une société de production sans le filet des aides sociales et financières de la France. Ce sera un changement profond qui verra une évolution institutionnelle type du nouveau statut de la nouvelle caledonie. Des nouveaux Etats directement rattachés à Bruxelles… à méditer !
Cependant, cette transition ne se fait pas sans heurts, ni sans résistances. Beaucoup d’élus d’Outre-mer, arc-boutés sur la défense d’un modèle d’assistanat qu’ils confondent avec la solidarité nationale, refuseront de voir la mutation à l’œuvre. En votant massivement la motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, malgré la consigne contraire de leur propre parti, plusieurs députés ultramarins ont manifesté une hostilité politique de principe, sans percevoir les conséquences négatives de leur geste.
Car, en affaiblissant le gouvernement, ils contribuent paradoxalement à renforcer les forces politiques qui prônent un désengagement encore plus radical de l’État et un repli sur l’hexagone, ouvrant de facto la voie à un transfert accru des responsabilités vers Bruxelles. Ce jeu de posture, alimenté par la démagogie et l’irresponsabilité de nos parlementaires , ne fait que précipiter le scénario qu’ils prétendent combattre.
La crise politique nationale amplifie cette dynamique. Le budget 2026, qui prévoit une réduction drastique du déficit public, annonce une ère d’austérité dont les Outre-mer seront les premières victimes. La promesse du Premier ministre de ne pas recourir au 49.3 masque mal la réalité : toutes les dépenses non essentielles seront réduites, et les aides ultramarines ne seront plus sanctuarisées.
Dans un pays où la dette publique dépasse 116 % du PIB, où chaque euro dépensé doit désormais être justifié devant Bruxelles, la solidarité nationale ne peut plus reposer sur la seule générosité de l’État central. La tentation est d’autant plus grande, pour le gouvernement, de substituer aux transferts directs du Trésor français les financements européens — Fonds de cohésion, FEDER, FSE+, FEADER — qui pourraient, à terme, se substituer partiellement ou totalement au budget national.
Mais au-delà de la mécanique financière, c’est la question politique qui est posée : quelle place pour les Outre-mer dans la République française du XXIᵉ siècle ? Sont-ils appelés à devenir les nouvelles régions ultrapériphériques de l’Union européenne, directement liées politiquement à Bruxelles, comme l’ont été les Açores, Madère ou les Canaries ? Ou la France choisira-t-elle de maintenir un lien de solidarité intégrale, quitte à l’assumer au prix d’un endettement insoutenable ? Ce dilemme, longtemps éludé, s’impose aujourd’hui avec une urgence inédite.
Les sociétés océanique de la France , elles, oscillent entre résignation et colère. Elles aspirent à un changement réel, à un État plus présent et plus efficace, mais elles redoutent en même temps que ce changement ne prenne la forme d’un abandon déguisé comme envisagé de façon stratégique par la France.
Le peuple guadeloupéen, comme ses voisins, ressent une angoisse diffuse : celle d’un avenir où la France, acculée par la rigueur budgétaire, délèguerait à l’Europe la gestion de territoires qu’elle ne peut plus assumer pleinement. L’alternative européenne, séduisante par son potentiel financier, pourrait se révéler périlleuse pour le maintien des droits sociaux qui découlent du modèle social français, si elle s’accompagnait d’une perte de contrôle politique et identitaire.
Il est donc urgent de rompre avec la schizophrénie collective qui traverse la classe politique des Antilles – Guyane : celle qui, d’un côté, dénonce la dépendance à la dite métropole, et de l’autre, semble être prête à toute évolution institutionnelle vers plus d’autonomie ou de responsabilité.
Mais, le hic c’est que l’avenir des Outre-mer ne se jouera plus à Paris, mais dans la capacité de leurs dirigeants à comprendre et à anticiper cette bascule vers l’Europe. Ce qui s’annonce avec l’autonomie n’est pas une simple réforme administrative : c’est une refondation du rapport entre la France, l’Europe et ses marges tropicales.
Car, comme le disait Walter Benjamin, la véritable catastrophe n’est pas la crise, mais que tout continue comme avant. Or, si rien ne change dans la posture , la France se retirera doucement, l’Europe prendra le relais, et les Outre-mer, une fois encore, n’auront pas choisi leur destin — il leur aura été imposé.
« An ka potéw, ou ka trinin mwen »
Traduction littérale : Je te porte, tu me traînes
*Economiste et juriste en droit public